19 décembre 2011
Le goût des paysages : faut-il choisir entre Kant ou Bourdieu ? par P. Donadieu
Longtemps, l’appréciation des paysages et des lieux par le public a requis des jugements de goût. Or le goût, réfractaire à toute rationalité (« des goûts et des couleurs on ne discute pas ») est, dans le champ de l’art, le seul médium capable de mettre en relation ce qui est donné à percevoir par l’artiste, et le public[1]. Certes, la plupart des paysages qui sont donnés à percevoir n’ont pas été voulus par un artiste. Mais leur réception dépend beaucoup de la capacité culturelle des publics à les apprécier, ou de leur « inclination naturelle » à s’y intéresser. Dans tous les cas le goût qui valorise (le bon goût) s’oppose au goût qui déprécie (le mauvais goût). Dans la sensibilité collective aux paysages d’hier et d’aujourd’hui, il existe des spectacles dont on peut jouir jusqu’à l’extase (comme des tableaux), et d’autres dont il est recommandé par les critiques et les experts (les auteurs des guides touristiques par exemple) de s’écarter si l’on recherche le plaisir de la contemplation esthétique.
La conséquence a été d’aboutir à des jugements contradictoires, quoique légitimes, pour les mêmes œuvres de l’art comme pour les mêmes paysages, et à s’en remettre àà la manière des vins et de la gastronomie- aux experts pour distinguer le bon du mauvais goût.
Dans la Critique du jugement publié en 1790, le philosophe allemand Emmanuel Kant avait rétabli « l’universalité des droits esthétiques de l’humanité » (p. 78). À cet effet, il avait requis quatre conditions : le désintéressement, la pureté, la nécessité et l’universalité. Et, pour ce faire, il avait séparé le beau de l’utile, du bon et de l’agréable (désintéressement) ; distingué la contemplation formelle « des contaminations sensuelles, concupiscentes et appétissantes » (pureté) ; marginalisé les contingences des inclinations, des caprices, des privilèges et des raffinements (nécessité), et précisé : « Est beau ce qui plaît universellement sans concept ». Ainsi réduite à un exercice ascétique et spirituel, la jouissance de la beauté pouvait devenir accessible à tous, mais au prix « de la dégradation de la sensibilité régissant le goût de l’accaparement et du désir » (p. 78). De fait, contrairement à l’Edit de Nantes (1598) qui tolérait la religion réformée, «l’édit de Kant», au nom de l’universel puritain et objectif avait proscrit les goûts subjectifs de l’agréable et des plaisirs aléatoires.
Ainsi conçue et admise sans broncher, l’esthétique kantienne, comme le montre Luca Vercelloni, a fait le lit de l’idéologie libérale et marchande en désignant le bon goût comme l’apanage de la classe bourgeoise. Ce thème a été largement développé par le sociologue français Pierre Bourdieu dans La Distinction, critique sociale du jugement publié en 1979. Pour les classes aisées, détenir le bon goût, le plus pur et le moins utilitaire possible, pour apprécier des paysages nobles, pittoresques ou sublimes, permet de se retrouver entre soi, loin des amateurs de scènes jugées faciles, vulgaires, ordinaires et bon marché, en bref des tenants du mauvais goût et des frivolités. En dépit des observations empiriques qui montrent que l’expérience esthétique dépend autant de l’intérêt utilitaire qui est accordée à un paysage que du plaisir sensuel qu’on éprouve à le parcourir.
Kant n’avait pas tort de vouloir accorder à tous ses contemporains le droit de contempler sereinement le monde, de faire du goût pur « une incarnation sensible des idées morales » (La critique…), et sans doute de chercher à briser les barrières de classes et de « capital culturel » (Bourdieu). Mais il le faisait aux dépens « des plaisirs intéressés du luxe, de la mode et de la gastronomie » (p. 83), et, en dépit de ses bonnes intentions, au profit des classes sociales les plus aisées, suivies en matière de goût recommandable par celles qui le sont moins.
À y regarder de plus près, au vu de recherches récentes, le goût des publics pour les contemplations paysagères pures et morales (pittoresques et sublimes) semble s’être élargi à de nouvelles expériences.
Quand les chercheurs demandent aujourd’hui aux habitants d’une commune de leur indiquer comment et pourquoi ils jugent telles ou telles scènes de leurs cadres de vie habituels, urbain, périurbain ou rural, leurs réponses ne recourent pas seulement à l’esthétique. Dans ce cas, c’est surtout le regard de l’esthète qui juge de l’harmonie des formes et des couleurs : celui du peintre, du photographe, voire du paysagiste qui est mobilisé. Dans les travaux sur la montagne suisse de Yvan Droz et al.[2], la valeur esthétique « c’est le discours du beau pour lui-même », une posture référable à la beauté kantienne pour les uns, mais pas pour les autres.
Car les postures paysagères des habitants font usage de l’idée du beau également pour parler de valeurs utilitaires, spirituelles et affectives : de la valeur agricole et sylvicole (une belle forêt, un beau troupeau) ; de valeurs spirituelles (l’harmonie ressentie face à une nature apaisante et mystique) ; de valeurs biologiques (la biodiversité de certains milieux écologiques naturels à préserver) ; de valeurs marchandes (les paysages « sublimes » comme ressources commercialisables par le tourisme ou l’industrie agroalimentaire) ; de valeurs patrimoniales (les paysages identitaires dont ceux qui doivent être transmis aux générations futures) ; de loisirs (le cadre « somptueux » des activités touristiques et récréatives) ; et d’habitat (le cadre approprié à un bien vivre).
Ces beautés utilitaires, impures, peu kantiennes, attestent plutôt du triomphe de l’agréable propre aux sociétés de consommation, en redéfinissant les normes du goût du beau. Plus près des expériences sensorielles et mentales de chaque posture paysagère que de l’universel kantien, ces nouveaux goûts paysagers privilégient le plaisir, les émotions, le jeu, la mémoire, la transmission, les identités sociales, l’utilité économique et sociale, la spiritualité et le bonheur. Ils témoignent de l’être là du désir humain de l’agréable.
Retour à la relativité du beau ? Peut-être pas. On assiste plutôt à l’émergence d’une nouvelle idée du Bien commun : un droit universel du désir d’être soi librement, et de penser ce qui peut être transmis aux générations futures.
Nul besoin donc de trancher entre le philosophe du jugement de goût et le sociologue de la distinction. Retour plutôt à la philosophie grecque. Aux idéaux de Platon : est beau ce qui est associé au bien et au vrai ? Ou à Epicure « nous disons que le plaisir est le principe et le but de la vie bienheureuse. C’est lui que nous avons reconnu comme bien premier, né avec la vie. C’est de lui que nous recevons le signal de tout choix et rejet » (Lettre à Ménécée) ?
A moins de s’en tenir à la résistance contre toutes les forces politiques et sociales qui tendent à normaliser le droit à la beauté. Dans La volonté de savoir (1976), Le philosophe Michel Foucault écrivait : « Le « droit » à la vie, au corps, à la santé, au bonheur, à la satisfaction des besoins, le « droit » à retrouver ce qu’on est et tout ce qu’on peut être (…), a été la réplique politique à toutes ces procédures nouvelles de pouvoir[3] qui elles non plus ne relèvent pas du droit traditionnel de la souveraineté ». Ce qui concernait la société européenne de la fin du XVIIIe siècle, mais reste aujourd’hui d’actualité.
[1] Cette chronique, sans prétention philosophique, s’appuie sur l’article de Luca Vercelloni, professeur à l’université des sciences gastronomiques de Pollenzo (Italie) : « la dichotomie chez Kant et le destin de l’agréable », in O. Assouly (édit.), Goûts à vendre, essais sur la captation esthétique, Institut français de la mode, Paris, 2007, pp. 75-90.
[2] Y. Droz, V. Miéville-Ott, J. Forney, R. Spichiger, Anthropologie politique du paysage, valeurs et postures paysagères dans les montagnes suisses, Paris, Khartala, 2009.
[3] M. Foucault analyse le rôle des institutions publiques comme l’armée, l’école, l’hopital, etc.
12 Décembre 2011
Peut-on transférer des modèles de paysage d’un pays à l’autre ? par P. Donadieu
Un modèle de paysage, rappelons le d’abord, est une organisation intentionnelle des formes perceptibles d’un lieu qui traduit les valeurs morales et esthétiques d’une culture de paysage. Hérités de l’histoire de la ville, les paysages de la banlieue sud de Hué au Vietnam, par exemple, sont fondés pour une part sur la géomancie (le fengshui), et pour l’autre sur l’urbanisme colonial français et l’évolution urbaine des anciens villages ruraux.
Ces modèles peuvent migrer à travers le monde comme en témoigne le modèle dit en damier de la structure spatiale de la ville coloniale française au Maghreb. Comme l’indiquent également l’architecture des maisons allemandes dans la ville de Blumenau au Brésil ou l’organisation des parcs urbains publics européens dits paysagers ou pittoresques au début du XXe siècle dans de nombreux pays des deux Amériques issues des colonisations : espagnoles à Buenos-Aires et la Plata, anglosaxonnes à New-York (Central Park) ou françaises au Maghreb et au Vietnam (ancienne Indochine).
C’est un fait historique, de mieux en mieux connu, que les colons européens ont apporté avec eux les formes paysagères, urbaines et rurales, de leur pays d’origine, comme en a témoigné pour l’Amérique du nord le géographe ethnologue américain J.B. Jackson (1909-1996). Ces héritages, surtout dans les anciennes villes coloniales, posent la question de leur appartenance possible à un patrimoine national et de leur transmission. Peuvent-ils être détruits ou au contraire érigés en témoins respectés de la mémoire du pays[1] ? Des institutions publiques internationales comme l’UNESCO peuvent-elles déclarer patrimoine mondial de tels héritages au nom du Bien commun universel ?
Car la migration des modèles paysagers est toujours un problème d’actualité. Pas seulement dans le domaine architectural (comme en témoignent les réalisations récentes dans les Émirats arabes unis et en Chine), mais également dans celui de l’urbanisme, du paysagisme et de la conservation de la nature. Le modèle des parcs naturels nationaux, une invention nord américaine, a migré, depuis la fin du XIXe siècle, dans la plupart des pays du monde, pour des raisons politiques et éthiques fondées sur des expertises scientifiques (la diminution de la biodiversité). En France, il a été renouvelé par celui des parcs naturels régionaux dont le succès invite à l’exportation de l’expérience dans d’autres pays.
De la même façon, des expériences réussies de politiques publiques périurbaines d’accueil des loisirs de plein air en Europe peuvent-elles être exportées sans précautions ?
Dans sa thèse de doctorat[2], Carolina Solar a montré les conditions politiques différentes des actions publiques agriurbaines et écologiques dans le parc de la Deûle à Lille et dans la commune de Versoix près de Genève. Dans ces deux périmètres, les exploitations agricoles ont été sollicitées avec succès par les pouvoirs publics locaux (l’Espace Naturel Métropolitain à Lille, le Canton à Genève), pour que les activités agricoles se tournent vers les marchés urbains ; pour que des actions de conservation de la nature, de diversification des activités (équitation et vente à la ferme dans les deux cas) et de création de réservoirs et de corridors de biodiversité puissent être menées à bien.
Est-ce que le succès de ces politiques publiques est suffisant pour justifier leur importation en tant que modèles pour penser les actions d’aménagement dans la petite région urbaine de Temuco au Chili dont C. Solar est originaire ? L’Araucanie, où est située la ville de Temuco (430 000 habitants), est localisée entre la Cordillère des Andes et l’Océan pacifique au sud du Chili. C’est aussi le territoire des derniers Indiens Mapuches et des reliques de la forêt tempérée australe. Autant de singularités culturelles et naturelles dans un vaste pays très centralisé qui suggèrent d’inventer une politique territoriale locale originale plutôt que de reproduire un modèle européen.
En préférant peut-être le modèle « territorialiste » de démocratie locale décrit par l’architecte et planificateur Alberto Magnaghi[3] en Italie à celui de l’Espace public métropolitain lillois (ENM). Ce syndicat mixte qui réunit depuis 20 ans 40 communes sur un total de 85 de Lille Métropole est l’outil de la gouvernance démocratique des réseaux d’espaces dits naturels dans la région lilloise (1 200 000 habitants). Certes, l’ENM est un instrument efficace de la gouvernance des espaces naturels lillois, mais il représente surtout l’aboutissement institutionnel d’un long processus local, politique, historique et social. Il en est de même à Genève avec le projet politique de renaturation Colvert-Versoix qui s’inscrit dans la culture naturaliste et paysagère helvétique.
Or l’espace enjeu du développement social et économique de la ville de Temuco est situé au nord de l’agglomération, dans la région de Nielo Rukamanqué, là où se concentrent à la fois les vestiges de la forêt tempérée, un vaste marais et les terres inaliénables des Mapuches. Il est certes possible d’envisager d’y reproduire le modèle politique de gestion des espaces naturels et agroforestiers genevois ou lillois, d’en utiliser le vocabulaire (couloir biologique, coulées vertes, trames vertes, continuités écologiques et paysagères, renaturation, vente directe, etc.), et de créer « un conseil des citoyens » à Témuco, pour instaurer une gouvernance locale démocratique et participative.
Cependant, puisque dans le « périmètre de transfert », à six kilomètres de la ville, il existe une « communidad mapuche » de 500 habitants, pourquoi ne pas chercher à savoir d’abord ce que dit cette communauté d’ « un projet d’intégration » ; et plus précisément à faire émerger un scénario bottom up de développement local. Car les Mapuches, animistes, ne disposent pas de la même cosmogonie que les descendants de la colonisation espagnole, ni des mêmes relations avec les milieux « naturels ». Car la nature des cultures « naturalistes » d’origine européenne n’est pas comparable avec celles des cultures traditionnelles extraeuropéennes, comme l’a montré l’anthropologue Philipe Descola (Par delà nature et culture, Gallimard, 2005).
Pour que la nature mapuche devienne une des sources d’inspiration d’un modèle de développement local, il semble nécessaire de la placer au centre d’un projet politique territorial qui se préoccupe de « protéger la nature » ; et pour cela d’en reconnaître les caractères culturels sans lesquels le sens des paysages ne peut être durablement construit sans risques, notamment celui de la « folklorisation » à finalité touristique.
[1] Je pense ici au classement du Théâtre municipal de Tunis, réalisé de 1900 à 1902 par l’architecte français Jean-Emile Resplandy. Il a été classé monument historique en 1992 et rénové en 2001 (J. Hueber et C. Piaton, Tunis, Elyzad, Tunis ; Honoré Clair, Arles, 2011.)
[2] C. Solar, Principes théoriques et contextes sociopolitiques de la connectivité des réseaux paysagers périurbains, Thèse de doctorat ENSP/AgroParisTech, 2011.
[3] A. Magnaghi, The urban village, a charter for democracy and local self-sustainable development, E. Goldsmith, Zed Books, 2005.
28 novembre 2011
Paysages sans horizons. Suffit-il de marcher pour penser le paysage ? par P. Donadieu
Quand on demande à 24 étudiants en paysage et en géographie (master 2) d’élaborer de courts récits (paroles et images) de huit parcours pédestres de deux heures dans les campagnes périurbaines à l’ouest de Versailles, on obtient un résultat qui mérite l’analyse.
Appuyés sur des images de contenus très variables (strictement documentaires à fortement esthétisés), les récits de chaque expérience collective (2 à 4 étudiants par groupe) traduisent d’abord des affects. L’espace des marcheurs est inscrit dans des temporalités appelées souvent séquences, qui traduisent des sensations et des impressions différentes selon les espaces traversés (campagne, ville/village, forêt). En raison de la présence générale d’un brouillard épais, qui a tardé à se lever ce matin là, les mots comme les images expriment un sentiment général de perte de repères et d’inquiétude. Le vocabulaire est surtout celui des émotions plutôt déplaisantes (étonnement, inquiétude, surprise, peur, fatigue, isolement, solitude, mal-être. La vue (limitée) ne s’impose plus aux sons et aux odeurs. Le corps tout entier enregistre l’espace de la marche : enfoncement, immersion, bulle, vide, perte de repères, étroitesse, mais aussi sa spiritualisation (mystique) avec également des intentions (plus rares) de prise paysagère, de saisie constitutive d’un motif paysager : vertical/horizontal, limite/continuité (entre champs et bâtis par exemple), percée visuelle dans les jardins, dévoilement de l’horizon, etc.
Cependant ces courtes histoires de vie dans les brumes matinales de novembre ne se limitent pas au vocabulaire des émotions incorporées et des ambiances ressenties, elle s’accompagnent de jugements. Et pour cela mobilisent des valeurs éthiques et esthétiques qui distinguent des formes d’espaces physiques. Beaucoup ont posé les questions critiques de la séparation (haies, murs), de la transition ou de la continuité (percée visuelle, lien matériel) entre les espaces publics et privés : de l’équité d’aménagement des espaces publics entre les quartiers, de la malpropreté des rues et des chemins, des nuisances acoustiques dans les lotissements comme dans les forêts (voitures, tronçonneuses, tondeuses), de l’inanimation des rues et des places désertes ; de l’incohérence architecturale des différents quartiers résidentiels ; de la négligence des mémoires urbaines récentes (anciennes usines, vieux marchés) au profit de l’histoire plus ancienne (lavoir cosy, châteaux somptueux convertis en hôtels, etc.), de l’ensauvagement des boisements, de l’être excédé entre le trop de signes (signalétique, sécurité) et le pas assez (de bancs, de sentiers piétonniers, de belvédères), etc.
Un véritable savoir sensible/sensoriel est ainsi constitué à partir de l’expérience de la marche curieuse, des affects qu’elle suscite et des valeurs esthétiques et morales qui permettent d’en juger. Il témoigne de moments vécus associés à un parcours (ou de séquences d’espaces inscrites dans le temps de la promenade). Collectif et communiqué (formé) par les mots et les images, il révèle une subjectivité partagée et objectivable, dans la mesure où les affects et les jugements sont les mêmes ; il permet à des intentions localisées de projet d’émerger sans passer par les concepts des savoirs savants qui analysent, fragmentent et donc séparent. Cette connaissance est d’abord une reconnaissance immédiate par les corps sensibles, séparée de l’érudition de l’analyse scientifique. Cependant, si l’interprétation des spatialités vécues fonde pertinemment la pratique des architectes et des designer, elle n’en est pas pour autant suffisante pour comprendre et surtout pour agir. Il lui manque autant l’explication juste de ce qui est perçu, que l’imagination qui en dépasse les données immédiates ou construites.
D’abord, l’espace du marcheur n’est pas celui de l’habitant ou de l’agriculteur. Le corps de l’habitant est centré habituellement sur des lieux organisés à partir de son pavillon ou de son appartement : la gare, l’école, le centre commercial, la maison médicale, le boulanger, le cinéma, le terrain de sports, etc. ; celui de l’agriculteur à qui est également un habitantà à partir de sa ferme, de ses champs et de ses serres. Leurs postures paysagères, dans la plaine de Versailles, peuvent être multiples selon leurs activités : cultiver, chasser, aller chercher les enfants à l’école ou s’approvisionner, mais aussi se promener en marchant ou à bicyclette. La marche n’est qu’une pratique spatialisée parmi d’autres et la promenade en ville ou à la campagne qu’une modalité de marche. Les étudiants marcheurs ne peuvent donc se fonder sur leurs seules expériences pédestres pour rendre compte à de manière experte et fiable à des spatialités possibles. Même si, à marches et trajets proches, les impressions ressenties seront sans doute très comparables à celles des autres marcheurs.
Car la compréhension des paysages traversés ne peut se limiter aux sensations instantanées du corps, lesquelles ne révèlent pas les modes d’organisation spatiale et les forces qui produisent les formes. Les sens et l’intuition peuvent tromper, et souvent ce qui n’est pas connu n’est pas vu et identifié. Les champs sont réduits à des mosaïques de formes colorées, et les arbres à des verticales étranges. Ce qui se donne à percevoir est alors réduit à une sensation dont le jugement hâtif n’est pas mis en doute. Et le risque d’erreurs ou d’imprécisions devient élevé.
En outre, en l’absence de recherches d’explications (des causes et des effets) de ce qui est perçu, il est difficile de comprendre les contrastes sociaux visibles entre les lotissements et les immeubles d’habitants aisés du nord de la plaine (Saint-Nom-la-Bretèche, Noisy-le-Roi et leurs golfs) et ceux plus diversifiés du sud (Fontenay-le-Fleury, Villepreux, Plaisir). Si le marcheur est aussi curieux qu’un flâneur averti, il peut également interpréter ce qui se donne à lui, sans toutefois en saisir un sens autre que celui qu’il construit intuitivement. Et s’il le fait c’est alors à partir de modèles hérités et de souvenirs personnels.
Inconsciemment, chaque marcheur met en œuvre, pour lui, ses modèles d’interprétation des paysages et des lieux. Il ne cherche pas les champs de X agriculteur, mais un fragment idyllique de campagne ; il ne voit pas le pavillon de Y, habitant la Haie Bergerie à Villepreux, mais un morceau hétéroclite de ville dortoir, désert et inhospitalier. Il ne se sent pas bien dans la forêt domaniale, car il la perçoit ensauvagée (traces de la tempête de 1999) et troublée par le vacarme des tronçonneuses. De plus, dans le brouillard épais, les lieux pittoresques qu’il recherche, sciemment ou non, (lavoir, vieux ponts, parcs et châteaux historiques) sont plutôt rares.
Enfin, les spatialités constituées à partir des seules sensations de la marche ne révèlent rien de l’espace social et politique de la plaine : des tensions et des conflits sociaux qui s’y nouent et s’y dénouent ; des projets publics qui tentent de s’y déployer et des projets associatifs des habitants qui s’y confrontent. Or le sens des paysages entre aperçus est également celui de leur devenir : des projets des acteurs de la mise en patrimoine commun (l’association patrimoniale de la plaine de Versailles et du plateau des Alluets) ; du projet d’historicisation de l’ancien parc royal de chasse par le Domaine national du château ; de la naturalisation des rus et des mares villageoises et forestières ; de la mise en tourisme (hôtellerie) et en loisirs (équitation) de la plaine ; de la protection stricte des sols agricoles et forestiers menacés par l’urbanisation, etc.
En résumé, en l’absence d’affects reconnus dans la perception des paysages, l’interprétation des spatialités et des temporalités vécues manque la poésie du monde habité. Et, dans ce cas, en l’absence d’explications conceptualisées de son devenir et de valeurs morales, on ne sait ni l’agir ni le maîtriser correctement, puisqu’on méconnaît les forces sociales et politiques qui le mettent en formes.
Avec ou sans brumes, les paysages des marcheurs paysagistes n’ont en fait d’horizons communs de sens que poétiques. Ce qu’il appartient aux professionnels du paysage, avec les habitants, de révéler autant que de vérifier.
21 novembre 2011
Pourquoi le paysagisme n’est pas soluble dans l’architecture et l’urbanisme ? par P. Donadieu
Les politiques publiques de paysage, du moins en France, ne sont pas des politiques sectorielles. Comme le sont les politiques environnementales, de la sécurité publique ou de l’équipement. Transversales à celles-ci, elles ont vocation à introduire les qualités matérielles et immatérielles nécessaires aux milieux de la vie humaine, mais également végétale et animale. Pour autant cette intégration des valeurs esthétiques, symboliques et éthiques aux constructions territoriales n’a pas pour finalités de faire disparaître la compétence paysagiste àdu concepteur ou de l’ingénieur à dans celles de l’architecte et de l’urbaniste. En d’autres termes d’abandonner le savoir-faire paysagiste aux métiers qui en sont les plus voisins, mais n’y sont pas le plus souvent préparés.
Cette autonomie a été institutionnalisée au niveau mondial par la création de l’IFLA (International federation of landscape architects) en 1948. Elle ne saurait être remise en question même si la tentation est grande. Dans les pays circumméditerranéens, par exemple, les métiers du paysagisme sont restés très proches de l’horticulture. Ce qui se traduit par le développement de la formation au design et au planning paysagiste dans les écoles d’architecture, d’urbanisme et de planification territoriale. Et reste d’ailleurs conforme aux expressions qui désignent ce domaine : historiquement landscape architecture, et plus récemment landscape urbanism. En dépit de cette tendance discutable à la confusion des métiers de la conception de projets, plusieurs raisons permettent de penser que l’autonomie théorique et pratique du paysagisme restera nécessaire.
D’abord, il n’est pas possible de penser un espace en tant que paysage de la même manière qu’un objet architectural. Le premier est un espace relationnel dont les formes et le sens changent avec les processus culturels et naturels qui les produisent. Alors que les formes de l’objet architectural dépendent surtout de ses fonctionnalités internes, et beaucoup moins de son inscription intentionnelle dans un espace relationnel. Ce qui réduit alors la notion de paysage, soit à un espace vu par et pour les usagers de l’édifice, soit à une mise en scène de celui-ci à l’intention d’un public. Cette réduction (phénoménologique) à l’apparaître n’est qu’une dimension de la notion complexe de paysage, nécessaire mais pas suffisante à la compréhension des processus en jeu.
Une deuxième raison tient à la distinction nécessaire entre les projets urbains et territoriaux d’une part et les projets de paysage d’autre part. Car ces derniers en constituent, sous la forme du plan de paysage notamment, l’ossature (la charpente) nécessaire à la mise en place de l’infrastructure non construite de la région urbaine (trames vertes et bleues, ceinture vertes, etc.). Afin d’installer les conditions matérielles et immatérielles du bien-vivre local (sécurité de l’espace public, identité, mémoire, beauté, accessibilité, diversité, etc.), les politiques paysagères proposent des règles (conservation, réaffectation, restauration, création) de production des formes et fonctionnalités de l’espace. Elles doivent également en proposer une gouvernance démocratique dans le cadre par exemple des chartes de paysage. C’est pourquoi, les compétences paysagistes ne peuvent être confondues avec celles de l’urbaniste qui élabore les projets urbains et territoriaux : démographie, économie, droit, sociologie, géographie, etc.
Admettons enfin qu’il n’est pas éclairant, d’un point de vue épistémologique et pratique, de dissoudre les paradigmes paysagers les uns dans les autres. Le paysage des paysagistes designers est surtout phénoménologique et herméneutique. Il n’explique pas les processus producteurs de formes, mais donne à comprendre et à interpréter autant ce qui est là que ce qui pourrait y advenir. En revanche, le paysage des ingénieurs paysagistes explique ce qui est là pour en prévoir l’évolution matérielle et chercher techniquement à l’infléchir. Ou bien à le construire selon la commande d’un client. Ou encore à le gérer pour un service public.
Construction sociale et culturelle, le paysage des géographes peut être réduit à ses sens esthétique, écosymbolique, ou encore territorial (l’appartenance, l’appropriation). Il explique autant qu’il interprète (géographies humaniste et culturelle). Visant la compréhension (expliquer et interpréter), il ne permet pas l’action à la façon du designer et de l’ingénieur.Il est différent du paysage des écologues (landscape ecology) qui s’attache à interpréter les flux biologiques au moyen du triptyque conceptuel de matrice-tâche-corridor à l’échelle fonctionnelle du paysage physique.
D’autres champs de savoirs et de savoir-faire ont pris comme objet le paysage. Les uns sont proches des concepteurs comme les artistes (peintres, photographes, sculpteurs) et les écrivains, les autres des scientifiques à la manière par exemple des archéologues, des historiens ou des agronomes.
Plus on confond les différents paradigmes paysagers, plus la notion se vide de ses sens possibles et se réduit à un slogan obscur de communication. Plus elle est spécifiée par rapport à des concepts de connaissance (et non seulement de projet), plus elle acquiert une efficacité cognitive (comprendre) et opérationnelle (agir).
C’est pourquoi, la confusion paresseuse ou naïve des acceptions possibles de la notion de paysage ne clarifie pas le discours des architectes, des urbanistes et des paysagistes. Elle contribue souvent à réduire le paysagisme à l’écologie, l’environnement, l’horticulture et le jardinage, fut-il paysagiste, et parfois aux arts plastiques. Alors que leur articulation, correctement pensée, apporte aux acteurs des projets les savoirs et les savoir-faire de chacun. Ce qui sert les intérêts des métiers du paysage, et restaure leur singularité, sans nuire à ceux des habitants et des usagers de l’espace qui doivent en être les premiers bénéficiaires. On l’oublie trop souvent !
Car l’usage du mot paysage renvoie, dans toutes les cultures, à plusieurs épistèmé et la plus méconnue d’entre elles est presque toujours celle des habitants au profit des expertises, scientifiques ou non, sur lesquelles s’appuient les décideurs politiques. Il est probable que la légitimation de la décision publique (la gouvernance des projets) devra de plus en plus s’appuyer sur le débat public démocratique. Ce qui veut dire que les paysages des habitants deviendront de plus en plus centraux dans les processus de projet. Et que l’expertise des concepteurs : architectes, urbanistes ou paysagistes en sera modifiée d’autant.
31 octobre 2011
Les parcs publics urbains sont-ils des régulateurs de la qualité de vie citadine[1] ? par P. Donadieu
Depuis le XIXe siècle, les parcs et les jardins publics font partie de l’organisation de l’espace des villes. Ils sont également présents dans les grandes métropoles du XXIe siècle. Certaines capitales comme Beyrouth au Liban ou Maracaibo au Vénézuéla en sont presque dépourvues, d’autres en Europe : Vienne, Zurich ou Londres en regorgent.
Il est admis en effet, et de plus en plus montré scientifiquement, que les bienfaits environnementaux des espaces végétalisés et aquatiques urbains et périurbains pour la santé humaine, sont indéniables. Car ils atténuent les pollutions de l’air, les nuisances sonores, et réduisent les pics de chaleur comme de froid, sans compter leur rôle dans la captation du carbone pour contribuer à la diminution du réchauffement climatique. Plus ils sont importants et reliés entre eux, plus les réseaux verts et aquatiques des régions urbaines jouent un rôle environnemental efficace, notamment en matière de maintien ou d’enrichissement de la biodiversité urbaine végétale et animale.
La ville idéale d’un point de vue écologique est verte. Elle fait une large place à la restauration des milieux naturels et de la biodiversité, à la réduction des risques naturels et environnementaux, à l’économie d’énergies et de l’eau, au recyclage des déchets, et aux agricultures et jardinages de proximité. Mais ce n’est qu’une partie des fonctions des infrastructures vertes et aquatiques des régions urbaines.
Car les parcs et les jardins publics sont également et surtout des espaces sociaux. Dans la mesure où ils peuvent y accéder facilement, les citadins y trouvent ce qu’ils n’ont pas nécessairement là où ils sont logés. D’abord des lieux sécurisés équipés pour les loisirs et les sports extérieurs, passifs (les bancs) ou actifs (les allées de promenade ou de jogging, les jeux pour enfants, les terrains de sports de balle, de gymnastique, etc.).
Mais au-delà de ces activités qui répondent à une demande sociale de lieux de loisirs et de détente, le parc apporte en principe les conditions matérielles des sensations de bien-être, individuelles ou collectives (de la famille, du couple, du groupe). Ces impressions apparaissent avec le changement de milieu (du bruit au calme, de l’isolement à la socialité publique par exemple). Elles sont liées à des caractères sensoriels distincts du cadre habituel de vie : la fraîcheur et la pureté de l’air, les parfums des fleurs au printemps, des couleurs des feuilles en automne, la musique d’une cascade, le chant et le vol des oiseaux, etc. Ces traits sont perçus globalement surtout avec les sens visuel, auditif et olfactif. Ils sont incorporés à soi en tant qu’impressions éphémères de bien-être (ou parfois de mal-être), et mémorisés surtout s’ils sont remarquables et rares.
Très recherchées, ces moments d’émotions, légères ou intenses, individuelles ou collectives, font parties des services attendus des parcs publics. Cependant, en fonction de l’intensité du contrôle social formel (gardien, règlement d’usage) ou informel (code social de bonne conduite), des sentiments d’insécurité réelle ou imaginaire peuvent apparaître. Ne serait-ce qu’avec des rumeurs localisant des actes incivils (violences verbales ou physiques) ou illicites (vente de drogue, prostitution active).
Or, même dans les cas où l’idéal du jardin harmonieux et paisible s’éloigne de l’usager, le parc conserve son rôle de lieu nécessaire de liberté et de sociabilité. Quand les tags couvrent les murs, que les mobiliers sont détruits et que la surveillance cesse, le parc peut conserver son rôle de refuge public pour ceux que la société marginalise (les chômeurs, les handicapés, les personnes seules, les clochards, etc.). Sauf si on le ferme parce que ces usagers excluent ceux qui sont attendus (les familles avec enfants par exemple) et parce que l’ordre public semble alors remis en cause.
Quand se raréfient les massifs fleuris et s’accumulent les déchets, quand les bassins sont vides et les bancs endommagés, le parc certes devient moins attractif. Néanmoins, il accueille toujours les couples d’amoureux, les lycéens qui révisent leurs leçons, les hommes sans travail, les adolescents inoccupés, les homosexuels, les réfugiés politiques : tous ceux que les logements trop exigus, ou le milieu familial trop contraignant, exile vers l’extérieur, vers le parc qui les accueille sans discrimination sauf s’il est payant. Tous ceux qu’une société urbaine n’accueille pas correctement dans l’espace public (la rue, la place, le café) du fait de ses normes sociales de conduites civiles. Ce bien-être relatif est sans comparaison avec les émotions que peuvent procurer le jardin-paradis, modèle des créations paysagistes. C’est surtout un mieux-être dans un refuge qui vaut autant, moralement parlant, que le lieu recherché par les amateurs d’émotions jardinières.
Cette fonction sociale du parc est parfois reprise par certaines municipalités (à Paris notamment) sous la forme des jardins partagés et des jardins communautaires. Avec l’aide d’associations (ONG), des petits jardins sont créés pour d’abord accueillir dans un havre social, les exclus de la vie et de la ville, mais aussi pour installer un lieu permanent de convivialité autour de l’idée et de la pratique du jardinage collectif.
Le parc public n’est pas seulement un lieu propice à une meilleure santé, aux plaisirs des jardins, à la détente (se déstresser), à la rencontre de l’ Autre ou du Même (celui qui nous ressemble). Ce type de lieu est tout autant une vaste scène publique pour les citadins. Pour écouter des concerts, assister à une pièce de théâtre, contempler les scènes jardinières et pour les plus jeunes hommes draguer les jeunes filles. Comme de tous temps, surtout à partir du XIXe siècle, le parc public est le lieu où l’on se montre, et où on regarde l’Autre selon des règles convenues de spectacle et de séduction. C’est aussi par extension l’espace public où l’expression sociale collective peut se manifester, comme dans les cortèges rituels de grèves, et plus récemment dans les révolutions arabes (la place Tahrir au Caire, l’avenue Bourguiba à Tunis).
Pour toutes ces raisons, les parcs publics sont soumis à un contrôle puissant des États et des pouvoirs urbains. Surtout là où l’ordre public symbolique doit régner, dans les quartiers gouvernementaux, de banques et de résidences de haut standing par exemple, beaucoup moins en général dans les quartiers modestes ou pauvres. Ce contrôle s’exprime par la présence de marqueurs publics que sont les arbres et les arbustes, les massifs fleuris, les fontaines, les bassins, les bancs et les lampadaires, et d’autant plus qu’ils sont soigneusement entretenus.
C’est pourquoi les espaces verts publics sont profondément ambivalents. Ils s’adressent autant aux pouvoirs publics qui en tirent parti dans leur programme politique, aux usagers qui en ont besoin, et à la collectivité urbaine qui en bénéficie. De ce fait ils constituent autant un bien public géré par les autorités territoriales qu’un bien commun à ces autorités et aux usagers qui les fréquentent.
Quand ils sont gérés par des entreprises privées qui en limitent l’accès par des droits d’entrée, les usagers du bien commun[2] paysager sont réduits à ceux qui peuvent payer. Dans ces conditions le pacte social implicite de garantie de la communauté de biens (les parcs) qui lie les autorités territoriales avec les habitants est rompu, puisqu’une partie d’entre eux en est exclue. Alors ces parcs publics ne jouent plus leur rôle de régulation des sociétés urbaines et de leur cadre de vie. Pour des raisons financières, les processus de ségrégation sociale par la limitation à l’accès de l’espace vert sont ainsi introduits. Aussi est-il préférable de garder ouverts tous les parcs et jardins publics, quels que soient les quartiers, à partir de principes de conception et de gestion beaucoup plus simples et moins coûteux que ceux utilisés aujourd’hui.
[1] D’après la thèse de doctorat de Besma Loukil « Civilités et incivilités dans les parcs publics urbains dans le nord est de la Tunisie), Université de Sousse/AgroParisTech, 2011.
[2] Le bien commun est ici défini comme la valeur ou le service qui est l’enjeu d’un échange entre deux parties : par exemple celui de la santé entre le médecin et son patient, ou de la formation entre l’enseignant et son élève. Le bien commun se traduit par une communauté de biens matériels et immatériels propres à un groupe qui en fait usage.
Le bien public est un bien commun placé sous le contrôle exclusif ou partagé des pouvoirs publics.
17 octobre 2011
Peut-on s’opposer à l’opinion habitante ? par P. Donadieu
Dans une démocratie, il semble difficile pour un gouvernement de s’opposer aux opinions majoritaires, et aux élus d’aller contre celles de leurs électeurs. C’est pourquoi l’évolution des paysages reflète, en France du moins, beaucoup moins les politiques de qualité paysagère que l’Etat tente de mettre en place, que les réalités politiciennes locales. Car, dans chaque circonscription électorale, les gouvernants ont été élus pour mettre en œuvre les orientations politiques qui les ont portées au pouvoir.
Or l’appréciation des paysages (en pratique du cadre de vie) par les habitants d’une commune dépend surtout de la satisfaction de leurs intérêts particuliers. Par exemple, pour les propriétaires en vendant leurs terrains non construits pour l’urbanisation, et pour les habitants en s’opposant à cette évolution qui pourrait selon eux déprécier leur cadre de vie et leur capital immobilier. Selon les résultats des élections, les uns ou les autres seront favorisés, et le bien public confondu selon les cas avec une offre plus grande de logements, ou bien avec le profit qu’une majorité d’habitants tire de paysages protégés de l’urbanisation[1].
L’égoïsme des citoyens peut nuire à une action publique qui en dépend trop, écrit Michel Eltchaninoff[2], en s’appuyant sur le philosophe anglais Thomas Hobbes (1588-1679). Car, s’il n’y a aucun dirigeant pour faire valoir àquel que soit le niveau d’exercice du pouvoirà les biens et les maux communs à tous, la gestion des affaires publiques restera soumise à des oligarchies et de ce fait sera fortement handicapée.
Dans ces conditions créées par les règles de la démocratie, notamment en Europe, est-il possible que « la gestion des paysages comprenne les actions visant, dans une perspective de développement durable, à entretenir le paysage afin de guider et d’harmoniser les transformations induites par les évolutions sociales, économiques et environnementales » (article 1 de la convention européenne du paysage de Florence de 2000) ? La qualité des paysages peut-elle refléter « les aspirations des populations en ce qui concerne les caractéristiques paysagères de leur cadre de vie » ?
Autrement dit, les règles de protection et de construction des paysages énoncées par les paysagistes dans les atlas, plans et chartes de paysage, et reprises en principe dans les documents d’urbanisme, peuvent-elles être appliquées correctement ? Rien n’est moins certain. Pourquoi ?
Parce que, entre les recommandations d’un paysagiste et les prescriptions urbanistiques opposables à un tiers, s’interposent de nombreux filtres qui déforment ou annulent les propositions. Ceux notamment des élus des collectivités publiques (de l’intercommunalité à la commune) qui les sélectionnent et les interprètent.
Parce que ces recommandations ne sont pas toujours suffisamment précises, ou compréhensibles, pour être suivies d’effets opérationnels, par exemple en demandant de se préoccuper de « la qualité architecturale » ou de « la biodiversité » sans autres détails.
Parce que les prescriptions ne s’appuient pas souvent sur les acteurs locaux, sauf quand des lobbies (associations, organisations professionnelles) font valoir leurs intérêts. Par exemple les viticulteurs dans le Bordelais pour protéger le foncier viticole.
Et surtout en raison de l’absence d’évaluation prévue de l’efficacité de ces politiques publiques, qui, il faut l’admettre, n’ont pas été en général élaborés pour l’être.
Pourtant les politiques paysagères contribuent utilement à la mise en formes volontaire (et non subie) du cadre de vie. D’abord parce qu’elles obligent les élus à prendre conscience des évolutions tendancielles des paysages et de leurs conséquences sur la qualité des cadres de vie des habitants. C’est le cas de la déprise industrielle et militaire, et des friches désolants qui en résultent. Du fait également des risques locaux encourus dans le domaine environnemental (enfouissement non ou mal contrôlé de déchets par exemple), social (ségrégation des quartiers) ou économique (diminution des emplois).
En faisant savoir de plus aux conseils municipaux que la qualité de vie communale ne tient pas seulement à des équipements sophistiqués, à l’absence apparente de risques et au plein emploi des résidents, mais également à la possibilité pour les habitants d’accéder facilement à et de s’approprier (symboliquement) une grande partie d’un territoire attractif via les espaces publics (trames vertes et bleues).
Cependant, force est de constater que l’effectivité de ces politiques paysagères est souvent manifeste dans les centralités emblématiques des grandes métropoles (comme à Bordeaux, Lyon ou Nantes), mais se dissout dans les petites communes périurbaines moins fortunées et éclairées.
Est-il possible dans ces conditions de s’opposer à des actions publiques qui oublient ou négligent l’intérêt commun local ou global des habitants ? Faut-il un despote conseillé par ses techniciens experts pour imposer le bien public à tous, ou bien se satisfaire d’une girouette empathique avec tous, et de ce fait nécessairement inefficace ?
Le philosophe M. Eltchaninoff rappelle que l’Athénien Péricles, au Ve siècle avant notre ère, « grand démocrate et dirigeant à forte poigne » avait dirigé sa cité pendant plus de trente ans. Il y parvenait car, en maintenant la même orientation à une politique approuvée par le peuple, il savait rappeler à ce dernier l’inconstance de ses opinions soumises à ses passions et non inspirées par l’intérêt de la cité.
Aujourd’hui, les élus, souvent mal éclairés, peinent à faire de la qualité du cadre de vie une valeur citoyenne des habitants, et au nom de celle-ci à affronter l’opinion publique et les intérêts particuliers (des propriétaires et des lobbies économiques notamment). Ce qui est pourtant possible quand l’exercice du pouvoir local est fondé sur un véritable débat citoyen et sur la confiance établie entre administrés et élus.
Sans cette confiance établie par une participation attentive des habitants aux prises de décisions publiques, sans l’intervention de médiateurs (paysagistes ou non) qui écoutent la parole citoyenne autant que technicienne, il est difficile de donner à l’action publique paysagère la légitimité que l’élu éclairé en attend. En l’absence de cette légitimation, les mots juridiques de la Convention, qui appellent à l’expression locale démocratique et libre, resteront lettre morte.
Rappelons avec Thomas Hobbes que « c’est l’autorité, non la vérité, qui fait la loi ». Le charisme politique compte plus que l’expertise technique, et la volonté plus que la raison[3]. En d’autres termes, l’élu comme les techniciens devraient savoir écouter les opinions habitantes, et décider, en s’opposant si nécessaires aux avis égoïstes, des actions publiques paysagères effectives qui conviennent à une majorité. Celles-ci devraient tendre davantage vers les valeurs de bien commun local (ce qui est créé par le débat public fructueux). Plutôt que vers la satisfaction des objectifs et des finalités étatiques qui restent souvent discutables (la normativité excessive des lois Grenelle en témoigne) ou floues dans ce domaine.
[1] Didier Labat, « titre »Thèse de doctorat à soutenir en novembre 2011, AgroParistech/école doctorale ABIES.
[2] Michel Eltchaninoff, Philosophie Magazine n° 53, pp. 42-43
[3] Martin Legros, Philosophie Magazine n° 53, 2011, p. 41.
3 octobre 2011
Marcher pour penser le paysage ? par P. Donadieu
Tous les paysagistes connaissent l’importance de la marche pour découvrir un site afin de le comprendre pour l’aménager, le conserver ou le restaurer. En l’arpentant soigneusement, en le parcourant en tous sens, ils en découvrent les qualités et les caractères formels qui leur permettront de fonder un projet. Il est peu pensable pour eux d’élaborer un projet sans avoir vu le site ; ce qui se faisait pourtant autrefois dans le domaine des jardins et favorisait la diffusion à travers le monde de modèles comme celui du jardin paysager.
Penser en marchant permet d’abord d’oublier ce qu’on a lu, écrit et appris ; et « au corps de s’éveiller aux possibilités spirituelles que délivrent la lenteur, la régularité, la patience de la marche et qui informent la pensée »[1]. Mais surtout, elle ouvre le marcheur, flâneur, promeneur, randonneur ou explorateur aux sensations de son corps, et donc à une connaissance immédiate du monde externe, qui se confond avec son monde propre. Ces sensations vécues (les excitations des sens), sont issues de causes internes, organiques (la faim, la soif, la fatigue par exemple) et externes (la peur, l’étonnement, la curiosité, le plaisir etc.).
Or les sensations, qui sont par nature physiologiques (je vois si je ne suis pas aveugle, et j’entends si je ne suis pas sourd), conditionnent les perceptions, lesquelles se confondent chez Kant avec leur conscience empirique sous formes de représentations. Je perçois des formes que je nomme « des arbres verts », parce que je dispose dans ma culture et dans ma langue des mots et des concepts d’arbre et de vert. Lesquels ne me suggèrent aucune intention d’agir sur ces arbres, sinon peut-être de les contempler. Si on adopte un point de vue phénoménologique, celui de Jean-Paul Sartre dans L’Être et le Néant[2] en particulier, sensation, perception, connaissance et action sont rassemblées, sinon confondues.
La pensée phénoménologique, depuis les travaux du philosophe allemand Edmond Husserl (1859-1938), rappelons le, propose de mettre entre parenthèses l’existence du monde réel objectif (Ce qui est désigné par épochè ou réduction). Ceci afin d’établir une compréhension plus juste de notre relation consciente à nous-même et au monde. En regardant, écoutant, (etc.) consciemment et intentionnellement le paysage qui se déploie devant lui, le marcheur s’inscrit dans un espace « originel » que Sartre appelle un « espace hodologique » notion qu’il emprunte au psychologue Kurt Lewin (1890-1947)[3]. Connaissance et action sont les deux faces abstraites de cette relation qui implique le corps percevant dans le monde réel. Dans l’espace hodologique, le corps, parti d’un « complexe ustensile », est l’instrument nécessaire de l’action humaine, de l’engagement politique dans le monde et de sa transformation sociale et technique.
Mais il y a plusieurs façons de marcher. Emprunter une route déjà faite et parcourue, ou bien tracer un cheminement nouveau en terre méconnue, aboutit à des expériences différentes comme l’analyse Gilles Tiberghien dans les Carnets du paysage[4]. Ou encore rechercher les forêts profondes et silencieuses, arpenter les déserts inquiétants, conquérir les sommets des montagnes ou flâner dans d’imprévisibles villes. Et pour cela inventer par les cartes et les guides les déplacements potentiels des voyageurs et des touristes. Car le corps du marcheur, pour Sartre, n’est pas séparé du monde comme l’affirment la plupart des sciences. Même dans les situations les plus surplombantes et les plus contemplatives, l’espace hodologique est vécu activement ; il est résistant à donc objectif à à l’action et au mouvement, et s’offre comme porteur de potentialités d’actions futures[5] .
Penser le paysage en marchant supposerait donc de s’inscrire dans l’espace hodologique, qui n’est pas un espace scientifique et technique, mais permet l’expression d’une connaissance sensible et coenesthésique de l’espace arpenté. Or l’espace scientifique et technique est précisément celui de la pensée qui rationalise, explique, calcule, prévoit et propose. Elle dispose et invente des connaissances et des savoir-faire pour l’action politique et technique. Si le marcheur est un paysagiste qui reconnaît un site à aménager, il cherchera à établir des solutions de continuité entre ses affects (impressions, émotions, sentiments), ses savoirs (scientifiques ou non), ses intentions et les outils techniques (terrassement, plantation, construction, etc.) qui lui seront ensuite utiles pour en transformer les apparences.
Si, comme le suggère Sartre, agir c’est « être-dans-le-monde et être-instrument-au milieu-du-monde »[6], le projet d’action technique (aménager) devrait procéder d’un projet distinct et abstrait de conception (penser l’aménagement en fonction de ses objectifs). Ce dernier projet est déterminé par un corps sensible, singulier et objectif (celui du paysagiste), qui se substitue, par principe, aux corps des usagers futurs de l’espace aménagé. Car, écrit le philosophe de l’existentialisme « la relation du corps-point-de-vue aux choses est une relation objective, et la relation de la conscience au corps est une relation existentielle » (369). Autrement dit, c’est l’expérience du corps sensible et intentionnel qui devient dans le monde paysagiste la mesure universelle du monde vécu.
C’est pourquoi, pour ressentir la singularité du site ou du territoire à afin d’éviter la standardisation des solutions d’aménagement à il est nécessaire de les arpenter, pour en incorporer les sensations, afin d’ agir l’espace matériel et le penser comme devant ou pouvant devenir autre ou rester le même. Supprimer un écran visuel, dégager un cône de vision, valoriser un lieu riche de sensations, faire voir, souligner, montrer, désigner, ou bien masquer, dissimuler, ou encore découvrir, dévoiler, imaginer, inventer. Le vocabulaire paysagiste de la marche inspirée est celui de la scénographie, du design et de la création, de la poésie et du théâtre autant que de la littérature et des arts visuels.
Faut-il refermer la parenthèse phénoménologique de la marche paysagiste ? Car son articulation avec la culture scientifique de projet (l’ingénierie) ne va pas de soi. Le retour au réel met-il fin aux rêves des paysagistes arpenteurs ? Les intuitions créatrices de la pensée projectuelle par le corps sensible ont en effet des limites. Les mondes désirés des usagers de l’espace public et de ses gestionnaires, par exemple, entrent parfois en conflit, comme l’ont montré les révolutions des pays arabes. Ne doit-on pas mieux connaître, comprendre et interpréter un espace public avant de le transformer pour le contrôler ? D’autres formes de pensées du paysage existent, qu’il nous faudra découvrir.
Cependant, et comme le pratiquaient le poète anglais William Wordsworth (1770-1850) et le philosophe allemand Friedrich Nietzche (1844-1900), plus les hommes arpenteront le monde et plus les gouvernants devront rendre des comptes à ceux qui l’ habitent, du moins dans des Etats démocratiques. C’est ce que Jean-Paul Sartre[7] avait imaginé avec l’idéologie engagée de l’existentialisme comme humanisme.
[1] Frédéric Gros, La voie du corps, (propos recueillis par P. Nassif), Philosophie magazine n° 52, 2011, pp. 40.
[2] Jean-Paul Sartre, L’Etre et le Néant, essai d’ontologie phénoménologique, Tel, Gallimard, Paris, 1946.
[3] Jean-Marc Besse, Quatre notes conjointes sur l’introduction de l’hodologie dans la pensée contemporaine, Les Carnets du paysage, n° 11, pp. 26-33.
[4] Gilles Tiberghien, Hodologique suivi de quatre notes conjointes, Les Carnets du paysage, Cheminements, n° 11, pp. 7-33.
[5] J.-M. Besse, op. cit., Les Carnets du paysage, pp. 29-30.
[6] J.-P. Sartre, op. cit., p. 365.
[7] Jean-Paul Sartre, L’existentialisme est un humanisme, Gallimard, Folio/essais, 1946/1996.
26 septembre 2011
Qu’est-ce qu’enseigner ? par P. Donadieu
En cette période de rentrée, bien des enseignants peuvent se poser la question. Qu’ils soient professeurs des écoles, des collèges, des lycées ou de l’enseignement supérieur. Qu’ils soient en même temps chercheurs, praticiens d’un autre métier ou pas.
Du point de vue de l’enseignant, tous conviendront qu’enseigner à des élèves, c’est leur transmettre un savoir, un savoir-faire qu’eux-mêmes maîtrisent. Et vérifier qu’ils l’ont compris et assimilé. Ainsi de l’enseignement d’une langue, d’un raisonnement mathématique, d’une technique de dessin, d’un savoir botanique, médical ou de génie civil (par exemple identifier une plante, une maladie ou construire un pont).
Enseigner, c’est apprendre quelque chose à quelqu’un. Et pour ce dernier, c’est chercher à acquérir des connaissances nouvelles, des expériences et des compétences qu’il ne détient pas ou mal. Et de ce fait être motivé pour apprendre, ce qui relève autant du rôle de l’enseignant que de celui de l’enseigné. Mais ces rôles respectifs sont rarement explicites. Essayons de les éclairer dans le cas de la formation des paysagistes, tous profils confondus.
Quand le rôle de l’enseignant est surtout celui d’un réservoir de connaissances scientifiques et techniques, celui de l’étudiant, vite dépassé par le savoir encyclopédique disponible, est de choisir ce qui lui est utile à ce qu’il ne sait pas nécessairement à sauf si les attendus pédagogiques sont précis. La transmission des savoirs, souvent livresques, relève alors de la bonne maîtrise d’Internet, et de la croyance à ce qu’on y sélectionne. Dans ce cas, l’étudiant n’apprend pas à penser, à raisonner, à observer, à résoudre un problème ou à maîtriser un geste technique, il se forme surtout à l’art du copier-coller des textes et des images. Et l’enseignant est condamné à passer maître dans l’art de déceler les plagiats. Une impasse pédagogique évidemment, où le texte de l’étudiant crée l’illusion d’une assimilation de connaissances. Ce qui n’exclut pas de brillants savants pédagogues dont l’art d’enseigner se passe d’Internet.
Si l’enseignant, trop auto-centré, abandonne avec sagesse ce rôle d’encyclopédiste, quelle que soit la discipline, il ne peut que se tourner vers une pédagogie centrée sur l’étudiant. Du même coup son rôle change. Il ne déverse plus alors un savoir généreux sur des esprits non ou peu motivés, mais devient le guide de l’étudiant qui prend en charge sa propre formation. Au rythme de ce dernier, selon ses motivations et les idées qu’il se fait de ses apprentissages.Au rythme également de l’enseignant qui organise le temps pédagogique pour permettre un tutorat individualisé (ateliers, travaux dirigés) ou des exercices collectifs (voyages, présentation de travaux).
Que veut dire pour l’étudiant paysagiste prendre en charge sa formation ? Quel que soit son niveau dans une progression pédagogique (de l’initiation à la maîtrise d’un concept ou d’une démarche d’analyse ou de projet), l’étudiant doit savoir ce qu’il veut maîtriser. C’est alors le rôle de l’enseignant de lui indiquer les étapes qui seront nécessaires, et les difficultés qu’il risque de rencontrer dans un temps donné (celui d’un module pédagogique qui sera évalué).
Par exemple, pour commencer à analyser un projet d’un professionnel (de la commande à la réalisation), il est nécessaire d’abord de savoir décrire à par l’enquête à les étapes de la commande, c’est-à-dire la relation construite entre le client (le maître d’ouvrage) et le paysagiste, de rendre compte du site avant la commande (description, images), et après aménagement (relevés, enquêtes). Pour ces deux tâches, une maîtrise du dessin, de la coupe, de la vue axonométrique, comme des techniques d’enquêtes est indispensable. Si ces techniques n’ont pas été apprises et ne sont pas correctement maîtrisées, l’enseignant doit, soit requérir ces apprentissages auprès de ces collègues compétents, soit les mettre en œuvre lui même aux niveaux nécessaires.
En outre, l’interprétation du processus de projet nécessitera de le situer dans une ou plusieurs théories du design de paysage (phénoménologique et/ou herméneutique par exemple). Après les avoir exposées, l’enseignant devra veiller à ce que leur utilisation dans l’analyse soit correcte. Il jouera alors le rôle de guide pour répondre au cours de l’exercice à des questions et infléchir le travail de l’étudiant dans la bonne direction.
Cette politique pédagogique à qui n’est pas nouvelleà a deux conséquences pour l’enseignant. D’abord, c’est lui qui, dans un temps mesuré, donne le cadre et les finalités du module pédagogique, autrement dit les finalités d’une acquisition de compétences (savoir analyser, projeter, écrire, dessiner, illustrer, structurer, etc.). Ce qui dépend en partie de l’institution et de son programme. En revanche c’est l’étudiant qui reformule pour lui-même la manière dont, dans un temps donné, avec ce qu’il sait faire et ce qu’il veut acquérir, et selon l’idée qu’il se fait de son niveau et de ses besoins, il va mettre en œuvre sa propre idée de l’exercice proposé par l’enseignant. Autrement dit, il élabore et réalise son projet de formation afin d’en évaluer le résultat (autoévaluation) avec les critères dont il convient avec son enseignant tuteur.
La seconde conséquence de cette politique de formation est d’abandonner en partie l’idée de l’enseignant qui transmet des connaissances universelles définitives, au profit de celui qui coproduit des savoirs distincts évolutifs pour chaque étudiant. Mais qui sont distincts également des savoirs de l’enseignant. Car, les contenus de formation évoluent trop vite pour que l’érudition ou l’expérience y jouent un rôle majeur. Il est désormais plus important d’apprendre à s’autoformer en permanence, qu’à adhérer, ou à croire à tel ou tel savoir-faire ou théorie. Pour un paysagiste, le savoir projeter par exemple n’est plus tout à fait le même qu’il y a quarante ans. Si la finalité est toujours la même à aménager un espace en l’inscrivant dans des temporalités et des spatialités différentes à les contextes d’exercice du métier ont changé : la gouvernance des projets, les outils infographiques, la disparition des styles historiques de jardin, la concurrence et la spécialisation des métiers de l’aménagement, l’émergence et la mondialisation des questions environnementales et écologiques, etc.
Sans doute, les questions de base du paysagisme ne changent-elles pas depuis 20 ans : qu’est ce qu’un paysagiste ? Est-ce que l’architecture de paysage est une discipline universitaire ? Il y a vingt ans, le paysagiste américain Carl Steinitz (Harvard University) répondait par l’affirmative et écrivait pragmatiquement que l’essentiel restait de pouvoir sélectionner les savoirs dans des projets faits pour le bien commun. Il y a vingt ans aussi, James Corner (University of Pennsylvannia) comme Bernard Lassus en France indiquaient de nouvelles directions de projet aux concepteurs fondés sur la recherche de leurs sens poétiques.
Ce qui me semble le plus important pour les enseignants comme pour les enseignés des écoles de paysage est l’audace déployée pour inventer des solutions de projet adaptées aux temps actuels de transition. « Too late for the Gods, but too early for being » écrivait le philosophe allemand Martin Heidegger en 1971 (Poetry, Language. Thought, New York, Harpey and Row, p. 72 (d’après JC).
19 septembre 2011
Que faut-il savoir pour devenir chercheur ? par P. Donadieu
Chercheur est un métier qui s’apprend comme on fait l’apprentissage du maniement d’un outil, d’un instrument de musique ou d’une langue. Dans tous les cas, il faut maîtriser des pré- requis sans lesquels les savoirs ne peuvent être acquis qu’avec de grandes difficultés. Apprendre à jouer du piano sans connaître le solfège, ou l’arabe sans savoir lire cette langue ne permet pas d’aller très loin.
Que faut-il savoir pour se préparer à devenir chercheur, et tout particulièrement chercheur dans les domaines de l’aménagement de l’espace ? Cette question concerne particulièrement ceux et celles qui vont suivre des études de master (géographie, urbanisme, architecture, paysagisme, etc.). Car ce diplôme peut conduire à la préparation d’une thèse de doctorat, diplôme aujourd’hui indispensable pour envisager les carrières de chercheurs et d’enseignants chercheurs à l’université ou dans les Grandes Ecoles.
Qu’est ce qu’un chercheur ? Aujourd’hui, un homme ou une femme qui travaillent dans des laboratoires publics ou privés en faisant, entre autres méthodes, appel à des expérimentations (médecine, agronomie, architecture par exemple), et/ou à des terrains d’observation et d’analyse (sciences de l’homme et de la société) ; qui participent à des programmes de recherche et à des colloques, font en général partie d’une équipe, publient des articles dans des revues « à comités de lecture » et des livres, et enseignent dans les universités. Grâce à leurs mérites, ils se construisent une carrière, la plus brillante et la plus internationale possible[1].
Quel que soit son domaine (les mathématiques, la philosophie, l’astrophysique, la religion ou l’urbanisme par exemple), un chercheur est un créateur de savoirs nouveaux (savoir penser ou savoir-faire), un découvreur, un inventeur, parfois même un aventurier. Il doit renouveler les connaissances existantes en inscrivant ses résultats dans les débats de la communauté internationale des chercheurs, lesquels les valident ou les invalident. C’est pour cette raison que les publications de recherche, quelles qu’elles soient, sont évaluées par les pairs des chercheurs.
Pour créer ces savoirs, il a en effet recours à des méthodes qui varient selon les disciplines. Les scientifiques construisent des hypothèses, des modèles abstraits (des simulations) à valider, sans jamais épuiser les sujets : les bioclimatologues pour expliquer les évolutions des macroclimats ou la propagation d’une tempête ; les sociologues et politologues pour comparer les attitudes des Etats face au chômage ; les chimistes pour fabriquer de nouvelles molécules ; les entomologistes et les botanistes pour découvrir de nouvelles espèces dans les forêts équatoriales ; les ethnomusicologues afin de recueillir les chants et les légendes de sociétés traditionnelles méconnues ; les archéologues pour inventorier un site avant sa disparition ; les littéraires pour proposer de nouvelles interprétations des œuvres, les informaticiens de nouveaux logiciels, etc. Les uns savent expliquer les causes d’un phénomène naturel (une secousse sismique par exemple) ou économique (les variations des valeurs boursières), et établir des lois universels et des prévisions. Ils savent également imaginer des solutions techniques (la carte électronique de paiement par exemple) ou conceptuelles (les créations d’un designer); les autres (les sciences humaines en général) s’emploient plutôt à comprendre les raisons de ces phénomènes, c’est-à-dire à reconstituer les mobiles de ceux qui à impliqué dans les faits à ont agi ou pensé, et la part des contingences et des nécessités, par exemple dans les démarches constructivistes (la construction sociale et culturelle des paysages en particulier).
Que faut-il alors savoir maîtriser, de manière élémentaire, pour apprendre le métier de chercheur « en paysage » ? Disons plutôt, de manière moins elliptique, dans le domaine des sciences du ou des paysages, selon que la notion est générique (le paysage comme épistèmé, comme corpus de connaissances), ou bien désigne les paysages en tant que « partie d’un territoire telle que perçue par des populations » (article 1 de la Convention européenne du paysage de Florence (2000).
Un chercheur se caractérise et se distingue d’un autre, ou lui ressemble, par sa démarche, ses méthodes et ses outils de travail. Le premier apprentissage souhaitable est de définir un objet de recherche (un thème général et un sujet). Pour y parvenir, il est nécessaire de lire attentivement ce qui a été écrit sur ce thème par d’autres chercheurs, surtout dans des ouvrages et des revues de recherche ; puis d’en synthétiser les résultats (ce qui a été montré, son intérêt et ses limites, les conditions des recherches). Ce qu’on appelle « l’état de l’art ». C’est essentiel. Si on ne le fait pas, on oublie que la recherche avance par capitalisation, par doute et remise en cause des résultats publiés, des idées reçues, des croyances admises.
Si le thème semble neuf, la démarche est à inventer. Quelle méthode permettra d’infirmer ou de confirmer telle hypothèse ? Comment puis je montrer que cette méthode sera la bonne à un financeur éventuel de recherches ? Par exemple pour évaluer l’efficacité d’un projet urbain dit durable (écoquartier) ; pour révéler les conditions politiques de la création d’une ville coloniale ? ou pour transférer et adapter les expériences de politiques de trames vertes et aquatiques d’un pays européen à un pays d’Amérique du Sud ?
Le deuxième apprentissage élémentaire est la familiarisation avec les paradigmes et les concepts de recherche du domaine concerné. Il se fait en même temps que la première étape. Sans l’analyse de ces préalables à l’investigation, les bases de la culture de recherche ne sont pas acquises. Toute connaissance à penser ce qui est à ne pouvant être absolue et parfaite, n’est que relative à des systèmes de médiation entre les hommes et le monde où ils vivent. Elle est donc subjective, y compris la recherche scientifique qui interpose des concepts entre le monde et nous. Nous ne disposons pour connaître le monde, pour nous, et non en lui-même, « que de nos sens, de notre raison et de nos théories » (Comte-Sponville, 70-71, 2000, Albin Michel). Selon les finalités de la recherche, il faudra cerner par exemple l’intérêt et les limites des acceptions données au mot paysage par les écologues du paysage (une échelle géographique), les sociogéographes, les historiens et les géographes culturalistes (une construction sociale et culturelle), les esthéticiens (l’artialisation du pays en paysage), et les paysagistes à peintres, architectes ou ingénieurs à (un paradigme professionnel).
Le troisième apprentissage de base du jeune chercheur est fondé sur des exercices pratique de recherche dès le master, puis dans la thèse de doctorat et le post doctorat. L’expérience encadrée de la découverte, de l’innovation ou de la création, à une échelle modeste, est indispensable. Sinon, on ne sait pas distinguer le rabâchage des lieux communs, entre les pistes déjà empruntées par d’autres et les réelles inventions ; les résultats bâclés ou douteux et ceux qui sont convaincants ; les protocoles rigoureux et les enquêtes approximatives et superficielles ; les affirmations prétentieuses et les avancées prudentes ; ou encore entre les plagiats et les travaux honnêtes. Je rappelle qu’une étude (demandée par un commanditaire quelconque, public ou privé) n’est pas nécessairement une recherche académique, car la première est validée seulement par un client qui paie le service s’il en est satisfait ; alors que la seconde est évaluée et validée en premier lieu par une communauté de chercheurs désintéressés à travers les publications acceptées dans les revues spécialisées ou les ouvrages.
Ce qui entraîne que la rigueur et la réputation des chercheurs docteurs, et des institutions qui les emploient, sont en général requises par les demandeurs d’études, notamment dans les « bureaux d’études », les ministères et les collectivités publiques.
Si ces trois pré-requis sont respectés et vérifiés dans les formations de master, la carrière de chercheurs peut être plus facilement envisagée, y compris après des formations professionnelles qui n’y conduisaient pas, comme celles d’architectes, d%u2018urbanistes et de paysagistes.
[1] D’après Jean-François Dortier, Qu’est ce qu’un chercheur ? Sciences humaines Hors Série, Histoire et philosophie des sciences, n° 31, 2010, pp. 48-53.
5 septembre 2011
Penser le paysage, par P. Donadieu
Que signifie penser le paysage ? Dans la nouvelle série des chroniques hebdomadaires de Topia de l’année scolaire 2011-12, je vais tenter d’explorer ce thème. Non qu’il n’ait pas déjà été abordé, car les publications abondent, mais parce que des éclairages réguliers permettront, je l’espère, à de nombreux étudiants de mieux comprendre la complexité de l’épistèmé paysagère qui se construit sous nos yeux.
Car penser le paysage, c’est penser le monde, celui des autres et le sien propre. Penser, écrit le philosophe Alexandre Lacroix, « c’est se sentir appeler à prendre la mesure de ce qui est hors de nous »[1]. Il ne s’agit pas seulement de « savoir calculer, classer ou résoudre un problème », ni d’imaginer qu’il existe des solutions toujours plus performantes et définitives aux questions posées. Penser s’apprend, s’expérimente et n’est jamais terminé. Nul ne peut dire : je sais désormais penser.
Tous les chemins de la pensée, écrit Mathilde Lequin[2], mènent aux idées, et j’ajoute, en particulier à celles de paysage. Par la voie du corps, : de la marche et du voyage : par la voie du dialogue avec l’autre : de la maïeutique socratique ou de l’éthique kantienne ; par la voie de l’esprit : de l’herméneutique de Paul Ricoeur (1913-2005), de la déconstruction de Jacques Derrida (1930-2004) ou de la poésie ; ou encore par celle de la logique : du doute cartésien ou husserlien à la dialectique hégélienne.
Le corps, le dialogue, l’esprit et la logique : quatre voies pour apprendre à penser le paysage sont offertes par la philosophie. Encore faudra-t-il distinguer celles qui permettent d’agir sur les paysages matériels, et celles qui sont destinées à leur donner du sens. À moins qu’il ne soit encore plus pertinent de penser ces deux voies en même temps : celle des projets qui engagent le devenir des paysages, et celles des histoires à de nos histoires à qui, en engageant nos croyances et nos intuitions, donnent prises à nos jugements.
Comment peut-on apprendre à penser le paysage ? En empruntant, entre autres voies, aux « expériences de pensée » du philosophe américain Ruwen Ogien[3] à à celle du « tramway qui tue » en particulier à, je vais donner l’ exemple d’un exercice possible de philosophie morale.
Imaginez que, dans une grande ville d’Afrique ou d’Amérique du sud, les élus donnent tous pouvoirs à un paysagiste urbaniste pour planifier l’urbanisation dans les vingt ans à venir et pour mettre en œuvre sa politique. S’il admet la seule logique libérale du marché foncier et l’impuissance des pouvoirs publics, il ne peut sauver les terres agricoles. La métropole s’étalera alors avec à entre autres à deux conséquences qui diminueront la « soutenabilité » de la ville : l’accroissement de la pollution urbaine et des embouteillages, et les risques de pénurie alimentaire en cas de crise (pas d’agricultures de proximité). En revanche, s’il impose de manière despotique, une densification démographique du tissu urbain existant et la protection des terres agricoles, il limitera la liberté individuelle d’action au profit de la sécurité alimentaire et sanitaire collective.
Que doit-il faire ? Est ce immoral de laisser une ville s’autodétruire inéluctablement sous prétexte de faire confiance aux vertus régulatrices du marché libéral ? Ou bien l’alternative autoritaire est-elle toute aussi immorale ? L’intuition générale est sans doute aujourd’hui favorable à la première solution. Car l’idée de la dictature semble sans doute plus pénible à admettre que celle d’une ville inhabitable qu’il est toujours possible de fuir (comme la dictature d’ailleurs). Entre l’idée des réfugiés politiques et celle des réfugiés urbains, l’intuition du paysagiste pourrait préférer la première notion moins floue que la seconde. Lui faut-il oublier la notion de bien commun (l’habitabilité de la ville pour tous) ou tenter de la réhabiliter ? Lui faut-il oublier les conséquences néfastes de ses actes pour décider ou s’en tenir à une éthique déontologique ?
Certes, il ne s’agit que d’un exercice. Mais cette fiction est très proche de la question concrète et réelle de la prise de décision, qui dans ce domaine est d’abord politique. Elle ne peut, dans ce cas, laisser le paysagiste seul, et implique en principe les acteurs de la gouvernance urbaine.
D’une manière plus générale, la question de l’éthique paysagiste ne devrait elle pas faire partie de l’épistèmé paysagère ? Est-il moral qu’un Etat déplace les habitants d’un village qui doit être englouti par l’eau d’un barrage hydroélectrique ou qu’il laisse s’implanter sans concertation des éoliennes sur un territoire ? Qu’une collectivité ne contrôle pas ou mal l’enfouissement de ses ordures ménagères et industrielles ? Ou que la gestion de l’espace public passe surtout par les logiques des communautés ou de l’argent privé ? Faut-il se contenter d’élaborer des politiques publiques qui ne nuisent pas aux habitants, et à quels termes, et selon quels modes d’évaluation ? Augmenter la surface d’espaces verts par habitant ou celle des lieux patrimonialisés d’un territoire ne sont-ils pas des critères insuffisants d’efficacité d’une politique paysagère, d’un point de vue social autant qu’environnemental ?
Selon une éthique minimaliste (libérale et occidentale), toute action qui ne fait pas de victimes humaines, et n’offense personne, est permise. Alors que, pour les moralistes maximalistes, l’absence « d’effets collatéraux » ne suffit pas, ce sont les valeurs morales en soi qui légitiment les jugements. Dans l’espace public par exemple, les comportements amoureux sont admis dans les pays occidentaux, mais réprouvés dans les pays islamiques.
Et qu’en est-il, au sein de ces politiques paysagères et environnementales, du vivant non humain, des végétaux et des animaux, utiles et nuisibles ? Ces vies ne comptent-elles que dans la mesure de leur utilité humaine ?
Faut-il d’ailleurs remettre en question les valeurs morales et les idéologies qui nous gouvernent comme le pensait Friedrich Nietzsche (1844-1900) ? Mettre entre parenthèses nos croyances aux réalités matérielles à la manière des phénoménologues Edmond Husserl (1859-1938) et Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) pour s’intéresser seulement à la perception des paysages et à l’harmonie ressentie de leurs formes ?
Penser le paysage est d’abord un apprentissage, un itinéraire aventureux, un voyage à travers des régions insoupçonnées de la sensibilité culturelle des sociétés. Qu’est ce qui est bien ou mal dans les mondes où nous vivons ? Rien n’est donné, tout est construit par la pensée qui agit, et l’action qui permet de penser.
[1] Alexandre Lacroix, Introduction du dossier Apprendre à penser. Philosophie Magazine n° 52, 2011, pp. 36-37.
[2] Mathilde Lequin, Dossier Apprendre à penser, Philosophie Magazine n° 52, 2011, pp. 38-39.
[3] Ruwen Ogien, Dossier Apprendre à penser, Philosophie Magazine, 2011, pp. 50-51.
4 juillet 2011
Qu’est ce que le savoir expérientiel paysagiste ? Peut-il faire l’objet d’une recherche doctorale ? par P. Donadieu
La pratique du projet de paysage engendre un savoir d’expériences, un savoir expérientiel. Il est appris de manière continue, d’abord dans les ateliers de projet des écoles professionnelles, puis dans les entreprises (agences, bureaux d’étude, etc.). C’est un savoir pragmatique partagé au sein de la communauté professionnelle paysagiste, celle qui est représentée par la Fédération française du paysage par exemple. Il ne mobilise a priori ni théories scientifiques, ni valeurs morales. Il vise la réponse à une commande d’un client de manière efficace et conforme aux règles déontologiques de la profession.
Pour être communiqué et transmis dans une école, ce savoir doit exister formellement, et donc être décrit par les auteurs de projets. Ces derniers expliquent alors à oralement ou par écrit à comment ils interprètent la commande et la reformulent ; analysent et interprètent le site ; fondent le parti/le concept de projet ; questionnent éventuellement les spécialistes ; décident des représentations pour communiquer ; évaluent les coûts ; s’organisent pour gagner des marchés, etc.
Ces savoirs praticiens ne s’inscrivent pas dans une discipline universitaire particulière (en France du moins). En revanche, s’agissant d’un projet d’aménagement d’un site, ils mobilisent des connaissances très différentes, plasticiennes et techniques notamment, et les articulent de manière cohérente au service d’une idée de projet. Par exemple, en choisissant les techniques de terrassement, de constructions des surfaces minérales ou enherbées, d’éclairage, de plantation, de drainage, d’architecture, etc. S’agissant d’une politique paysagère territoriale, le projet ou plutôt la stratégie paysagère convoquent autant des savoirs géographiques, écologiques et historiques, que l’intuition des formes susceptibles d’améliorer les fonctionnalités, l’habitabilité, l’accessibilité et l’attractivité des sites.
Les savoirs de l’action supposent la mise en évidence et l’acquisition par l’étudiant de schèmes de pensées praticiennes, ou d’actions professionnelles. Par exemple pour interpréter le site (l’analyse inventive, le diagnostic paysager, la reconnaissance paysagère), ou pour fonder le dessein du projet. Dans ce dernier cas, les schèmes de pensée et d’action peuvent désigner des objets physiques : la trame foncière, les trames vertes et bleues, la topographie, l’hydrographie ; des thèmes environnementaux : le tiers paysage ou la biodiversité ; des finalités sociopolitiques : la mixité sociale, l’accessibilité, l’attractivité, la sécurité ; ou encore culturelles (les motifs patrimoniaux d’identité des sociétés).
La transmission de ces savoirs expérientiels aux étudiants paysagistes par des professionnels apparaît comme la condition nécessaire de leur professionnalisation. Les responsables d’atelier doivent en effet vérifier chez leurs élèves à surtout au moment des diplômes de fin d’études à la maîtrise de ces schèmes par les langages graphique, écrit et oral. Maîtrise qui doit être augmentée de la capacité à renouveler, de manière imaginative, la production des formes et fonctionnalités données par un site. Non seulement en agissant sur les perceptions de l’espace parcouru, mais également en en transformant les matérialités.
L’acquisition du savoir expérientiel des concepteurs paysagistes se fait par un apprentissage long (4 ans) qui suppose des succès et des échecs des étudiants, constatés par les formateurs ; une familiarisation progressive avec la complexité des savoirs et savoir-faire à mobiliser (de l’échelle du trottoir à celle du territoire) ; et par voie de conséquence une déformation/reformation fréquente des personnalités des étudiants.
De tels savoirs et savoir-faire, vulgarisés par la presse professionnelle et les publications des praticiens qui écrivent ou de leurs commentateurs, sont-ils susceptible de donner lieu à des doctorats de recherche ? Ou bien l’obligation de la réforme de Bologne (1999) à le doctorat à est-elle sans objet dans les écoles de paysagistes ?
L’analyse de l’enseignement en Europe montre d’abord que ces doctorats de conception des projets paysagistes existent ou sont en construction. Surtout parce que la règle universitaire générale est désormais de recruter des enseignants àchercheurs docteurs, y compris chez les paysagistes et les architectes.
Dans une chronique précédente, j’ai montré que chez les concepteurs paysagistes, l’idée de recherche était incluse dans la culture de projet. Essentiellement en tant que nécessité d’innover, de donner une réponse singulière adaptée au site et au programme d’intervention, et non de reproduire des modèles existants. Or un doctorat de recherche doit apporter la preuve d’une capacité à créer une innovation (concept et/ou technique) par des méthodes de démonstration rationnelle (scientifique, philosophique ou autre) ; à l’éprouver par un débat et des publications dans la communauté universitaire concernée (école doctorale).
Il y aurait alors deux façons d’imaginer à ou de conforter quand il existe à un doctorat de conception (création) paysagère (landscape design doctorate PhD) :
– Soit en expliquant pourquoi le ou les projets étudiés sont innovants (avec ou sans comparaison avec d’autres projets, d’autres concepteurs et d’autres contextes). Dans la mesure où le projet paysagiste à en tant que projet d’une œuvre paysagiste à n’est pas contraint à démontrer scientifiquement une proposition. Il se limite en général à la montrer pour éclairer, faire comprendre et pour convaincre le client. Ce doctorat serait consacré à la connaissance de la production des savoirs expérientiels des auteurs de projets en cours ou achevés (landscape projects studies)[1]
– Soit plus largement en prenant appui sur les concepts des sciences de la conception du projet à partir des concepts des disciplines qui peuvent faire comprendre (expliquer et interpréter) un processus de transformation de l’espace. Trois domaines émergeants ou constitués des sciences poiétiques et pratiques (Aristote) sont concernés : les sciences de l’ingénieur (de l’infographie, des techniques paysagistes par exemple) ; les sciences de la conception du projet (d’architecture, urbain, de territoire, de paysage, de jardin) ; les sciences de la critique éthique et esthétique du projet : Landscape project sciences[2].
Ces deux types de doctorats ne sont pas nécessairement pluridisciplinaires. Ils sont et seront définis par leurs concepts, démarches et méthodes de recherches. Ceux-ci devront faire l’objet d’un apprentissage préalable (master), expérientiel lui aussi, pour que le doctorat en « sciences et architecture de paysage » se déroule dans de bonnes conditions.
[1] Par exemple les thèses du philosophe Sébastien Marot (G. Descombes), de l’architecte Nicolas Gilsoul (L. Barragan) et de la paysagiste Sonia Keravel (le projet de paysage comme passage et médiation)
[2] Par exemple les thèses des paysagistes Fanny Romain (les reconquêtes des cours d’eau urbains méditerranéens), Hélène Soulier (Les reconquêtes des friches urbaines).
27 juin 2011
Quelles connaissances crée la pratique du projet de paysage ? par P. Donadieu
Les architectes paysagistes ont un intérêt collectif à capitaliser les connaissances produites par leurs pratiques de concepteurs. Surtout s’ils sont enseignants. Mais de quelles connaissances parle-t-on ?
Opposée à l’ignorance, à l’opinion commune, à la croyance et à la foi, la connaissance de quelque chose est une idée éclairante, subjective ou objective. Soit que l’on ait l’expérience personnelle d’une pratique (connaître le métier de paysagiste) et que ces savoirs et savoir-faire permettent d’accéder aux compétences permettant de bien faire. Soit que, relevant de méthodes scientifiques objectives (l’observation, l’expérimentation, la modélisation), cette connaissance, à caractère universel, puisse être validée par des preuves (explications) ou des interprétations partagées.
Dans les écoles de projet, les compétences de projeteur sont aujourd’hui transmises de manière essentiellement pratique dans des ateliers. Mais elles ne sont pas ou peu capitalisées par des connaissances scientifiques qui permettraient de les diffuser et de les partager en dehors des apprentissages professionnels. Comme cela est fait par exemple dans les domaines médicaux ou agronomiques. L’acte de soigner ou de cultiver par exemple est en permanence amélioré par les résultats des chercheurs. Celui de projeter un aménagement paysager local ou des règles de construction des paysages d’un territoire n’est cependant pas comparable ; il obéit à des règles plus proches des métiers de l’architecture et de l’urbanisme que de ceux de l’ingénieur ou du médecin.
Ce qui est commun à ces deux échelles géographiques de l’action paysagère : le lieu et le territoire, est le mode opératoire du projet. Dans une perspective phénoménologique[1], la réalité ne peut être qu’humaine et subjective, et, en tant que telle, elle est action non dissociée du savoir de cette action. Il y a continuité entre la construction de l’intention (le dessein), la forme communiquée de l’intention (le dessin) et la réalisation du projet ; entre une pensée intentionnelle abstraite (les bords de la route doivent être plantées) et une pensée technique (les arbres ont été plantés de telle façon) Le savoir du projet n’est pas dissociable de l’acte du projet qui est un savoir in progress.
Ce qui est à connaître est alors de deux types. D’une part une pensée technique et répétitive du faire et du faire faire qui se capitalise en principe facilement dans des ouvrages techniques (comment planter, terrasser, drainer, irriguer, éclairer, séparer, relier, etc.). D’autre part une pensée du corps qui ressent et agit le monde vécu et à vivre dans une seule et même tension créatrice du projet (comment donner une idée des formes qui seront matérialisées). Car l’action, écrit le philosophe Jean-Paul Sartre (1905-1980), est « comme notre être-dans-le-monde en tant que nous avons à l’être sous forme d’être-instrument-au-milieu du monde » (p. 365). En d’autres termes, « la perception (du monde) ne se conçoit jamais en dehors d’une attitude vis-à-vis du monde » (p. 521). Selon la posture de la phénoménologie existentialiste, l’acte de projeter est intention consciente nécessaire. « Celle-ci se fait être en choisissant la fin qu’il l’annonce » (p. 522). Elle dépasse le donné vers un résultat à obtenir qui n’existe pas encore.
Comment l’acte de connaître peut-il alors se saisir de ce processus mental et matériel qui conduit d’un état donné (le site, la commande, le programme) à des états à venir. Est-il réductible à un savoir qui serait alors un répertoire de recettes et de règles pour bien faire ? Comme le Traité pour la composition de parcs et jardins d’Edouard André (1879) l’a été jusqu’à la fin des années 1970 en France. Le risque est alors important de figer les pratiques paysagistes et jardinières par imitation d’un ou plusieurs modèles abstraits réduits à des formes ou à des processus applicables en tout lieu.
Est-ce que cette connaissance est concevable comme un catalogue des concepteurs paysagistes qui exposeraient les images des œuvres des paysagistes les plus réputés avec leur biographie, comme par exemple les deux tomes des Créateurs de jardins et de paysages (Actes Sud/ENSP) édités par Michel Racine en 2001 et 2002 ? Si ces publications font connaître les figures des architectes paysagistes et leurs travaux, elles ne disent que peu de choses de leurs manières de concevoir leurs projets et de la réalité des résultats obtenus. Ce sont sans doute les historiens des jardins (Michel Baridon, Jean-Pierre Le Dantec, Monique Mosser par exemple en France) qui explicitent le mieux l’art des concepteurs. Toutefois, ils n’entrent pas dans le détail des processus de projet, et abordent peu les stratégies urbaines et les politiques paysagères territoriales.
Le mieux serait alors de faire confiance aux concepteurs eux-mêmes (ou à leurs commentateurs) pour expliquer leur art (ce qu’ont fait notamment J. Simon, B. Lassus, M. Corajoud, G. Clément, F. Zagari, M. Desvigne, G. Descombes, R. Koolhas). Très séduisants, les résultats sont néanmoins un peu décevants. Car les concepteurs de projet ne parlent que de leurs œuvres propres, ce qui ne se prête guère à la mise en évidence des caractères distinctifs et communs des réalisations (ce que font néanmoins un peu les historiens). Ces témoignages de praticiens ne permettent d’envisager la transmission efficace des savoirs que dans le cadre des agences et des apprentissages d’ateliers, du maître à l’élève.
Il semblerait néanmoins que le projet des architectes paysagistes n’ait pas à faire appel aux chercheurs pour au moins quatre raisons :
- il ne vise pas l’amélioration de processus techniques et constructifs comme dans le projet de l’ingénieur. S’il le fait, la posture adoptée est alors celle de l’ingénieur paysagiste ou de l’architecte auxquels il peut avoir recours. La différence entre ces deux profils est la même qu’entre l’ingénieur constructeur et l’architecte concepteur,
- il ne répond pas en priorité et explicitement à des problèmes environnementaux, sociaux ou économiques, mais en intègre plus ou moins les réponses (faites par d’autres) sous la forme de dispositifs spatiaux originaux ayant leurs propres règles,
- il s’appuie sur une logique abductive (incertitude des prémisses) et performative (dire c’est faire exister), qui entraîne qu’il n’a pas à démontrer scientifiquement ce qu’il propose, mais seulement à le montrer de manière convaincante depuis sa posture d’expert reconnue par les pouvoirs publics,
- le projet contient donc sa propre motivation interne à chercher des solutions singulières et innovantes à des questions de projet liés à un site et à un programme.
Si le concepteur fait appel aux chercheurs et aux apprentis chercheurs (doctorants), c’est pour éclairer une question qui lui reste obscur ou sans réponse.
Force est donc de constater que les sciences émergentes de la conception des projets de paysage ont encore beaucoup à faire. Car rien n’indique que la capitalisation du savoir projectuel relève seulement des sciences explicatives. Elle mobilise également des postures phénoménologiques (l’intuition finalisée) et herméneutiques (l’interprétation du monde sensible et symbolique).
Ce qui revient à distinguer d’une part des savoirs expérientiels singuliers issus des théories, des concepts et des pratiques de la conception (que révèlent les concepteurs qui les décrivent et les inspirent). Et d’autre part des savoirs scientifiques qui donnent à comprendre et à améliorer ces pratiques. Cette connaissance objective met en lumière des lois et des contextes en analysant et comparant les pratiques de projet des concepteurs. Ces savoirs s’appuient notamment sur des concepts sociogéographiques, historiques, écobiologiques et économiques. Ils peuvent avoir recours à un paradigme constructiviste notamment pour interpréter le projet sociétal de paysage à l’échelle territoriale.
Prochaine chronique : qu’est ce que le savoir expérientiel ? Peut-il être produit par une recherche de type doctorat ?
[1] J.P. Sartre, L’être et le néant, essai d’ontologie phénoménologique, Gallimard, Paris, 1943, p. 367.
20 juin 2011
Le paysage peut-il devenir un bien commun ? par P. Donadieu
Dans le droit romain, les choses publiques (res publica), qui appartenaient à l’Etat ou à la cité étaient distinctes des choses communes (res communis) à ceux qui en usaient, et des res nullius (les oiseaux, l’air, la mer) qui n’appartenaient à personne.
Aujourd’hui, la notion de bien commun (ou collectif) a en français deux sens. Pour les sciences économiques, le bien commun (au pluriel et au singulier) est un élément (ou actif) matériel ou immatériel, accessible à tous. Son usage et/ou sa propriété sont partageables par plusieurs personnes morales ou physiques, mais pas nécessairement par tous. Il est distinct du bien public qui est un bien commun dont la propriété et l’usage sont sous le contrôle exclusif ou partagé des pouvoirs publics (l’Etat, la Région, la communauté urbaine par exemple). Mais aussi du bien privé qui est la propriété d’une personne physique ou morale privée.
Selon cette définition, les biens et services communs sont consommables par plusieurs personnes à la fois. Dans le cas du parking d’une copropriété par exemple, le bien commun des copropriétaires peut susciter des rivalités (pas assez de places). En revanche personne n’est exclue de la consommation de l’air d’une région. Ni soumis à un contrôle seulement privatif, ni seulement public, le bien commun n’exclut en principe personne, mais son usage peut être réduit à des groupes. Aux automobilistes par exemple, accédant par péage à une autoroute privée ou publique. Aux propriétaires d’une maison ouvrant sur un paysage maritime visible seulement depuis leurs fenêtres. En revanche la vue sur la mer depuis une plage publique est un service commun à ceux qui la fréquentent. Elle n’est appropriable par personne (sauf si la plage devient privée et payante).
De ce point de vue, le paysage, en tant que « partie de territoire telle que perçue par les populations (…) » (Article 1 de la Convention européenne du paysage de Florence en 2000), est à la fois un bien matériel perceptible et un ensemble de services immatériels (les valeurs affectives esthétiques, éthiques, etc., que le paysage suscite et qui varient selon les regards). C’est un bien/service commun à tous ceux qui peuvent le partager : tous en principe dans le cas d’un paysage public (le Mont-Saint Michel par exemple), mais une partie de tous dès qu’il existe des limitations à l’accès par des péages, même symboliques (le jardin public de Bagatelle dans le Bois de Boulogne ou le parc public de Versailles, en partie, sont payants). Par définition, un bien commun, comme l’étaient les Communaux sous l’Ancien Régime, est toujours menacé de privatisation ou de publicisation. Dans les deux cas, ce sont les intérêts (privés et/ou publics) des titulaires de droits de propriété ou d’usage qui décident des modes d’accès aux lieux ou aux services.
La seconde signification concerne le bien commun (au singulier) en tant que principe (religieux, moral, philosophique, social, culturel), à finalité collective, visant la réalisation d’une ambition humaine dépassant les intérêts particuliers des acteurs formant un collectif. Le bien commun peut être l’affaire de l’Etat dans le Welfare State (Etat du bien-être) mis en place après la seconde guerre mondiale par les pays de l’Europe du Nord et les Etats-Unis. Il a concerné à car il a été progressivement détruit à la fin du siècle dernier par l’idéologie marchande et consumériste[1] à des innovations sociales comme le droit au travail pour tous, le revenu minimum pour les travailleurs, la sécurité sociale, la démocratie participative, etc. Ce bien commun est fondé, selon l’économiste altermondialiste R. Petrella, sur la solidarité et la reconnaissance des autres. Il peut aussi être produit par des acteurs privés, comme par exemple le National Trust en Grande Bretagne, la World Wildlife Fundation ou Green Peace dans le domaine des valeurs environnementales (la biodiversité animale et végétale en particulier). Ou encore par des collectivités publiques territoriales comme les Régions Poitou-Charentes, Ile-de-France ou Provence-Alpes-Côte-d’Azur, qui ont accordé une grande importance à la production de services paysagers et environnementaux sur leur territoire.
Cette notion de bien commun a été mise en évidence par le moine dominicain Thomas d’Aquin (1224-1274) qui a isolé le bien commun du bien public. Gaston Fessard, dans Autorité et bien commun (1944), décompose le bien commun en trois sous-ensembles : le bien de la communauté (les biens publics ou autres mis en commun) ; la communauté du bien : le caractère effectif de l’accès de chacun aux biens communs ; et le bien du bien commun : la nature et l’équilibre de la relation entre l’individu et la communauté[2]. Evoquant l’Internet comme bien commun, Alain Giffard[3] souligne en 2005 deux raisons pour recourir à une notion de bien commun où l’intérêt commun ne se confond pas avec l’intérêt général : d’une part « La critique du « relativisme » moral, intellectuel et culturel, du refus des normes et de l’autorité, du culte de l’individu et du narcissisme. », d’autre part « la méfiance à l’égard de l’État et de la bureaucratie, et, en tout cas, la nécessité de ne pas confondre bien commun et intérêt général. L’intérêt général serait le bien du prince, dans le sens où il est de sa responsabilité, et vise les biens publics et les règles générales de la cité » (op. cit.).
Concernant la notion de paysage, il apparaît utile de distinguer le bien commun paysager du bien public paysager. La définition de ce dernier, illustré souvent par les parcs et jardins publics urbains, tend à être réduite par les règles d’intérêt général qui limitent son accessibilité à tous : par exemple pour des raisons de sécurité, d’esthétique et de propreté. De ce fait l’espace public, contrôlé et normé, est réduit à un espace commun à ceux qui font valoir leur conception du bien et du service public aux pouvoirs publics urbains. Une ségrégation sociale souvent invisible est ainsi mise en place. Notamment entre ceux qui ont accès à l’espace public urbain et ceux qui ont de la difficulté pour le faire. Ces derniers se reportent alors sur d’autres espaces à caractères de biens communs comme les jardins communautaires et les jardins partagés.
Résumons, le paysage (ce que nous percevons du monde en le parcourant) est fondamentalement un bien commun à tous comme l’air, l’eau et la vie sauvage mais également comme Internet, la sécurité sociale, la solidarité et la liberté. Cet état est fondamentalement instable. Car, au nom de l’intérêt général ou étatique, il tend à passer sous le contrôle normatif des pouvoirs publics. Et au nom de l’intérêt individuel, privé et marchand, il cède du terrain à l’usage et au contrôle des entreprises privées à des fins économiques.
C’est pourquoi la défense active des biens communs paysagers (le droit au paysage), devient aujourd’hui une priorité des sociétés démocratiques.
[1] Ricardo Petrella, Le bien commun, éloge de la solidarité, Bruxelles, Labor, 1996.
[2] Alain Giffard, Distinguer bien commun et bien(s) commun(s), 2005. http://www.boson2x.org/spip.php?article146, consulté le 2 02 2011
[3] Alain Giffard est directeur du Groupement d’intérêt scientifique Culture & Médias numériques.
6 juin 2011
Quels paysages transmettre ? par P. Donadieu
La réponse ne dépend que de la réflexion de chacun, puisque aucune transcendance, divine ou humaine, ne peut donner satisfaction dans ce domaine méconnu. Car, écrivait le juriste et philosophe arabe Averroes « réfléchir n’est rien d’autre qu’inférer, extraire l’inconnu du connu » (Discours décisif, vers 1180).
L’accident nucléaire de Fukushima de mars 2011 est aujourd’hui un cas d’école très opportun. Faut-il, disent les philosophes[1], sortir au plus vite de l’énergie nucléaire comme les Allemands ont décidé de le faire, ou bien s’agit-il d’une réponse irréaliste ? En d’autres termes, faut-il rassurer l’opinion publique inquiète en supprimant la réalité et le spectacle des centrales supposées dangereuses ? Ou bien les pouvoirs publics, français notamment, doivent-ils rester rassurants et impavides ?
Il est des paysages qui ne laissent pas indifférents, surtout si on habite à proximité : ceux des centrales nucléaires inquiétantes comme ceux des décharges d’ordures à ciel ouvert mal contrôlées, des incinérateurs douteux et des usines polluantes. Les percevoir en tant que paysages, c’est aussi pour le citoyen les juger. Faut-il accorder du crédit aux militants écologistes qui dénoncent les risques pour la sécurité et la santé humaines. Faut-il également dénoncer les propos convenus des experts et des politiques qui les emploient ?
Le philosophe Alexandre Lacroix met en évidence, à propos du nucléaire, quatre questions qui sont généralisables à tout dysfonctionnement environnemental.
1- « Faut-il craindre un danger invisible et inquantifiable ? » (p. 38). Imperceptible, le danger radioactif est abstrait et rationalisé par des seuils d’exposition aux radiations à ne pas dépasser. Mais, comme à Tchernobyl, les conséquences réelles sur la santé humaine sont mal connues et minorées par les pouvoirs publics nationaux et internationaux. Comme elles sont inappréciables à nous ne connaissons pas leurs conséquences pour l’espèce humaine et son milieu à, le philosophe invite rationnellement à la prudence et à l’abandon immédiat de l’énergie nucléaire.
2- « Comment préférer une catastrophe à une autre ? » (p. 39). Entre la peste (l’énergie nucléaire) et le choléra (l’alternative de l’énergie thermique à charbon, fuel à augmentant les gaz à effet de serre), quelles calamités choisir ? De nouveaux accidents nucléaires probables et leurs conséquences environnementales connues (sols irradiés, pathologies graves, zones inhabitables), ou bien les migrations climatiques et les famines qui sont déjà en cours ? Les tenants du nucléaire n’exagèrent-ils pas les risques de l’effet de serre, et les militants écologistes ne les minorent-ils pas ? Refusant d’entrer dans cette alternative, et s’appuyant sur Le Principe responsabilité de Hans Jonas (1979), le philosophe invoque le devoir moral à mais indémontrable à pour chacun de garder la Terre habitable pour les générations futures, et donc de consommer beaucoup moins d’énergie.
3- « Pourquoi est-il économiquement rationnel de prendre des risques économiques majeurs ? » (p. 40). L’accident de Fukushima n’a pas eu, en fait, de conséquences économiques au niveau de la bourse de Tokyo. Parce que le coût de l’électricité nucléaire ne tient pas ou peu compte des externalités : démantèlement et entretien des centrales, dépenses de santé des contaminés, décontamination des sites lors des accidents, retraitement des déchets…. Tant que ces coûts à méconnus pour l’instant à ne seront pas payés par le consommateur d’électricité (mais par les Etats, et donc par le contribuable qui n’a pas le choix), il est sans doute préférable de s’intéresser à des économies moins opaques comme les énergies renouvelables. Ce que ne dit pas le philosophe.
4- « Comment fait-on pour parier sur les petites probabilités ? » (p. 41). L’improbable est toujours possible. Le risque zéro n’existe pas. Car ce que mesurent les probabilités c’est le degré de notre ignorance. Si les ingénieurs qui ont conçu la digue de protection de la centrale de Fukushima avaient su qu’une vague de tsunami de 14 mètres était possible à ce qui n’était pas invraisemblable à, ils n’auraient pas décidé d’en élever une de seulement 6 mètres. Dans l’inconnu, admet le philosophe, la raison « tourne à vide ». Sauf à se ranger auprès de Pascal et de son pari. Et de décider qu’il est préférable de croire à l’habitabilité nécessaire de la planète laissée aux générations futures. Surtout si ce qui est gagner (la survie collective) ou à perdre (la vie) pour soi et les autres est sans mesure connue.
C’est pourquoi, dans ce cas, les points de vue existentiels sur le monde, débarrassés des controverses scientifiques, des litiges juridiques et des atermoiements politiques, semblent plus prometteurs pour la destinée de l’humanité. Parce que la relation immédiate et intuitive au monde est porteuse d’un engagement personnel, d’une possibilité de partage des événements souhaitables à venir. Parce que la vigilance nécessaire qu’évoque Jean-Pierre Dupuy dans Pour un catastrophisme éclairé, quand l’impossible est certain (2002), suppose une conscience du souhaitable pour soi et pour autrui. Elle intervient particulièrement quand un paysage perçu apparaît, non pour ce qu’il est, mais en tant que devant être agi, modifié, valorisé, sécurisé, pacifié, embelli… Ce qui suppose autant de croyances que de consciences réflexives, de types de projets que de convictions établies ou douteuses.
Pourtant, si les humains veulent réfléchir aux paysages qu’ils transmettent aux générations futures, ils n’auront le choix qu’entre deux positions réalistes. Soit ils veulent continuer à croire au Progrès et aux sciences. Dans ce cas, il leur faut également croire à la croissance économique. Et faire confiance à l’imagination sans limites des sciences pour trouver des parades à la raréfaction des ressources naturelles. Les paysages deviendront alors à l’image de cette société qui ne veut douter que de ce qui contrarie sa croyance au progrès et à l’histoire sans fins. Des paysages qui seront inscrits comme un palimpseste sur l’écorce terrestre, dans un sillage de destructions et de constructions générées par le marché libéral comme par les conflits humains.
Soit, plus audacieux, ils adoptent la posture pascalienne et font place au doute non sélectif. Dans cette situation, ils peuvent anticiper, localement, la finitude des ressources naturelles (eau, énergies, minerais…) et activer le principe politique de précaution quand l’ignorance l’emporte sur la connaissance. Les paysages de ces sociétés de marchés régulés par les Etats, culturellement diversifiés, seront compris selon cette morale alternative à la précédente. Ils devraient traduire autant la liberté d’agir que celle de choisir la vie souhaitée, mais dans un monde rassurant parce que responsabilisé.
[1] Dossier Nucléaire, avons-nous perdu la raison ?, Philosophie Magazine, n° 49, 2011, p. 38 et suiv.
30 mai 2011
Recherche scientifique et écoles de landscape design, par P. Donadieu
En Europe, une des conséquences de la réforme universitaire de Bologne (Licence Master Doctorat) a été l’introduction des doctorats et des activités de recherche dans les écoles qui forment des architectes paysagistes. Deux cas se présentent en fonction de la nature des écoles. Si elles sont à dominante scientifique à comme dans les instituts de Wageningen ou d’ Angers par exemple à la création des unités de recherche (de type Unité Mixte de Recherche en France) se fait en principe assez facilement en fonction des disciplines choisies : en particulier en sciences de l’environnement, de l’écologie, de l’économie et de la planification du paysage, de géographie sociale et des politiques publiques.
En revanche, dans celles qui n’ont pas de dominante scientifique ou technique, et qui inclinent plus vers l’art du landscape design et du urban design, l’implantation des activités de recherche reste plus délicate. Car la plupart de ces écoles ont choisi une pédagogie où plus de la moitié des enseignements pendant 4 ans repose sur des ateliers de projets et des formations artistiques. Ces ateliers sont encadrés par des praticiens qui ont peu ou pas de contacts avec la recherche scientifique. En outre les enseignants-chercheurs non praticiens restent minoritaires dans ces écoles.
Plusieurs conséquences en résultent. Pour ces enseignants praticiens, la recherche qu’ils sont prêts à soutenir est celle qui leur permet d’acquérir des avantages concurrentiels sur le marché des professionnels de l’architecture de paysage ; mais également de former une élite de jeunes paysagistes « en avance » sur ceux des autres écoles. Contrairement aux universitaires (en France au moins), ils s’intéressent peu à la capitalisation des savoirs et des savoir-faire, et à la création de connaissances nouvelles universelles partageables, car les paysagistes docteurs sont rares (12 en France en 2011). Les enseignants praticiens participent donc rarement à des programmes de recherche scientifique, comme ceux de l’Agence Nationale de la Recherche en France. Enfin, quand des unités de recherche s’installent dans ces écoles par la volonté des ministères publics de tutelle, il est fréquent que de nombreuses réticences se manifestent. Résistances d’autant plus insistantes et légitimes que la sélection des nouveaux enseignants chercheurs titulaires exige le doctorat, et que les praticiens paysagistes disposent d’un pouvoir effectif dans la gestion des établissements.
De quelles unités de recherche et de quels types de recherche et de doctorat ont alors besoin ces écoles ? Sachant que des formations doctorales en landscape architecture se sont mises en place avec succès dans certaines universités ou écoles : notamment en Grande-Bretagne (Edimbourg), en Allemagne (Hanovre), en Italie (Florence), en Autriche (Vienne) et en France (Versailles).
Pour que, dans un laboratoire de recherches d’ école, les enseignants-chercheurs non praticiens ne restent pas isolés des praticiens enseignants non chercheurs, il me semble nécessaire de réunir au moins trois conditions :
1. Créer et développer une première unité de recherche consacrée à l’amélioration et au perfectionnement de la créativité des concepteurs (des projeteurs). Ce qui veut dire que les chercheurs sont recrutés par cette unité pour travailler, de manière pluridisciplinaire, avec les concepteurs enseignants sur les facteurs qui limitent leur capacité d’invention des formes, fonctions et usages des espaces aménagés. Et qu’ils sont disponibles, avec les praticiens, pour communiquer ces savoir-faire innovant aux futurs paysagistes et aménageurs en publiant les résultats obtenus et en les enseignant.
2. Créer et animer dans le même temps une seconde unité de recherche où tout ou partie des chercheurs précédents développent leurs pratiques (mise en œuvre de programmes de recherches) au sein de la communauté scientifique dont ils font partie. Que ces chercheurs soient géographes, juristes, historiens, biotechnologues, philosophes, politologues, etc.
3. Augmenter le nombre de paysagistes praticiens docteurs en adaptant le cursus de formation doctorale et ses débouchés, notamment dans le domaine émergeant des sciences de la conception de projets.
La première unité de recherche à un laboratoire de créativité paysagère à devrait regrouper autour de thématiques professionnelles et appliquées, des praticiens concepteurs (paysagistes, architectes, éclairagistes, fontainiers, designers, urbanistes), des artistes (plasticiens, musiciens, sculpteurs, photographes, etc.) et des écrivains, des critiques d’art et des philosophes (phénoménologues, herméneutes, épistémologues), et des scientifiques de toutes natures (botaniste, écologue, hydrologue, sociologue, historien, géographe, etc.) Définies avec les praticiens, les thématiques abordées seront exploratoires dans le cadre d’expérimentations de projet et d’observations in situ. Elles chercheront à trouver, décrire et évaluer des solutions formelles et fonctionnelles innovantes à des questions anciennes ou nouvelles de projet de paysage, de l’échelle du territoire à celle du lieu et du jardin. Quelle que soit la nature des spatialités et des temporalités concernées. Chacune de ces recherches, inscrite dans un programme à financer (pouvoirs publics, mécénats, entreprises), fera l’objet de publications collectives ou individuelles associant les participants. Les revues comme Jola, Topos, Les Carnets de paysage et Projets de paysage en sont des supports appropriés.
Dans la seconde unité de recherche à une unité mixte de recherche (UMR) en France à, les chercheurs mettent en œuvre avec des financements externes (ANR, région, Etat, entreprise) les programmes de recherche validés par leurs unités et leur conseil scientifique d’école. Ils peuvent le faire dans le cadre du laboratoire de créativité paysagère ou en dehors, de manière mono ou pluridisciplinaire. Ces chercheurs relèvent notamment des domaines des sciences biologiques (écologie du paysage, écologie de la restauration), géographique (sociogéographie, géographie culturelle, géographie historique), historique (histoire de l’art, histoire des sensibilités culturelles, archéologie du paysage), de l’ethnologie et de l’anthropologie (ethnosciences), de la sociologie et des sciences politiques, de l’économie du paysage, des sciences de la conception des projets d’aménagement de l’espace et de l’ingénierie paysagiste et écologique (biotechniques). Les publications peuvent être faites aussi bien dans les revues déjà évoquées que dans des revues spécialisées dans les différentes disciplines appliquées et fondamentales, par exemple Landscape Research, Landscape Journal, Landscape and urban planning, Natures, sciences et sociétés.
L’association forte (jumelage) de ces deux unités de recherche devra être validée par les écoles dans le cadre des évaluations institutionnelles nationales (AERES en France). Cette association est réalisée de fait dans la plupart des écoles européennes qui ont développé une structure de recherche académique de manière pragmatique.
Dans cette structure idéale de recherches, la préparation à l’inscription au doctorat se fera dans le cadre des masters, post masters (post gradués) et des écoles doctorales. Elle s’adressera autant à des architectes paysagistes ayant suivi un parcours recherche au sein d’un master (bac %2B 5 ou 6 ans), qu’à d’autres diplômes de niveau master issus des disciplines citées ci dessus. Le doctorat (3-4 ans) à diplôme universitaire attestant de l’aptitude à réaliser une recherche scientifique débouchant sur une innovation, quelle qu’en soit la nature à sera en principe préparé avec un financement (dans le cadre des programmes précédents de recherches ou avec une allocation directe d’entreprise ou de collectivité). Il débouchera autant sur un emploi dans une agence, un bureau d’étude ou une collectivité, que dans l’enseignement supérieur ou la recherche, les premiers emplois cités pouvant préparer les seconds.
23 mai 2011
Vous avez dit structure paysagère ? par P. Donadieu
Dans la loi française n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d’enquêtes publiques, l’expression de structure paysagère a été retenue par le législateur.
« Art. 1er. – Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en concertation avec les collectivités territoriales concernées et lorsque lesdits territoires ne sont pas l’objet de prescriptions particulières prises en application de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, l’Etat peut prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages.
Ces directives déterminent les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères qui sont applicables à ces territoires. »
Depuis 18 ans, cette notion a été mobilisée par les responsables des services publics gouvernementaux (DIREN, puis DREAL) et par les paysagistes, pour appliquer les politiques publiques paysagères, notamment pour élaborer des plans et des chartes intercommunales de paysage. Or la structure paysagère n’a jamais été définie, comme dans la Convention européenne du paysage de Florence où les concepts juridiques importants le sont. C’est donc l’usage de cette expression qui permet aujourd’hui ne lui donner des significations plus précises.
L’observation de ces usages, notamment chez les paysagistes concepteurs de politiques publiques paysagères, suggèrent trois sens différents. Le premier est lié à l’échelle géographique des projets urbains et de territoires. Cette échelle est celle des analyses et des projets qui définissent des enjeux et des actions qui concernent des collectivités publiques : régions, départements, pays, communautés urbaines, de communes et d’agglomérations, communes. À ces échelles cartographiques (que les paysagistes en inversant les codes géographiques appellent la « grande échelle »), on parle de structure paysagère comme structure structurante d’un territoire de collectivité. Ce qui appelle d’autres mots comme charpente, ossature, armature, squelette, support, substrat … paysagers. Ainsi interprétée, la structure paysagère est la matrice matérielle, produite par des actions naturelles et humaines, qui organise un espace objet de politiques paysagères. Par exemple, la charpente paysagère du SCOT de la communauté urbaine de Bordeaux est illustrée par une image cartographique qui représente les modes d’articulation de la ville avec la vallée de la Garonne, les reliefs des zones rurales, notamment viticoles, et les espaces forestiers.
La deuxième acception utilise le pluriel : les structures paysagères. Celles-ci sont des structures constituantes de la matérialité structurante objective et s’appellent en général des unités paysagères au sens géographique classique. Elles sont dénombrables et cartographiables, par exemple dans le parc naturel régional d’Auvergne, on en a compté environ 350. Elles expriment des unités de formes et/ou d’utilisation du sol : urbaines, agricoles, forestières, littorales, montagnardes, steppiques, etc. Ces unités peuvent être décomposées en sous-unités (urbaines et périurbaines par exemple) ou regroupées en ensembles selon les échelles de représentations cartographiques. Leur agencement relatif (selon par exemple l’altitude, la morphologie, l’histoire ou l’écologie des milieux) définit la structure structurante (charpente, ossature) du territoire concerné. Les structures paysagères sont associées à des significations qui sont les mêmes pour tous ceux qui savent lire les cartes en fonction d’une légende qui explique des codes graphiques : elles traduisent la nature et la localisation des unités à partir de critères physionomiques, géomorphologiques, démographiques, économiques, juridiques, historiques, etc. L’unité paysagère cartographiable est analytique (mono ou plurithématique) ou synthétique. C’est la base de la démarche de la constitution des atlas de paysage qui ont couvert le territoire français à partir de 1996.
Le troisième sens de l’expression structure paysagère rend compte de la pluralité des sens possibles des unités paysagères. Les structures signifiantes expriment, pour les tenants de l’école culturaliste française de paysage, les relations que les humains établissent avec un milieu (au sens de la mésologie du géographe Augustin Berque) à travers les prises paysagères qu’ils privilégient. Ces structures matérielles, encore appelées entités paysagères par le paysagiste Bernard Lassus, fondent les possibilités d’initier des affects (sensations, émotions, impressions, sentiments) et donc des jugements. Ceux-ci peuvent être à caractères esthétiques (beau/laid), esthésiques (plurisensorielles) ou éthiques (ce qu’il est bon/bien ou mal de protéger ou de transformer). Les structures signifiantes définissent des potentialités paysagères, c’est-à-dire offrent des possibilités localisées de choix interprétatifs (liberté au sens du concept de capability de l’économiste nobélisé Amartya Sen) pour les percevants en fonction de leur nature et de leurs intentions. Les démarches dites sensibles des paysagistes s’appuient surtout sur la mise en évidence (reconnaissance sensible) des structures signifiantes qui s’inscrivent et correspondent pour tout ou partie aux unités paysagères décrites précédemment dont elles peuvent reprendre la terminologie. Un exemple : dans l’unité paysagère « volcans » (structure structurante et constituante), le sens identitaire régional peut être lié au non boisement de la partie sommitale du cratère (structure signifiante symbolique) qu’il faudrait conserver.
Selon ces trois acceptions interactives, la structure paysagère est devenue un concept outil pour inventorier les paysages d’un territoire et les inscrire dans une dynamique de conservation inventive ; pour préserver et promouvoir leur diversité et leurs effets et significations possibles sans les muséographier ; et afin de construire démocratiquement des biens communs paysagers grâce à des processus sociaux et spatiaux de gouvernance des projets, et de partage des connaissances plurielles des territoires concernés.
16 mai 2011
Michel Desvigne, Grand Prix de l’urbanisme 2011, par P. Donadieu
Au début du mois de mai 2011, le Grand Prix de l’urbanisme 2011 a été attribué au paysagiste Michel Desvigne par le jury du ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, présidé par Jean-Marc Michel, directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature.
Né à Montbéliard en 1958, diplômé (paysagiste DPLG) de l’École nationale supérieure du paysage de Versailles en 1984, élève de Michel Corajoud, Michel Desvigne est surtout connu pour ses travaux de reconquête urbaine à l’échelle territoriale, qui mettent en valeur les grandes lignes géographiques des paysages. En témoignent les deux phases de Lyon-Confluence avec les architectes François Grether côté Saône, puis avec Jacques Herzog et Pierre de Meuron côté Rhône, le projet d’aménagement des 7.700 hectares du plateau de Saclay avec les architectes Floris Alkemade et Xaveer de Geyter, ou le réaménagement du Vieux-Port de Marseille pour lequel il a été désigné, à l’automne 2010, lauréat mandataire en partenariat avec l’architecte anglais Norman Foster.
Après sa sortie de l’ENSP de Versailles, il a créé son agence en 1988, qui réunit aujourd’hui 25 collaborateurs. Depuis cette date, il a conduit, seul ou associé avec des architectes et des paysagistes, une cinquantaine de projets et d’études en Europe, en Amérique du nord et en Asie. Il est professeur invité à l’Institut d’architecture de Genève en Suisse de 1994 à 1998, puis en 1999 à l’Université d’Harvard aux États-Unis. Depuis 2010, il préside le conseil d’administration de l’École nationale supérieure du paysage de Versailles-Marseille.
Cette distinction est une étape supplémentaire, depuis 10 ans en France, dans la reconnaissance, par les pouvoirs publics et les urbanistes, des architectes paysagistes en tant que « Faiseurs de villes »[1]. Ce mouvement a commencé par l’attribution du prix de l’urbanisme aux architectes paysagistes Alexandre Chemetoff en 2000 et Michel Corajoud en 2003. Dans l’ouvrage Les faiseurs de villes, il s’est poursuivi avec l’article que Hélène Harter consacre au pionnier américain de l’architecture du paysage que fut Frédéric Law Olmsted, créateur de Central Park à New York. Les finalités sociétales du paysagisme (la qualification de l’espace public, sa mixité sociale, la mise en scène de la ville) sont en effet devenues en France plus explicites et convaincantes qu’à l’époque des « paysagistes planteurs » (années 1950-70). Et, dans la mesure où l’urbanisme réglementaire se désintéressait des formes urbaines, les concepteurs paysagistes ont trouvé, à la faveur des politiques publiques de paysage, des marchés publics pour lesquels les architectes et les urbanistes n’étaient pas bien préparés.
La démarche professionnelle de Michel Desvigne se distingue de celle de ses confrères par l’intérêt qu’il marque pour l’outil de projet en tant qu’instrument de mise en oeuvre d’un processus de transformation et non de composition esthétique d’un site. James Corner, professeur de paysagisme à l’université de Philadelphie le note clairement dans l’introduction de Natures intermédiaires (2009)[2]. Autrement dit, M. Desvigne conçoit les formes des paysages en tant qu’elles vont être produites dans des temporalités longues par les acteurs des territoires. Partant du principe, comme dans une succession végétale en écologie, que les formes paysagères se substituent les unes aux autres au cours du temps, il inscrit celles-ci dans une cartographie qui indique la direction possible du mouvement. Pas de style d’auteur, ni de représentation symbolique. Les formes végétales et donc vivantes se donnent à voir en tant que textures du monde sensible, sans être achevées, ni promettre de l’être un jour.
À ce titre, il marque dans sa génération de paysagistes ceux qui semblent avoir trouvé, dans l’éthique du développement durable et les sciences écologiques, une inspiration pour des alternatives « au bucolique statique et au vaguement pittoresque » (J.Corner). Autant en produisant une infrastructure de natures techniquement malléables à l’avenir, car réversibles, qu’en donnant à celle-ci une lisibilité immédiate par des densités variables. Pas de belles images donc, ni d’explications à donner, rien de photogénique, seulement « des territoires communs à édifier » (Desvigne, 13).
Ses travaux d’urbanisme portent le nom de « plans de développement urbain et paysager ». Ils s’inscrivent dans la mouvance d’ idées du landscape urbanism inventées à Chicago par l’architecte Charles Waldheim en 1997, puis développées, entre autres, par le paysagiste designer James Corner. Le projet pour la ville d’Issoudun en 2005, qui avait suivi celui du Millenium park de Greenwich à Londres de 1997 à 2000 semble avoir joué un rôle important dans la mise au point de sa démarche actuelle. À Londres, il installe une matrice végétale sur un site post industriel aux sols pollués, préparant ainsi des activités et des usages indéfinis. À Issoudun, petite ville de province aux limites rurales incertaines, il inventorie et cartographie l’organisation parcellaire rayonnante du territoire, et prépare la substitution des activités dans le cadre d’héritages cadastraux peu lisibles : « ainsi tout demeure en place mais change de nature » (Desvigne, 69). Méconnues, les vallées qui traversent la ville peuvent devenir « une ossature végétale puissante capable de structurer le paysage d’Issoudun », et recevoir des cheminements, des boisements, des vergers, des terrains de sports, des équipements, des écoles, des habitations.
Il s’agit moins d’un projet au sens habituel de la profession de paysagiste, qu’une stratégie d’urbanisme adapté aux sites et aux villes soumis à des processus d’abandon. Comme à Detroit où est née l’idée de la reconquête nécessaire des friches industrielles dans le centre des villes. Comme dans le nord et l’est de la France où M. Desvigne, avec A. Chemetoff et M. Corajoud, avait appris les démarches de « mise en patience et en attente » des sites miniers et industriels abandonnés. En mobilisant notamment les techniques de préverdissement et de prise en compte des trames foncières.
L’école française de paysagisme, qu’il a contribué à créer et à faire connaître outre atlantique, a peut-être apporté aux Etats-Unis l’idée que le libéralisme économique ne pouvait accepter de laisser derrière lui des Drosscapes [3], des paysages de déchets, de ruines et de déréliction. Car il faut reconnaître aux pouvoirs publics français le souci depuis les années 1980 de chercher à masquer, à atténuer, mais surtout à reconquérir les sites marqués par les crises économiques et sociales régionales Ce nouvel urbanisme paysagiste à qui est un nouveau paysagisme à est très proche de celui décrit par l’urbaniste et Grand Prix de l’urbanisme en 2009 François Ascher (2008)[4]. Il en précise les temporalités et les spatialités, domaines dans lesquels l’urbanisme ordinaire semblait muet. Je l’ai appelé géomédiation paysagiste (Donadieu et Rejeb, 2009)[5] car il met en place des dispositifs spatiaux et sociopolitiques, et s’appuie sur des projets sociétaux comme instruments réflexifs de connaissances et d’actions.
Faire la ville non avec l’architecture mais avec le paysagisme est aujourd’hui l’ambition des tenants du landscape urbanism.
[1] PAQUOT T., (textes rassemblés par), (2010). Les faiseurs de villes, Infolio, Archigraphy.
[2] DESVIGNE M., (2009). Natures intermédiaires, Birkhäuser Verlag, Bâle.
[3] BERGER, Alan. (2006). Drosscape: Wasting Land in Urban America. Princeton Architectural Press. New York
[4] ASCHER F., (2008). Les nouveaux principes de l’urbanisme, L’Aube, La Tour d’Aigues.
[5] DONADIEU P., REJEB H., (2009) . Abrégé de géomédiation paysagiste, Tunis, Imprimerie nationale, Institut Supérieur d’Agronomie/Université de Sousse.
9 mai 2011
L’éthique paysagiste : rationaliste pratique ou idéaliste ? par P. Donadieu
Dans son métier habituel, l’architecte paysagiste vise la satisfaction d’un client. Si celui-ci est un commanditaire public (une collectivité par exemple pour aménager un espace public), il attend du professionnel que l’espace satisfasse sa commande, respecte son contrat professionnel et le cahier des charges, et lui donne des garanties de qualité des travaux. Ce qui engage également l’éthique du paysagiste.
Il ne saurait en effet livrer un espace interdit à des groupes religieux ou ethniques, gaspillant les énergies et l’eau, nécessitant des pesticides dangereux pour la santé des usagers et des ouvriers, ne dissuadant pas le commerce de drogues illicites et la prostitution, et acceptant l’usage libre des armes. Régulé par les idées du bien et du mal, de la vertu et du vice, l’espace public est d’abord un espace social et politique. Pour faire un choix d’aménagement, le concepteur et sont client peuvent hésiter entre plusieurs postures.
S’ils ont recours au raisonnement du philosophe grec Platon, il s’agira de dépasser les images trompeuses de séduction (un décor végétal appétissant) dissimulant des réalités sociales peu flatteuses (la vente de drogues, la mendicité). Ce qui ne peut se faire qu’en fonction des idéaux du bien, du vrai et du beau en soi selon des modèles convenus héritées de l’art des jardins, de l’architecture et des villes, ou de leurs critiques ; car les sociétés humaines sont trop inconstantes et passionnelles pour inspirer des solutions fiables.
S’ils font confiance à la raison pratique d’ Aristote, prudents et empiriques, ils adapteront leur réponse à la nature du site, à son histoire, à sa localisation et aux besoins de ses usagers. Et c’est sur le principe de plaisir d’Epicure (-342 -370 av.J.-C) et de son jardin à Athènes qu’ils pourront fonder le critère de ce qui est bien, c’est-à-dire utile à la sécurité et à la santé psychique et physique des usagers, en engendrant l’absence de troubles (ataraxie).
Les dieux grecs (et d’autres origines) ayant disparu, l’éthique contemporaine, même si elle a hérité de cette période historique les notions de raisons théorique et pratique, a changé. À l’image de la réflexion politique de la philosophe Hanna Arendt (1906-1975), elle peut exiger le devoir d’interpellation au nom de causes jugées justes. Ce que peuvent faire les paysagistes et les artistes qui donnent à leurs oeuvres un rôle de manifestes professionnels et politiques pour réveiller les consciences endormies.
Ou bien, le paysagiste et son client peuvent rester méfiants envers les principes moraux où les valeurs (comme la dignité humaine) dont l’universalité n’est pas démontrée et qui ne permettent pas de distinguer ce qui est moral et immoral. Dans la philosophie éthique analytique (strictement logique) de Ruwen Ogien, « ne sont condamnables que les pratiques qui nuisent à autrui » [1] et nécessairement avec des intentions malveillantes. C’est le cas du problème des incivilités dans les espaces publics qui dépendent surtout des normes sociales imposées par le contrôle social et le gardiennage. Le recours à la dignité humaine pour interdire la prostitution, la burqua, la drogue ou l’abus d’alcool dans les jardins publics relève sans doute plus de l’injonction politique et légaliste que morale.
Il est vrai que ces questions concernent plus les gestionnaires d’espaces publics que leurs concepteurs. Toutefois, l’élargissement rapide des marchés paysagistes à la planification territoriale pose aux professionnels la question de discerner les caractères des paysages qui sont beaux, bien et bons pour tous, ou la manière dont ils doivent le devenir.
Un paysagiste plutôt platonicien s’appuiera sur les qualités idéales et universelles qu’il reconnaîtra aux paysages d’un territoire, arguant du fait qu’un autre confrère aboutira certainement au même résultat. S’il est adepte du légalisme kantien, il verra dans l’adoption de ses préconisations planificatrices par les règles d’urbanisme et d’environnement communales, la confirmation de son utile diagnostic d’expert[2].
Rationaliste pratique, un paysagiste aristotélicien et épicurien mesurera l’adéquation de ses propositions aux plaisirs supposés que les habitants en retireront ; adaptera la politique paysagère territoriale aux dynamiques en cours et défendra le projet d’actions réalisables en fonction des moyens disponibles et des choix possibles. S’il est tenant de l’éthique analytique de Ruwen Ogien, il fera de la non nuisance à autrui un principe d’action, ce qui donnera un cadre éthique à une production libérale des paysages, sans la nécessité du légalisme et du formalisme kantien.
En pratique, car l’analyse précédente est une caricature des professionnels, les paysagistes mêlent ces postures éthiques en fonction des situations et des marchés. Ils restent le plus souvent pragmatiques et opportunistes dans le cadre des valeurs morales de leurs clients.
[1] Patrick Ducray, « Tactiques de l’éthique analytique », Le Magazine Littéraire, Janvier 2011, n°504, pp. 88-89
[2] Antoine Grandjean, « Kant une question de formule», Le Magazine Littéraire, Janvier 2011, n° 504, p. 78-80
2 mai 2011
Petite théorie du paysagisme urbain 3, par P. Donadieu
Dans les dernières chroniques (n° 65 et 66), nous avons montré : 1/ comment le projet de paysage pouvait être interprété comme un processus d’inflexion permettant de privilégier les formes paysagères choisies aux dépens d’autres..2/ Comment une théorie métascientifique du paysagisme pouvait être élaborée pour dépasser l’opposition entre nature et culture.
Dans cette chronique, je vais appliquer cette théorie au couple ville/nature en utilisant le cadre du tableau de la chronique 65.
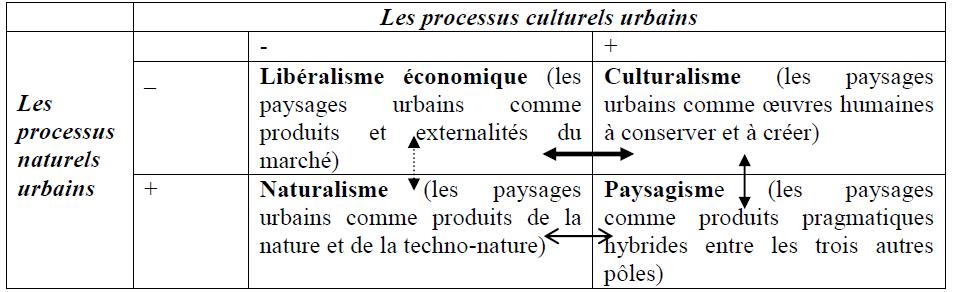
La notion d’urbain est distinguée de celle de ville (Paquot, 2010). Géographiquement, elle désigne les territoires des régions urbaines (Forman, 2008), par exemple une communauté urbaine ou d’agglomération. Pour cette raison, elle réunit des espaces construits agglomérés, compacts et denses, et des espaces non construits (boisements, agricultures, parcs, espaces naturels et aquatiques, etc.).
Quand les paysages urbains sont construits surtout sur la base d’une logique de marchés libres (achats et ventes de fonciers, de logements, d’entreprises industrielles, de services commerciaux, etc.), les paysages peuvent être compris selon une logique libérale peu régulée : ils résultent moins d’un projet urbain volontaire que du fonctionnement peu encadré des marchés. Ces marchés engendrent des externalités paysagères négatives (destruction d’aménités, sites abandonnés post industriels ou post agricoles, paysages de slums et favelas) ou positives (conservation privative des patrimoines historiques, gentrification). Par exemple, dans les métropoles de Sao Paulo et de Mexico.
Quand les paysages urbains sont construits surtout à partir de valeurs culturalistes, ils privilégient la protection et la valorisation des héritages historiques (monuments et sites), la mise en valeur des mémoires locales, régionales et nationales, la mise en spectacle des scènes sociales et culturelles (sports, théâtre, concerts, parcs et places publics) et leur mise en évènements publics, à fonctions commerciales ou non. Ces processus font appel à des financements publics, associatifs et privés. Ils se traduisent autant par la création de villes, quartiers et domaines privatifs et surveillés que par la gentrification des quartiers et la patrimonialisation des centre villes. Ainsi des villes européennes comme Paris, Amsterdam Rome ou Londres.
Quand les paysages urbains font une large place à des valeurs naturalistes, comme dans certaines villes canadienne, britannique, suisse, allemande, autrichienne, ou néerlandaise, les processus écobiologiques y sont favorisés dans des réseaux de parcs publics et de cours d’eau. Souvent le cadre de vie de ces villes comme Zurich ou Vienne est considérés comme très attractif pour des raisons à la fois naturalistes (la nature biologique maîtrisée dans la ville) et culturalistes (les spectacles, les monuments historiques, les loisirs, les parcs publics, les quartiers multi ou mono ethniques, etc.). Les formes biologiques de nature peuvent être liées à des espaces contrôlés publics ou privés (zoos, jardins botaniques, parcs, rues et places) ou non (décharges d’ordures ménagères, zones inondables, espaces agricoles et boisés, bidonvilles, etc.).
Enfin, quand les acteurs publics et privés des régions urbaines font appel aux pratiques paysagistes, ils attendent des biens et des services naturels/culturels qui conjuguent les trois pôles précédents : le recours aux marchés, la création de biens culturels et l’accompagnement des processus naturels (le risque d’inondation ou d’érosion de la biodiversité locale par exemple). Pragmatique, le paysagisme n’est jugé que sur l’efficacité des résultats fonctionnels et formels obtenus, spectaculaires ou imperceptibles.
Plusieurs outils sont disponibles : acheter des espaces naturels permet à l’Etat, une région, un département ou une collectivité urbaine d’irriguer les régions urbaines avec des réseaux aquatiques et verts, forestiers et agricoles, quand la protection juridique des sols contre l’urbanisation ne suffit pas ; préfigurer, aux yeux des élus, les états transitoires d’une transformation souhaitable pour le bien être commun d’un quartier ou d’une ville (Le travail innovant du paysagiste Michel Desvignes pour le futur parc fluvial de la Garonne à Bordeaux en est un bon exemple ) ; désigner les caractères visibles qui vont permettre d’identifier un paysage méconnu ; résister à des projets imposés top down sans concertation ; reconnaître les multiples initiatives émergentes : autant de petites actions dont le résultat global est d’infléchir le devenir des espaces en jeu vers des destinations bénéficiant localement au plus grand nombre.
25 avril 2011
Petite théorie du paysagisme 2, par P. Donadieu
Une théorie paysagiste est-elle plausible, qui dépasserait l’opposition entre paysages culturels et paysages naturels ? Elle pourrait trouver une formulation générale pour exprimer les relations de transformation mutuelle qu’induisent les relations entre la culture (ce qui est pensé, construit et produit aujourd’hui par et pour les hommes) et la nature (ce qui ne dépend pas des hommes, mais peut supposer leur action (la technonature) pour eux et par eux) ; entre par exemple les villes denses, leurs lieux historiques et culturels, et leurs infrastructures paysagères (parcs, boisements, espaces agricoles, cours d’eau).
La notion de nature est conçue dans cette théorie comme un processus géoécobiologique dynamique (l’évolution de la biodiversité, de l’étendu et de la structure des espaces boisés, herbacés et aquatiques, de la qualité de l’eau, de l’air, etc.), régressifs àsigne moins dans le schéma ci-dessous – (la surface de l’espace naturel diminue et sa structure s’uniformise), et progressifs – signe %2B – (l’espace de natures s’accroît, sa structure se complexifie, et par voie de conséquence sa biodiversité peut augmenter). Sans que l’on préjuge de la perception de ces processus, de leurs caractères malfaisants (les risques, les peurs) ou bienveillants (les aménités naturelles) pour les hommes.
De même la notion de culture est définie comme un processus sociogéographique de transformation des formes perceptibles des espaces, des pratiques et des comportements humains dans le cadre des valeurs et de l’histoire d’un groupe ou d’une société. Les caractères culturels d’un groupe (sa langue, ses arts, sa religion, ses croyances, ses architectures, ses paysages, ses modes vestimentaires, ses coutumes, etc.) peuvent s’étendre et se complexifier (%2B) dans un espace géographique ou au contraire s’appauvrir et s’éteindre (-), au profit ou aux dépens d’autres groupes.
Le tableau suivant schématise les interactions que déclenchent les transformations invisibles de la culture et de la nature interagissantes entre quatre pôles de production de paysages :
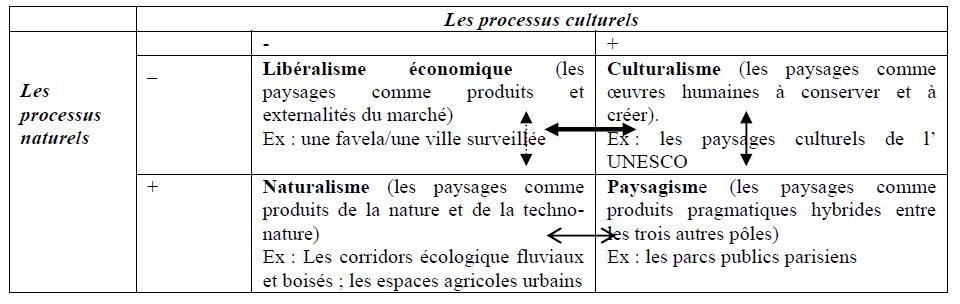
Quatre systèmes d’idées en interaction sont à l’œuvre. Le libéralisme, au sens économique et politique, est un cadre de processus paysagers (sociaux et spatiaux) dans lequel les formes et les fonctions des paysages sont des produits directs du marché (de la culture, du tourisme et des loisirs par exemple) ou indirectes (des externalités paysagères positives ou négatives) : les paysages des rivages pour le marché immobilier. Quand il est à l’œuvre sans régulations étatiques, les productions de biens et de services culturels régressent, et engendrent des lieux aux qualités discutables (les favelas par exemple). Voir entre autres les travaux d’économie du paysage dirigés par Walid Oueslati (Agrocampus ouest) et d’économie de la proximité de André Torre (INRA SAD), mais également ceux de géographie sociale (Michel Lussault).
Culturalisme et naturalisme[1] s’opposent. Pour les culturalistes (les tenants de la culture au sens de la conférence mondiale sur les politiques culturelles de Mexico de 1982[2]), les paysages peuvent devenir des œuvres humaines dans toutes sociétés : de la peinture et de la photographie de paysage, de la littérature, de l’architecture, de l’urbanisme et du jardinisme, des sociétés locales vernaculaires également. Leurs produits et services s’échangent de plus en plus sur toutes sortes de marchés (immobilier, de l’art, de la littérature et du tourisme notamment). C’est le sens de la double flèche au trait épais.Ils se développent à la faveur d’une régression des faits de nature écobiologique Voir les travaux de A. Roger, S. Schama, B. Lassus, M. Collot, J.-P. Le Dantec, M. Baridon, B. Lizet, F. Dubost, entre autres.
Pour les écologues du paysage (et non les écologistes), que j’appelle ici naturalistes (au sens des scientifiques de la nature), les paysages sont des organisations d’espaces matériels et de milieux de vie qui conditionnent l’existence et la diffusion des populations végétales et animales spontanées (et leur indicateur : la biodiversité), et de ce fait les conditions matérielles et les aménités de la vie humaine et non humaine. Les produits et services de ces paysages entrent également dans l’économie de marché via les processus de mise en biens culturels (patrimonialisation et mise en tourisme des parcs naturels par exemple). Ils se développent à la faveur d’un affaiblissement des activités culturelles, notamment dans la périphérie des régions urbaines. Voir les travaux de H. et O. Décamps, de J. Baudry et R.T.T. Forman, entre autres.
La dernière catégorie, le paysagisme définit une posture de pensées (la paysagétique selon la philosophe Catherine Chomarat-Ruiz) et des pratiques paysagistes (l’architecture du paysage) qui dépassent les oppositions entre nature et culture. C’est une posture pragmatique (au sens du philosophe français des sciences Bruno Latour) qui admet que les résultats transitoires des processus de modification-transformation des paysages matériels sont aussi importants que les pensées et les valeurs culturelles qui les engendrent. Le paysagisme ainsi nommé est à l’origine de produits et services tant culturels que (techno)naturels, qui peuvent être échangés sur un marché, mais peuvent également rester dans la sphère publique (l’entrée gratuite des parcs publics par exemple). Il se développe particulièrement quand les politiques publiques urbaines favorisent autant les structures paysagères de nature (corridors biologiques) que de culture (parcs publics) qui peuvent se confondre.
Ce schéma théorique montre que la notion de paysagisme peut exprimer la pensée pragmatique des processus socio-spatiaux et politiques qui transforme les faits de nature en faits de culture. Il peut permettre d’interroger et de comprendre les pratiques des professionnels du paysage, tels que je les ai définis dans Les paysagistes (Actes Sud, 2009), en tant qu’ils accompagnent les transformations visibles et invisibles des mondes habités.
[1] Ces deux notions en àisme, comme les deux autres, sont idéologiques au sens de l’ensemble des idées et des valeurs communes dans une société.
[2] « La culture… est considérée comme l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeur, les traditions et les croyances. ». Elle est l’objet de l’anthropologie culturelle (culturalisme) et de la géographie culturelle (P. Claval et G. Di Méo).
18 avril 2011
Petite théorie du processus de projet de paysage 1, par P. Donadieu
Les architectes paysagistes disposent d’un outil essentiel : le projet de paysage. De la même manière que les architectes qui font usage du projet d’architecture, que les urbanistes du projet urbain et les ingénieurs du projet d’ingénierie.
Au début des années 2000, les chercheurs français ont commencé à théoriser cette démarche de conception : les uns selon une posture phénoménologique[1], les autres[2] en mobilisant la théorie de l’artialisation du philosophe Alain Roger, ou les concepts médialistes du géographe Augustin Berque[3]. Ces théories ou leurs applications permettent surtout de rendre compte de la posture culturaliste des concepteurs créateurs de formes dans des œuvres paysagistes. Elles paraissent moins pertinentes cependant pour comprendre ce que les géographes appellent la production de l’espace matériel, faisant appel à ses fonctions, à ses acteurs, à ses règles et à ses représentations, notamment à ses paysages.
Le concept clé, qui articule le projet de paysage et la production de l’espace, est la notion de processus. Le processus (process en anglais) désigne la succession de faits, orientés, souvent prévisibles, réversibles ou non. Il peut être naturel (l’érosion marine d’une falaise) ou non (le processus d’étalement urbain). La notion de processus désigne également toute suite d’opérations ordonnées aboutissant à un résultat. De ce point de vue, le projet de paysage, pour un architecte paysagiste, est un processus qui a un début (la commande d’un client) et une fin : le plus souvent une réalisation d’aménagement paysager ou la mise en œuvre d’une stratégie paysagère supposant une politique publique de paysage sur un territoire.
Dans la culture occidentale, le projet de paysage (hérité du projet de jardin) est un outil qui a pour but de mettre en place des lieux qualifiés publics et privés. Il suppose des modifications des espaces en fonction d’un programme de fonctions et d’usages (leurs « mises en paysages »), mais aussi parfois à des ruptures douloureuses, sociales et culturelles, avec les lieux anciens. Il traduit le plus souvent une idée (du maître d’ouvrage et de ses conseillers), et un concept (du designer) en matérialités (une place, une avenue, un jardin de quartier, un bord de cours d’eau). Dans ces cas ordinaires du métier de paysagiste concepteur et planificateur, le processus de transformation de l’espace est mis en œuvre par la procédure du projet de paysage dans le cadre de projets urbains et de territoires.
Or ces procédures de projet rencontrent de multiples difficultés pour être mises en œuvre. Certes, elles peuvent être efficaces quand les pouvoirs publics (gouvernementaux, régionaux ou urbains) savent composer avec les acteurs sociaux (gouvernance). Cependant le pouvoir d’injonction des Etats diminue inexorablement dans les démocraties européennes au profit des pouvoirs régionaux et locaux. C’est pourquoi, d’autres stratégies, plus habiles, ne tranchant pas entre les injonctions gouvernementales top down et les pratiques bottom up de participation sociale à la décision publique, doivent être imaginées pour accompagner les modifications de l’espace habité.
On n’a pas conscience, en effet, que la plupart des modifications de l’espace sont accompagnées par des transformations visibles (les paysages) mais surtout invisibles (les forces économiques, sociales et politiques). Ces dernières sont à l’origine des modifications matérielles du monde perceptible. C’est donc en agissant sur ces forces, directement et indirectement, qu’il est possible d’induire de manière souple et durable, des effets sur les paysages matériels. Commander du dedans plutôt que du dehors. Préférer le pragmatisme des stratégies latentes à l’idéalisme des projets politiques spectaculaires.
Le processus paysager est une interminable transition entre des états matériels eux-mêmes transitoires. Agir sur les processus consiste alors à induire des inflexions et non à viser des états finaux utopiques ; à penser le devenir des choses et non leur existence ; les résultats transitoires perceptibles des transformations en action, et non des aboutissements vains ; leurs émergences et leur renouvellement incessant plutôt que leur stabilisation illusoire.
Selon cette théorie, inspirée de la cosmologie orientale[4], le projet de paysage devient plus un accompagnement actif qu’une anticipation volontaire, frontale et idéaliste de la production de l’espace.
Pour illustrer cette idée, prenons l’exemple des politiques agriurbaines qui cherchent à maintenir l’agriculture dans les régions urbaines. Deux forces sociales et économiques sont en présence spatiale, concurrentes : la production des espaces construits et la production de l’espace agricole. Vouloir les maintenir par la planification urbaine ne suffit pas, il faut aussi accompagner les transformations inévitables des agricultures au contact de l’agglomération et de cette dernière au contact des activités agricoles.
Dans ces conditions, quatre situations potentielles apparaissent : l’étalement urbain incontrôlé (la ville et l’agriculture sont perdantes) ; l’agriculture résidentielle (la ville gagne des agricultures urbaines de services -résidentielles et de proximité- où l’entreprise agricole rurale est plutôt perdante) ; l’agriculture périurbaine (l’agriculture ne s’adapte pas ou peu aux marchés de produits et services agriurbains et tourne le dos à la ville qui en perd le bénéfice ; enfin dans la solution dite des campagnes urbaines ou des villes agricoles, les agricultures, les jardinages et les tissus urbains coévoluent à bénéfices réciproques en fonction des situations locales et globales des économies agricoles et urbaines.
C’est en cherchant à induire ces productions de biens et services communs agriurbains que le gestionnaire de paysages, toujours en amont des processus prévisibles, peut agir sereinement avec les acteurs politiques et sociaux pour accompagner des processus de modification-transformation que nul ne pourra prétendre maîtriser.
Agir sur les paysages relève plus du jeu de go que du jeu d’échec !
[1] J.M. Besse, « Cartographier, construire, inventer. Notes pour une épistémologie de la démarche de projet », Les Carnets du paysage, n° 7, 2001, pp. 127-145.
G. A Tiberghien, « Forme et projet », Les Carnets du paysage, n° 12, 2005, pp. 89-103
[2] F. Pousin, « Repères pour un débat » et J.P. Boutinet, « A propos du projet de paysage, repères anthropologiques », Les Carnets du paysage, n°7, 2001.
[3] S. Keravel, « Passeurs de paysages »%u2028publié dans Projets de paysage le 31/12/2008 ; URL : http://www.projetsdepaysage.fr/fr/passeurs_de_paysages.
[4] François Jullien, Les transformations silencieuses, Le livre de poche, Grasset, 2009.
11 avril 2011
La Table de Jugurtha, par P. Donadieu avec la collaboration de I. Zhioua
La Presse de Tunisie du jeudi 9 décembre 2010 écrit : « L’accès à la prestigieuse Table de Jugurtha, un chef d’œuvre de la nature, sera bientôt facilité par l’aménagement et le bitumage d’une route conduisant au pied du rocher fortifié, moyennant des investissements estimés à un million de dinars (environ 500 000 €). Le projet dont le démarrage est prévu au début de l’année prochaine consiste en la mise à niveau de la piste vicinale utilisée, jusque-là, par les seules voitures tout terrain, pour accéder à ce plateau de 1270 mètres d’altitude. Le site a été, d’ailleurs, intégré dans le circuit touristique numide lancé, dans la région du Kef, pour promouvoir le tourisme culturel et écologique ».
Depuis que les hommes voyagent pour leur plaisir, parce qu’ils disposent de loisirs, l’économie touristique met à profit des espaces qu’elle fait « voir comme » des lieux attractifs aux attributs multiples. Sans cette désignation distinctive, l’espace perçu n’entre pas dans l’existence sensible des hommes et leur reste inconnu. Il n’est révélé en tant que site remarquable que par ce qu’il se donne à voir en tant que lieu porteur de significations, grâce aux discours scientifiques médiatisés mais aussi par ce que le géographe Augustin Berque[1] appelle le « corps médial » individuel, fait du lien existentiel de chacun avec le lieu. Ainsi de la Table de Jugurtha près de la ville du Kef.
Jugurtha (160-104 avant J.-C.) était le petit-fils du roi berbère numide Massinissa. Dans la mémoire collective, il reste la figure symbolique de la résistance berbère à l’empire romain auquel il ne voulait pas soumettre son vaste royaume d’Ifriqiya.
L’étude du texte de l’historien romain Salluste (Bellum Jugurthinum) et une mission franco-tunisienne de reconnaissance archéologique menée en 1994 sur la Table de Jugurtha (falaise situé à proximité du village de Kalâat Senan, à la frontière algéro-tunisienne), ont permis aux archéologues de localiser et d’identifier le castellum dans lequel les troupes de Jugurtha s’étaient réfugiées face aux troupes romaines, et qui fut conquis par le Consul Marius après plusieurs mois de siège (106 av. J.-C.)[2].
Le site, attesté comme l’authentique Table de Jugurtha (parmi d’autres sites possibles en Afrique du Nord), est également un site berbère ancien. Ce que confirment les archéologues[3] : « Ce site est archéologiquement vierge et semble assez bien conservé, car éloigné de toutes zones habitables. Des recherches sont nécessaires, car la Table de Jugurtha est un site numide exceptionnel ; la présence de nombreux dolmens, de mégalithes, d’escargotières néolithiques, de blocs sur lesquels est gravé un cercle inscrit dans un triangle (signes de Baâl et Tanit ?), d’une nécropole berbère, montrerait qu’il s’agirait d’une area sacra » .
Pour les géologues, le site est d’abord un plateau calcaire tabulaire (mesa) culminant à 1271 mètres, d’environ quatre-vingt hectares et qui domine par des falaises quasi verticales d’environ 100 mètres un cône d’éboulis arides. De nombreuses sources s’en écoulent au bénéfice des villages voisins. La source d’Aïn Senan assure ainsi à la population locale une alimentation continue et de qualité. La source de M’rada, située à plus de 1000 mètres d’altitude, est exploitée et commercialisée via une mise en bouteilles à Kalaat Senan sous la marque d’eau minérale Dima.
Le lieu abrite un sanctuaire : le mausolée de Sidi Abd El Jaouad, saint patron de la contrée. Pour y accéder il faut gravir un escalier creusé à la main dans la roche et coupé à mi-hauteur par une porte dont l’arc date de l’époque byzantine[4].
En outre le botaniste français Roland Martin a découvert au pied du site en 2005 une orchidée inconnue en Tunisie : l’Ophrys atlantica sous espèce atlantica (Mumby, 1856).
Si les travaux scientifiques et les modes locaux de mise en valeur font de la kalâat un espace authentique, historique, religieux, géologique et botanique remarquable, celui-ci ne devient un site vraiment attractif aux yeux des visiteurs que si les attributs esthétiques d’un paysage à « voir comme » un spectacle attractif lui sont donnés par les images et par les textes touristiques.
« Le Kef, 26 mai 2010 (Rédaction Jamel Tibi) – Véritable chef-d’oeuvre de la nature, la Table de Jugurtha est l’une des merveilles de la Tunisie continentale que la nature a façonnée à 1271 m d’altitude ». Le site « étonne par sa structure tabulaire et par sa somptuosité, tant il constitue une valeur patrimoniale considérable pour la promotion du tourisme écologique et culturel ».[5]
« Située à Kalâat Senan au Kef, la table de Jugurtha est un site magnifique qui témoigne de l’histoire passée des Numides (…) L’un des plus beaux endroits de la Tunisie ! »[6]. Mais, ces images du site, encore rudimentaires et convenues, sont peu diffusées en Tunisie.
Cependant, comme en témoignent certains voyageurs courageux, ce lieu de résistance aux pouvoirs politiques, est devenu symbolique des mémoires locales: « En visitant ce lieu, il y a de quoi « être berbère et le revendiquer avec énergie ». Tout au long de l’escalade, on transpire sa berbérité sous ses aisselles, jusqu’aux creux de ses genoux, entre ses orteils, sur tout son corps »[7].
On y a également organisé en mai 2010 les 5e journées nationales de l’Internet pour la jeunesse. Faciliter l’accès de tous à un site touristique comme la Table de Jugurtha n’a donc pas seulement un sens économique et historique local, mais également politique et national. Ainsi sont constitués sur des sites naturels remarqués, des hauts lieux historiques, creusets de la construction contemporaine des identités culturelles transnationales.
[1] Augustin Berque, Histoire de l’habitat idéal, De l’Orient vers l’Occident, Le Félin, 2010.
[2] L.R. Decramer, « Le castellum de Salluste et la table de Jugurtha » in Revue archéologique n° 58-59, 1995, http://cat.inist.fr
[3] André Berthier, L. R. Decramer et C. Ouasli ; http://www.jugurtha.com/page5
[4]http://co121w.col121.mail.live.com/mail/RteFrame.html?v=15.4.0342.1206&pf=pf#_ftn1
[5] http://www.gazette-press.com,La Gazette de la presse du Maghreb consulté le 28 12 10
[6] www.tuniscope.com/…/ parcs/la-table-de-jugurtha consulté le 28 12 10
[7] http://www.marhba.com/forums/culture-et-histoire-tunisie-38/salluste-guerre-jugurtha-17848.html consulté le 28 12 10
4 avril 2011
Transmettre les patrimoines vivants en les transformant ? par P. Donadieu
Cette question est récurrente aujourd’hui, car selon les experts de ce domaine (les paysagistes, les écologues, les historiens, les archéologues, les ethnologues notamment), le sens des mots patrimoine et vivant n’est pas le même. Et les réponses deviennent parfois incohérentes.
Le patrimoine (heritage en anglais) désigne en principe ce qui est hérité des ascendants pour être transmis aux descendants. Culturel, il est transmis consciemment ou non, de génération en génération[1], dans une famille, un groupe social ou culturel, une région ou une nation. Naturel, et notamment biologique et génétique, il relève de la catégorie précédente. Car il n’y a patrimoine que si un bien matériel ou immatériel est désigné ou revendiqué comme tel par une personne morale ou physique qui en devient alors le titulaire.
Le vivant (life en anglais) est un substantif qui s’est répandu dans le monde scientifique (life science : science de la vie) à la faveur de la montée de la conscience écologique et environnementaliste. Sous la forme des sciences du vivant, il désigne en pratique une catégorie plus large que les sciences de la vie (les sciences biologiques et biotechnologiques). D’abord, parce qu’ainsi il réunit les sciences humaines et sociales de la vie (histoire, droit, anthropologie, économie, philosophie) aux sciences biologiques et écologiques. Une seconde raison est d’introduire l’opposition vivant/mort, qui éloigne des champs scientifiques : le vivant en tant qu’animé s’oppose à l’inerte et à l’immobile, un espace vivant, mobile, évolutif à un espace inanimé, immobile et fixe. On pourrait ainsi englober, comme sciences du vivant : les sciences de la vie, les sciences historiques et géographiques, et les sciences de l’animation de l’espace !
Quand un patrimoine est qualifié de vivant, toutes les significations précédentes sont appelées. Ce qui revient à dire que patrimonialiser un bien vivant, matériel ou immatériel, revient à vouloir, consciemment ou non, transmettre un processus de transformation de ce bien, puisque la vie, au sens propre ou figuré, ne peut être la mort ou l’immobilité. Ce qui aboutit à des apories. Les « trésors vivants » japonais, des artisans exceptionnels par exemple, sont mortels.
Quand il s’agit de paysages, leur congélation muséographique n’est pas pensable (même si elle est souhaitée) : ils entrent donc dans la catégorie des biens évolutifs,vivants. Si l’UNESCO souhaite les inscrire dans la catégorie du patrimoine mondial de l’Humanité comme paysages naturels et/ou culturels, cette institution internationale devrait consacrer sa transformation matérielle nécessaire et non son immobilisation impossible ou du moins très difficile.
En fait, comme l’indique le paysagiste Pierre-Marie Tricaud dans sa thèse de doctorat[2], l’UNESCO admet la mobilité du patrimoine : sous forme de préservation de la structure d’un paysage (un plan urbain, une trame foncière, un modelé de terrain), sous forme de la continuité spatiale et temporelle des activités (même différentes des anciennes, si elles sont comparables et authentiques !), de réemploi des vestiges (ruines industrielles et portuaires) ou de la réinterprétation de valeurs historiques singulières (des traditions orales, culinaires ou artistiques par exemple).
Il semble donc admis que la patrimonialisation des paysages évolutifs est plus aujourd’hui une conservation active, dynamique et inventive, qu’une mise sous cloche. Ce qui n’exclut pas une reprise de motifs anciens dans des paysages contemporains, par exemple dans le projet de restitution du parc historique de chasse du château de Versailles dans la plaine céréalière (site protégé) qui prolonge le Grand canal. Ce qui n’interdit pas non plus de réunir des motifs paysagers anciens et contemporains, ni de restaurer de manière fidèle à la mémoire connue des lieux (en 1700) les bosquets du parc de Versailles.
La notion contemporaine de patrimoine vivant semble dépasser, de manière très pragmatique, les oppositions traditionnelles : nature/culture, naturel/artificiel, historicité/contemporanéité, mémoire/oubli. Sans doute à l’image de la notion anglaise de conservation qui suppose à la fois protection de ce qui doit l’être (les caractères paysagers) et transformation de ce qui peut l’être (les usages, les fonctionnalités notamment).
C’est d’ailleurs une association dite patrimoniale qui, dans la plaine de Versailles, réunit, hors du site classé par l’UNESCO (1979) et l’Etat français (2000), les acteurs publics et privés de la production des paysages ruraux et urbains. Or ce dont il est question concerne les qualités du cadre de vie des habitants et des agriculteurs, c’est-à-dire un projet de construction de biens communs (des paysages, des lieux, des monuments, une histoire) à transmettre à des héritiers encore mal définis. Le patrimoine dans ce cas devient non une finalité publique, mais un outil au service d’identités sociétales localisées en projet.
[1] J.-P. Mohen, Les sciences du patrimoine, Paris, Odile Jacob, 1999, p. 15.
[2] Pierre-Marie Tricaud,%u2028 « Conservation et transformation du patrimoine vivant », %u2028publié dans Projets de paysage le 19/01/2011
URL : http://www.projetsdepaysage.fr/fr/conservation_et_transformation_du_patrimoine_vivant
28 mars 2011
De la biodiversité aux biodiversités, par P. Donadieu
2010 a été l’année internationale de la biodiversité pour l’ONU. Elle a été conclue par la Conférence de Nagoya sur la biodiversité[1]. Celle-ci a reconnu l’échec de l’objectif international qui était de stopper la régression de la biodiversité avant 2010, et a proposé de nouveaux objectifs (Protocole de Nagoya). Comment expliquer l’indifférence sociale apparente face à la menace de l’érosion qui ne semble concerner qu’une petite minorité ?
Dans les médias, il y a aujourd’hui au moins deux façons de parler de la biodiversité.
L’une, très minoritaire, s’appuie sur la Convention sur la diversité biologique qui s’est tenue le 5 juin 1992 à Rio-de-Janeiro, et où celle-ci a été définie dans l’article 2, comme : « la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes ».
Cette diversité biologique (ou biodiversité, terme vulgarisé après son utilisation pat l’entomologiste américain E.O. Wilson en 1986), relève de trois niveaux de variabilité : génétique, spécifique et écosystémique. Le consensus scientifique et utopique semble être de conserver le plus de gènes possibles, donc le plus d’espèces possibles et par voie de conséquences le plus de milieux et d’écosystèmes possibles. Car il n’est guère envisageable de savoir aujourd’hui quels gènes seront les plus utiles demain. De même il n’est guère réaliste de compter sur un inventaire complet : 1,75 millions d’espèces ont été décrites, cependant, les estimations du nombre véritable d’espèces vivantes vont de 3,6 à plus de 100 millions[2].
Selon les mêmes sources, la majorité des écologues et biologistes estiment qu’une extinction massive est en cours. S’il y a désaccord sur les chiffres et les délais, la plupart des scientifiques pensent que le taux actuel d’extinction est plus élevé qu’il n’a jamais été dans les temps passés. Plusieurs études montrent qu’environ une espèce sur huit parmi les plantes connues est menacée d’extinction. Chaque année, entre 17 000 et 100 000 espèces disparaissent de notre planète, et un cinquième de toutes les espèces vivantes pourrait disparaître en 2030.
Face à cette menace qui leur semble sérieuse, les plus scientifiques et les plus réalistes des écologistes pensent qu’il faut plutôt se concentrer sur la conservation des espèces « parapluies » qui, dans une chaîne alimentaire, témoignent de la bonne santé des populations dont elles dépendent au sein d’un écosystème. C’est le cas de la loutre, de certaines espèces de papillons ou de rapaces, de tigres ou de grands singes, parmi les espèces les plus emblématiques.
L’autre façon de parler de la biodiversité est largement majoritaire. En admettant que cette notion ne peut être seulement un concept scientifique univoque, elle élargit la notion de biodiversité à des biodiversités, à « tous les processus, les modes de vie ou les fonctions qui conduisent à maintenir un organisme à l’état de vie »[3].
Pour les biologistes de la conservation, la biodiversité pourrait désigner ce qu’ils veulent protéger grâce à une planification adaptative des paysages, qui conserve ou rétablit la connectivité des structures végétales et aquatiques sur la partie terrestre de la planète[4]. Mais sans doute faudrait-il définir des enjeux localisés (ce qui est désiré localement et par qui : une collectivité, une association, un Etat ?) et des enjeux planétaires (représentés par exemple par l’UICN, le WWF OU L’UNESCO).
Pour les paysagistes, la biodiversité a un sens différent selon la catégorie professionnelle. Emmanuel Mony, président de l’Union Nationale des Entrepreneurs Paysagistes déclare en 2010 « La biodiversité est indissociable du développement durable, démarche dans laquelle la profession des jardiniers-paysagistes s’est engagée de longue date ». De fait la profession a signé un accord-cadre sur la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires en septembre 2010 avec Chantal Jouanno, secrétaire d’État à l’Écologie. Elle réalise des guides techniques à destination de ses adhérents ; sur les techniques alternatives pour promouvoir les principales techniques de gestion écologique des espaces verts, l’aménagement des bassins pour économiser l’eau, les bonnes pratiques pour l’application des produits phytosanitaires, ou encore la gestion des déchets.[5] Dans ce cas la biodiversité est traduite en termes de mise en oeuvre de la politique publique de développement durable gouvernementale et de réduction des causes pouvant l’affecter, mais n’est pas mobilisé en soi. Les jardiniers paysagistes deviennent alors des acteurs d’une cause politiquement sensible mais floue à laquelle leurs dirigeants les font adhérer (pour l’intérêt du bien public). Ce qui peut être très favorable aux images commerciales de leurs entreprises. Sur le terrain, cette biodiversité nouvelle se traduit par un changement esthétique (par exemple la présence de végétations spontanées là où l’usager des parcs publics ou privés n’a pas l’habitude d’en voir).
Chez les concepteurs paysagistes, la variété des postures est très large. Les uns issus de formations biologique, écologique, agronomique, forestière ou horticole, sont parfois devenus, comme le jardinier paysagiste Gilles Clément, des militants de la protection de la biodiversité. Botanistes, entomologistes ou ornithologues, ils ont acquis par expérience ou formation la conviction de la disparition d’un capital vivant irremplaçable. Les espaces qu’ils aménagent (sans pesticides et en favorisant la faune et la flore sauvage) témoignent, notamment chez les paysagistes gestionnaires de parcs et jardins publics, de leur engagement et en sont souvent des manifestes publics.
Les autres, notamment en France et en Italie, qui n’ont pas eu ces formations naturalistes ou les ont oubliées, traduisent l’idée de biodiversité dans leurs langages et leurs compétences de concepteurs d’espaces publics. Réticents à l’idée de devenir, aux yeux de leurs commanditaires, des experts de la faune et de la flore sauvage, certains soulignent plus leur capacité à concevoir des espaces attractifs pour tous (diversité sociale) qu’à créer des milieux naturels aptes à attirer les insectes et les oiseaux (diversité écologique). La plupart des architectes paysagistes se disent pourtant prêts à concourir à la conservation active de la biodiversité, à condition de modifier la loi sur la maîtrise d’oeuvre publique. Car celle-ci calcule leur rémunération sur le coût des travaux et non sur les services écologiques que les espaces créés engendrent.
Devenue une valeur marchande, la biodiversité pourrait devenir un enjeu commercial pour les entreprises. Si toutefois la pression exercée par les pouvoirs publics sur les marchés défavorables à la biodiversité ne cesse pas. En France, en dépit d’un plan de réduction des pesticides (Ecophyto 2018), la publicité pour les pesticides destinés au grand public demeure autorisée, et la loi Grenelle 2 votée cet été a supprimé l’obligation de rendre compatible les documents d’urbanisme avec les schémas régionaux de continuité écologique (trames vertes et bleues)[6].
Ce qui importe aujourd’hui aux pouvoirs publics comme aux sociétés habitantes semble beaucoup moins la conservation de la biodiversité comme finalité universelle partageable (un objectif flou et lointain) que sa valorisation locale hypothétique, marchande ou non, souvent indirecte et invérifiable, par des intérêts privés ou publics.
J’oubliais ma voisine de palier qui a décidé de protéger toutes les espèces animales vivant dans son appartement, mais en ne conservant qu’un seul couple dans chaque population : de chats, de puces, de moustiques, de mouches, de souris, d’araignées, de cafards, etc……. Le syndrome de l’arche de Noë !
À chacun sa biodiversité !
[1] http://fr.wikipedia.org/wiki/Conférence_de_Nagoya_sur_la_biodiversité_(2010), consulté le 20/12/10
[2] http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1061, consulté le 19/12/10
[3] http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/developpement-durable-2, consulté le 19/12/10
[4] http://labiodiversite.free.fr/enjeux_theoriques_biodiversite/definition_biodiversite.php, texte de Linus Mattauch, Vers une définition de la biodiversité. Consulté le 19/20/10
[5] http://www.entreprisesdupaysage.org/component/content/article/196. Biodiversité : les entreprises du paysage en première ligne. Consulté le 19/20/10
[6] « On détricote le Grenelle », Que Choisir n° 486, Novembre 2010, p. 52 (article d’Elisabeth Chesnais).
21 mars 2011
La normalisation sécuritaire des espaces publics est-elle inévitable ? par P. Donadieu
En France, comme dans l’Union européenne, la logique des Etats est de d’imposer des normes au nom de la protection des biens et des personnes, mais aussi de l’intérêt politique des gouvernements. Toute transaction immobilière s’accompagne aujourd’hui de la présentation obligatoire et sécurisante des diagnostics d’experts concernant les performances énergétiques, la présence de plomb, d’amiante et de termites, l’équipement en gaz et électricité, les normes d’habitabilité, l’application de la loi Carrez, les risques naturels et technologiques, etc.
La sécurisation et la standardisation de l’espace public suivent la même voie, notamment dans le domaine environnemental. Les normes mondiales ISO (International Standard Organisation) – 18 500 en 2010 – de l’Organisation internationale de normalisation, contribuent ainsi largement aux objectifs internationaux du développement durable, mais aussi à la sûreté et à la sécurité publique. Depuis 1996, la norme ISO 14 001 traite « en premier chef du « management environnemental », c’est-à-dire de ce que réalise une organisation pour réduire au minimum les effets dommageables de ses activités sur l’environnement et pour améliorer en permanence sa performance environnementale (ce qui contribue à la protection et à la stabilité de l’environnement) »[1] ; la norme ISO 14 031 précise ainsi les démarches pour définir les indicateurs de performances environnementales concernant les rejets d’une entreprise dans l’air, l’eau, les sols, par exemple.
Peut-on chercher à donner les mêmes garanties aux usagers d’un parc public sur la non toxicité de l’espace qu’il fréquente? En l’absence de normes ISO, le plan Ecophyto 2018 est en France l’une des mesures proposées par les négociations du « Grenelle de l’environnement » fin 2007 et reprise par le second Plan national Santé-Environnement 2009-2013. Il fait suite à une Directive européenne du 21 octobre 2009 visant à parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et à une Directive cadre européenne faisant obligation aux pays de l’Union de retrouver le bon état des eaux d’ici 2015 (cours d’eau, plans d’eau, eaux souterraines, littorales et intermédiaires) ce qui concerne autant les zones agricoles que non agricoles. Rappelons le, la France est le troisième pays consommateur de pesticides (le premier de l%u2018Union européenne), par les agriculteurs essentiellement.
Le dernier colloque « Zéro-pesticides » organisé à Versailles en décembre 2010 par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale et l’Association des Ingénieurs Territoriaux de France a montré que l’essentiel (90%) des pesticides utilisés dans les services d’espaces verts des villes sont des herbicides. Ceux qui semblent les plus exposés (mais avec des risques probablement faibles) sont les jardiniers utilisateurs, quel que soit le niveau de protection adopté (une seule étude faite à Angers). Les usagers de l’espace public semblent encourir peu de risques surtout depuis la publication de l’arrêté ministériel du 12 septembre 2006 ne permettant la fréquentation d’un espace public traité qu’ « après un délai d’au moins 6 heures (8 h en milieu fermé et pouvant être porté à 24 heures) ».
Ces mesures réglementaires de sécurisation publique n’obéissent qu’à des logiques de politiques publiques. Elles ne sont crédibles que si elles atteignent leurs objectifs (le plan Écophyto vise la réduction de 50% des pesticides agricoles et horticoles utilisés en France en 2018).
S’ajoutent à ces politiques dans les parcs publics tous les dispositifs spatiaux qui visent soit la plus grande sécurité civile (clôtures et fermeture nocturnes, équipements dissuasifs, gardiens, absence de buissons gênant le contrôle visuel, droits d’entrée, jeux d’enfants normalisés, etc.), soit d’augmenter la fonctionnalité des espaces (absence de bancs publics). La plupart accroit la sélection des usagers, à l’exception des dispositifs de discrimination positive (l’accès des handicapés physiques notamment ou les jardins communautaires).
Fondées sur la normalisation (avec ou sans normes ISO), ces politiques publiques visent à créer, à restaurer ou à conserver les qualités génériques et fonctionnelles des espaces publics : la sécurité, la santé, la propreté, la civilité, le confort notamment. Quand elles atteignent leurs objectifs, elles ne traitent cependant qu’une partie de la qualité des espaces publics. Ils n’en sont pas en effet pour autant attractifs, sinon de manière relative, et même si cela peut souvent suffire à une partie des usagers.
L’attrait esthétique de l’espace public reste en principe un argument essentiel pour les concepteurs autant que pour les gestionnaires et les responsables politiques. Dans les deux premiers cas, les normes environnementales ne sont plus des outils conseillés, puisqu’il s’agit d’inventer les formes paysagères singulières qui s’accordent avec le site et son histoire autant qu’avec ses usagers et la commande publique. Les paysagistes deviennent alors des expérimentateurs et leurs projets manifestent trois types de postures possibles. Les avant-gardistes peuvent rechercher des solutions jugées subversives (en faisant valoir par exemple une esthétique de l’herbe spontanée sur les allées ou au pied des arbres des trottoirs, ou des prairies non ou peu fauchées) ; jusqu’au moment où cette « subversion » esthétique pionnière sera adoptée par les usagers et les jardiniers car éthiquement appropriable ; ce qui peut demander beaucoup de temps !
Les autres, progressistes, adoptent une pensée écogestionnaire dès l’acte de conception, par exemple en prévoyant une majorité d’espaces où le contrôle de l’herbe et de la végétation ne sera pas nécessaire ; mieux, où la dynamique de la végétation et de ses commensaux animaux (entre autres) devient le spectacle donné aux usagers. Cette posture d’écoconception qui intègre de nouvelles valeurs éco-esthétiques répond à de nouvelles commandes publiques des collectivités conscientes des qualités nouvelles à attendre des espaces publics. Le grand Lyon, Rennes, Nantes, Sarrebrück depuis 25 ans, n’utilisent presque plus de pesticides !
Les derniers ne changent rien à leur manière de faire parce que la commande publique, surtout dans les villes de moins de 50 000 habitants, restent le plus souvent indifférente à ces débats de société.
Ce qui veut dire que la normalisation environnementale, qui exprime une demande sociale légitime de sécurité et de santé publique, est évitable. Dans ce cas, elle ne peut être dissociée de postures écoconceptrice et écogestionnaire. En se réemparant des nouvelles valeurs politiques territoriales, ces paysagistes professionnels peuvent, et doivent, en trouver les traductions formelles et organisationelles singulières adaptées aux sites à aménager et aux usagers concernés.
[1] http://www.infraservices.fr/iso.php, consulté le 22 12 10.
14 mars 2011
Territoires tunisois de revendications, par Imène Zhioua
Le vendredi 14 Janvier 2011, avenue Habib Bourguiba, les Tunisiens ont pris leur avenir en main, (chronique du 17 01 11). Au terme de quatre semaines d’émeutes sanglantes qui ont secoué le pays du Sud vers le Nord, la colère s’est cristallisée sur « l’Avenue », comme l’appelle les Tunisois, donnant le coup de grâce au régime, après avoir scandé sans relâche à l’adresse du président déchu, le fameux « dégage ».
Depuis et après plusieurs décennies de léthargie, les évènements se succèdent sur la scène politique, à une allure vertigineuse. Les Tunisiens sont déterminés à prendre le chemin long et épineux de la démocratie. Ils demeurent cependant vigilants et n’hésitent pas à descendre dans la rue pour défendre leur révolution que personne ne doit leur voler.
Le premier gouvernement « de transition » nommé dans les jours qui ont suivi « La révolte du Jasmin » a été remplacé par un autre qui se voulait « de coalition nationale » au bout d’une semaine. Après que des milliers de citoyens, venus dans « une caravane de la liberté » de tout le pays, aient fait le siège de la place du gouvernement, aux portes de la médina. C’était la première prise de la Kasbah.
Un mois plus tard, nouvelle prise de la Kasbah : le gouvernement censé préparer les élections est jugé trop proche de l’ancien régime. Suspecté de complot, il ne sert pas, aux yeux d’une partie de la population, les objectifs de la révolution. Les manifestants scandent le « dégage » à l’adresse du Premier ministre.
Le 28 Février, le Premier ministre cède aux revendications des occupants de la Kasbah et démissionne. Ce qui provoque un vif émoi auprès d’une partie de la population qui s’est désignée comme étant « La majorité silencieuse » : elle refuse le chaos, appelle au travail et décide de s’exprimer en choisissant comme espace de revendications, la coupole, la Koubba du complexe sportif d’El Menzah.
Le 3 Mars, le président par intérim cède aux revendications de la rue, déclare la constitution caduque et annonce l’organisation d’élections, au mois de Juillet, d’une assemblée constituante. Cette assemblée se chargera de préparer une nouvelle constitution, ce qui réjouit à la fois les occupants de la Kasbah et les manifestants de la Koubba : le peuple va choisir librement ceux et celles qui vont écrire la nouvelle constitution, choisir le nouveau régime (parlementaire ou présidentiel) et organiser les élections. La Tunisie est, cette fois, assurément sur le chemin vers la démocratie. « La majorité silencieuse » a appelé les anciens occupants de la Kasbah à se joindre à eux pour fêter ensemble l’évènement.
Après l’éveil de l’espace public dans l’Avenue Habib Bourguiba (chronique du 24 01 11), on pourrait parler de nouveaux territoires de revendications ou d’expressions publiques.
Pendant une semaine, nous avons assisté à un véritable duel : Kasbah contre Koubba. Les premiers étant convaincus que le chemin de la démocratie passe par l’injonction du « dégage » et les autres qui, prônant la reprise du travail comme la seule voie possible, ont décidé que plus personne ne parlerait en leur nom.
Les deux groupes ont choisi des espaces que tout oppose.
Les partisans du « dégage » ont occupé un espace historique. En effet, la première Kasbah de Tunis remonte au Haut Moyen Age, même si sa forme actuelle ainsi que les principales constructions qui y ont été érigées datent du XIIe siècle (époque Hafside), quand Tunis devint la capitale d’un royaume indépendant qui étendait son influence jusqu’à Tlemcen. Le premier sultan y avait établi son lieu de résidence et le siège de son pouvoir, ainsi qu’une mosquée à côté de la caserne. Au fil du temps, la place fût consolidée, fortifiée jusqu’à se présenter comme une ville dans la ville, entourée de murailles[1]. Prendre la Kasbah revient à prendre Tunis. Les monuments entourant la place abritent aujourd’hui le Premier ministère et le ministère des Finances. Celle-ci est appelée officiellement la place du gouvernement.
Les partisans du travail ont choisi un espace représentant la Tunisie moderne ; la Koubba, la coupole qui sert de couverture à la salle de sport du complexe sportif d’El Menzah, construit en 1967 à l’occasion des Jeux méditerranéens. Le complexe comprend aussi un stade de football ainsi qu’une piscine olympique. Les trois édifices sont construits dans un vaste espace aménagé en espace vert comprenant un grand bassin, une pinède et un parcours de santé. Cet espace est prisé par les sportifs et sert aussi de lieu de récréation pour les habitants des quartiers limitrophes.

(La Koubba, le 5 mars 2011. Photo de Imène Zaâfrane Zhioua)

(La Kasbah, le 24 février 11. Photo de Hamideddine Bouali)

(La Kasbah, le 7 mars 11. Photo de Hamideddine Bouali)
La Kasbah est surtout un espace clos, entouré des trois côtés par des monuments historiques alors que la Koubba est un vaste espace ouvert. D’un côté granit et ficus soigneusement taillés, de l’autre pelouses et palmiers. D’un côté une fontaine mauresque en marbre et de l’autre un bassin en béton et des sculptures contemporaines.
Les premiers font un « sit in »: occupation continue de l’espace jusqu’à ce que leurs revendications soient écoutées ; les autres ont recours au « stand up » et se retrouvent tous les jours, après les horaires de travail de 17h à 19h, au pied de la Koubba. La rampe d’accès à la coupole est devenue leur lieu de rendez vous. Ils y affichent des slogans qu’ils renouvellent tous les jours en fonction de l’évolution de la situation politique. À la Kasbah, les arcades du ministère des Finances accueillent les manifestants dont les slogans sont directement inscrits sur les murs.
Les uns viennent de différentes villes du pays et les autres viennent pour la plupart des nouveaux quartiers résidentiels de Tunis, symbole de la classe aisée, mais tous veulent une Tunisie libre et démocratique. L’armée veille pour permettre à chacun de s’exprimer en toute sécurité.
Le 5 Mars, le peuple tunisien est en liesse, Koubba et Kasbah fêtent ensemble ce qui paraît être le bon chemin de la démocratie. Ils en profitent pour faire une collecte géante de dons pour soutenir les réfugiés qui affluent en masse aux frontières avec la Libye. Le « Dégage » a été remplacé par « Je m’engage » (… à construire ma Tunisie).
Entre temps, la révolution du jasmin s’est propagée dans une partie du monde arabe et fait trembler les vieux monarques accrochés au pouvoir depuis plusieurs décennies. À l’avenue Habib Bourguiba, a fait écho la si bien nommée « Place Ettahrir »[1] au Caire, « Place El Louloua »[2] à Manama, une autre « Place Ettahrir » à Sanaâ et qui sait encore ?
[1] Ettahrir : la libération.
[2] Louloua : la perle.
[1] Paul Sebag, Tunis, histoire d’une ville, Histoire et perspectives méditerranéennes, l’Harmattan, Paris, 1998.
7 mars 2011
S’indigner suffit-il pour résister ? par P. Donadieu
L’évolution des paysages du quotidien semble ne susciter qu’indifférence ou résignation chez la plupart des habitants de la planète. Comme si, ne pouvant plus leur attribuer la moindre signification ou en retirer la plus petite émotion, ils étaient anesthésiés, privés de toutes sensations. Ou bien, au contraire comme si, à leurs yeux, les verrouillages ou les impuissances politiques et économiques, du local au supranational, rendaient vaines les manifestations de mécontentement et de courroux.
Dans les deux cas, la passivité et le conformisme des habitants sont préoccupants. Car, bercés par la musique médiatique du consumerisme, ces derniers semblent accepter de subir les cadres de vie que les pouvoirs politiques et économiques (de la commune à l’Europe et au FMI) leur imposent, hors de toutes réflexions éthiques. Ne voulant ou n’attendant presque plus rien des gouvernements, hors de leurs sphères privées et individuelles que favorisent l’économie libérale mal régulée, les habitants ne réagissent plus ou mollement, même dans les régimes politiques les plus convaincus des vertus de la démocratie représentative.
Ce qui a trois conséquences désolantes : l’hégémonie du sens marchand des paysages produits aux dépens de leurs autres significations attendues, esthésiques et symboliques notamment, la réduction de l’individu et de la personne à un consommateur soucieux seulement de lui-même et de ses proches, et la disparition des biens communs (notamment environnementaux et paysagers) au profit des biens publics régis par la seule logique politicienne des pouvoirs publics régulateurs.
L’indignation individuelle, voire collective, offre t-elle la possibilité de résister à cette spirale auto destructrice de l’humanité (et non de la planète qui en a vu d’autres sans broncher) ? Que beaucoup d’optimistes, d’inconscients et de cyniques ne reconnaissent, ni n’admettent ! Peut-on résister avec des motifs comparables à ceux qui avaient suscité les mouvements de résistance apparus au début de la seconde guerre mondiale en Europe[1] ?
Parmi ces motifs contemporains de honte et de colère, au nom d’une conscience éthique à refonder par la résistance pacifique : les sans papiers, les sans domiciles et les paysans sans terres, les immigrés et les réfugiés maltraités, les groupes ethniques et religieux persécutés, les responsables d’entreprises sur-rémunérés aux dépens des salariés, la destruction et l’accaparement des ressources non renouvelables, etc..
Tous ces motifs de révolte sont associables à des scènes, des paysages et des lieux où les habitants éprouvent des sentiments de déreliction et d’impuissance : la misère et le chômage dans les bidonvilles de Sao Paulo et de Buenos-Aires, la laideur des périphéries urbaines, l’insécurité près des dépôt d’ordures sauvages et des usines polluantes, l’anxiété face à l’érosion des sols agricoles, à la déforestation et à la pollution chronique de l’air urbain, le désarroi des élus des villes sinistrées par la déprise industrielle, etc. La récente révolution du Jasmin en Tunisie en témoigne (chronique du 17 01 11)
Sans doute, les résistances sociales sont-elles déjà à l’œuvre et sous de multiples formes : les tagueurs urbains, les écrivains, les journalistes et les cinéastes témoignent, informent et « apportent l’éphémère » ; les habitants de nombreux bidonvilles comme celui de Dharavi à Mumbai (Bombay) survivent en entrant dans l’économie informelle : et grâce aux ONG, aux fondations privées, aux politiques publiques de « filets sociaux » et de reconquête urbaine, il est possible d’atténuer, de prévenir voire d’effacer des lieux de honte. Bref, il est admis de se reposer sur les mirages des politiques sectorielles, de l’humour, des images de l’art, et de la philanthropie pour ne pas céder à la tentation de la morosité ou du catastrophisme.[2]
Pour certains gouvernements, ces crises paysagères supposent des professionnels pour les « traiter » ? Pourquoi les paysagistes peinent-ils alors à apporter des solutions satisfaisantes à ces crises, contrairement à ce que semblent croire les maîtres d’ouvrage qui font appel à eux ? D’abord parce qu’à une crise sociétale des paysages, ils savent répondre surtout par des interventions ponctuelles : jardinières et/ou plasticiennes, spatialistes et territorialistes ; lesquelles visent, à la demande des commanditaires (des clients), d’abord l’attractivité et la singularisation des territoires, la création de l’espace public matériel, et non, sinon implicitement, le mieux-être humain. Car dans la plupart des cas, l’aménagement paysager urbain réussi se traduit par la gentrification des quartiers et la migration géographique de ceux qui ne peuvent plus accéder aux biens immobiliers et aux services paysagers qui les accompagnent. Bonnes intentions mais résultats sociaux discutables !
Ensuite, parce que les formations des concepteurs paysagistes, méfiantes à l’égard des sciences, souvent plus portées sur le design que sur les sciences de l’homme, de la société, de l’économie et de la nature, ne leur donnent que peu d’outils pour comprendre une crise sociétale planétaire et agir sur elle. Sauf militantisme individuel (rare) ; sauf à s’en inspirer pour produire des œuvres-manifestes ; sauf à admettre que le rôle des paysagistes est de devenir des spécialistes de la création des formes paysagères (du sensible disent-ils) à côté des autres experts (de la ville, des transports, de la biodiversité, etc.) ; ce que, dans la corporation paysagiste, certains revendiquent et d’autres, plus généralistes, déplorent.
Enfin, parce que le recours à la régulation paysagère publique (urbanistique et environnementale) n’est porteur d’espoirs locaux que s’il s’appuie sur une légitimation des décisions publiques par le débat public local. Dans ce cas, il est nécessaire de former, mieux qu’aujourd’hui, des professionnels du paysage aptes à la coproduction des territoires.
Si ces obstacles étaient levés, les paysagistes, formés à l’indignation pacifique et subversive, pourraient devenir des opérateurs d’une résistance obstinée à l’économisme ambiant (et non à l’économie marchande). Mais au nom de quels risques de privation de liberté devraient-ils s’indigner ? Peut-on comparer les menaces des totalitarismes à celles d’une hégémonie économiste ? En répondant positivement, on fonde la résistance aux conséquences de la marchandisation des paysages et des lieux sur l’indignation. Cela ne suffira pas pour vraiment résister, mais permet d’espérer traiter les causes et non les symptômes des crises paysagères.
[1] Stéphane Hessel, Indignez vous, Montpellier, Indigène éditions, 2010.
[2] Télérama n° 3179, Dossier Villes de rêves, villes de cauchemars, 2010.
28 février 2011
Théorie des origines de l’habitat idéal : les alternatives à la fétichisation du monde, par P. Donadieu
L’habitat idéal des terriens urbains aurait pour origine, selon Augustin Berque (chronique précédente) le goût ancestral des élites orientales et occidentales pour des mythes originels et des attributs imaginaires de la nature. Substantisés, ces mondes meilleurs et rêvés, dits paysagers, via la littérature, les arts et aujourd’hui les médias, auraient abouti à instaurer d’abord la nature dans la ville (le parc, le jardin), puis l’urbain diffus, manifestation incontrôlée du désir d’un habitat individualisé en quête de nature réelle ou jardinée, mais obstacle majeur à une réduction de l’empreinte écologique humaine.
Du point de vue de la géographie mésologique (qui étudie les milieux humains) d’A. Berque, l’imaginaire paysager des sociétés à paysages, instrumentalisé par les politiques urbaines (surtout en Occident) aurait masqué sa propension à ignorer le travail humain qui produit les paysages réels perçus comme belles natures. Si bien que, depuis les paysans et les serfs d’autrefois, en passant par les ouvriers de l’industrie jusqu’aux machines informatisées d’aujourd’hui qui se passent des hommes, le travail, invisible par les sociétés qui ont adopté les postures de leurs élites, continue à être mis à profit par l’économie capitaliste libérale.
Fondé sur l’individualisme, ce système découple le sujet humain de sa capacité à attribuer des valeurs à ce qui l’entoure, dissocie le corps physique des hommes de leur corps médial, c’est-à-dire du lien existentiel établi avec ce qui est perçu du monde. Ainsi le sujet perd sa capacité à donner un sens humain au monde qu’il habite, puisqu’il est replié sur des objets et des espaces fétichisés, et qu’il admet sans broncher des agglomérats d’architectures sans échelle, des sociétés de plus en plus inégalitaires, des habitats ségrégatifs et surveillés, des planifications territoriales vaines et des ressources environnementales qui se détériorent inéluctablement.
Pressentant l’origine paysagère de ces maux, les pouvoirs publics ont de plus en plus recours aux paysagistes. Héritiers de cultures jardinières, ces derniers proposent en général des réponses symptomatiques spatiales. Ils réinstallent la nature (jardinée, forestière ou agricole), ou lui donne accès, là ou elle est censée manquer ou est inaccessible. Or, le caractère ponctuel et technique de l’action paysagiste ne peut dissimuler un malaise plus sociétal que spatial. En effet, le paradigme paysager hérité de l’histoire des cultures occidentales et orientales interdit de percevoir les différentes formes de natures urbaines et extraurbaines en tant que produites par des hommes et/ou des machines. Si bien que la campagne agricole périurbaine par exemple recule inexorablement devant la ville alors que les citadins ont besoin de ses produits et de ses services de proximité. Son remplacement ponctuel par des parcs publics de proximité est une solution logique mais désuète, mais souvent hors échelle des mégalopoles.
Pour retrouver la lucidité nécessaire à la survie humaine sur la planète sans faire une confiance illimitée aux sciences de la nature, on aura compris que plusieurs conditions seront nécessaires. D’abord, percevoir les paysages et les lieux comme ils sont (se donnent à être ressentis) et non comme ils devraient être visibles selon des regards filtrés par des modèles culturels surannés ; les voir avec les acteurs et les machines qui les produisent et non selon une esthétique vieillotte qui rend ces derniers invisibles (surtout pour une majorité de touristes) ; selon les enjeux sociopolitiques qui les caractérisent et non selon des critères attractifs de bonne et belle apparence. En bref comprendre et admirer, et non rechercher seulement le confort ataraxique et le plaisir esthétique des spectacles.
Deuxièmement, ces nouvelles relations humaines au monde devront réarticuler le corps individuel physique et sensible avec le corps médial qui a prise éco-techno-symbolique sur les territoires humains ; sur l’écorce d’un arbre, le murmure d’un ruisseau, la couleur d’un vêtement, l’expression d’un visage ou le vacarme d’une route. Ce qui va bien au-delà d’une célébration de la subjectivité individuelle réduite à des affects, par exemple aux plaisirs pavloviens de posséder des objets séducteurs pour les rejeter ensuite. Ce qui outrepasse le fétichisme du goût inculqué par des experts incitant à la consommation authenticisée (des vins, des tableaux, des jardins ou de l’architecture entre autres) ; ou celui des spectacles de paysage (par le tourisme, les loisirs et la promotion immobilière). Bref réguler la consommation frénétique individuelle par les valeurs écouménales (poétiques, symboliques en particulier) des mondes de chacun …
Enfin renouer les liens humains avec les fondamentaux de l’écologie terrienne : ne pas consommer plus que les ressources de la planète ne peuvent produire en quantités et en qualités ; trier, recycler, économiser, se soustraire aux besoins artificiellement créés par la publicité, normaliser les consommations énergétiques (HQE), ne plus dépendre des produits pétroliers, réduire la mobilité des biens et des personnes, installer des agricultures et des boisements de proximité, et surtout ne pas se satisfaire du fétichisme vert ou bleu pour se donner bonne conscience environnementale. Au contraire, c’est à partir des ressources matérielles de la Terre qu’il conviendra de prendre conscience des limites de l’existence individuelle qui est aussi collective ; sans en faire un absolu indépassable, un dogme, sans se faire prendre au piège des seuls mots et des seuls signes de la médiasphère.
Augustin Berque a réuni toutes les bonnes raisons théoriques de croire que l’économie capitaliste libéral, aveuglée par des idéaux d’habitat désuets et les intérêts des individus et des entreprises, ne peut conduire qu’à une crise mondiale écologique, morale et esthétique grave dont les prémisses sont déjà perceptibles. Pour en sortir, il propose de refonder l’écoumène (le rapport éco-techno-symbolique entre la nature et notre monde) sur la base réaliste et clairvoyante de ce que « les gens aiment, croient et respectent » (être plutôt qu’avoir ?), et surtout pas en fonction des injonctions des seuls politiques et scientifiques. Tout un programme politique qui peut inviter à relire le Projet local de Alberto Magnaghi et de son groupe italien de territorialisti.
21 février 2011
Théorie des origines de l’habitat idéal : la fétichisation du monde, par P. Donadieu
Si l’on suit le géographe Augustin Berque[1], la notion culturaliste de paysage a pour origine la nature singulière de la relation humaine au monde, initiée par les élites lettrées des villes chinoises à partir du IVe siècle après J.C. Elle s’exprime dans la vision du monde non urbain (la campagne cultivée confondue avec la nature sauvage), tel qu’il se donne à voir (s’offre de lui-même et non est regardé, p. 86) sans conscience de ceux qui en sont les acteurs (les paysans, les pécheurs, les ouvriers, etc.), sinon en les naturalisant. En forcluant (en excluant et en ignorant) ceux qui produisent les formes de la campagne, les poètes et ceux qui leur ont emprunté ensuite cette posture distanciée, ont fabriqué cette relation qui a été dite paysagère (en chinois le paysage se dit fengjing à scène/vent-, shanshui àmontagne/eau ).
« Voir le paysage mais pas le travail qui l’a produit, et se penser donc seul devant la nature, j’appelle cela le principe de Xie Lingyung » (p. 78) ; du nom du premier poète chinois de paysage (385-433 après J.C.). Cette forclusion n’était possible que pour ceux qui étaient citadins lettrés et donc ignorant des pratiques agricoles. Ainsi ont été opposées la campagne comme nature déserte et désirable quoique cultivée (ye) et la ville (wen, cheng) comme lieu du pouvoir, séparée du monde rural par des zones concentriques (jiao : la première auréole périurbaine au delà des remparts). Cette proscription de l’ordinaire, du vulgaire a été aujourd’hui étendue à la ville inhabitable, insoutenable pour la vue comme pour la vie ; et par voie de conséquence a transmué les restes des cultures rurales en spectacles désirables pour ceux qui en ont le goût (shang).
Cette nature poétique idéale supposait une figure mythique originelle le Datong (ou Grand Même), période de paix parfaite d’avant les commencements (p. 30). Dans la culture grécoromaine, l’Arcadie virgilienne et pastorale du dieu Pan (paradis montagneux idyllique de l’Âge d’or) ou grecque (la sauvagerie primitive) comme topos homologue du Datong, a joué le même rôle.
Deux mondes (au sens phénoménologique) vont se constituer ainsi dialectiquement, d’un côté le monde érémitique (l’érème) (d’abord des ermites, des anachorètes, puis des esthètes, des artistes et des jardiniers paysagistes), de l’autre le monde écouménal (la relation humaine au monde habité qui suppose un sujet qui l’interprète, le juge au sens hégélien). Le premier, esthétisé voire artialisé, a été installé réellement et symboliquement dans le second (par l’enclos du jardin et du parc) et pour les symboles paysagers de nature qu’il apporte aux citadins cultivés (principe dit de la grotte de Pan par A. Berque, (p. 92). La jouissance esthétique contemplative (l’otium des citadins oisifs) a été ainsi opposée à la jouissance utilitaire (negotium des citadins actifs), l’un n’allant pas sans l’autre.
De ce point de vue écouménal (l’interprétation humaine du monde, sa désignation en tant que paysages désirables), le paysage ne peut être seulement matériel et objectif (le paysage qui existe alors sans le regard humain, est de fait réduit aux sciences de l’environnement), ni seulement subjectif (le paysage existerait partout dès qu’il y a un regard humain pour le créer), mais trajectif ( c’est-à-dire à la fois objectif et subjectif, le second nourrissant le premier du sens apporté : éco-techno-symbolique) p. 94.
Chaque culture a ainsi produit des élites qui ont dit (prescrit) ce qui devait être regardé comme la nature utile et secourable, puis admirable (le paysage) : les chamans et les prêtres (avant l’idée de paysage, l’immortalité humaine et la domestication de la nature sauvage étaient visées), puis les artistes, les écrivains, les poètes, les photographes, les paysagistes jardiniers , imités à leur tour par le plus grand nombre (de consommateurs).
Privé par le Platonisme, puis par la Chrétienté pendant un millénaire de la « jouissance de notre attachement au monde sensible » (p. 101), l’Occident européen n’a inventé le paysage (pictural et littéraire, notamment des villes dans des paysages ruraux) que tardivement à partir du XIVe siècle en Flandres, en le laïcisant.
« Voir (le monde) comme » (mitate en japonais) le tableau, l’estampe ou le poème aurait pu rester un jeu élitaire de société, mais a été étendu, de manière massive, au monde moderne au point de le transformer matériellement. Par exemple au Japon en installant précocement le jardin de thé (chaniwa, roji) dans la ville japonaise, comme métaphore élitaire de l’érème et plus tard comme modèle anachorétique (du monde profane à la Terre Pure) de l’habiter (p. 177).
Le lieu de la « maison délicieuse » semble avoir été, dès les villas suburbaines romaines, celui où on ne travaille pas (otium), ou du moins où le travail des autres (les paysans, les esclaves, les jardiniers, les ouvriers) est ignoré ; où prévalent les valeurs antiurbaines reconnues comme désirables (des maisons moins coûteuses, des mémoires collectives vivaces, la liberté d’accès -grâce à la voiture-, l’authenticité, la solidarité, le repos, la santé àl’air pur-, la beauté des paysages, etc.) ; et où, surtout en Amérique du nord, la nature (sauvage ou domestique) est idolâtrée et la ville dense abolie dans l’urbain diffus et écologiquement insoutenable (p. 234).
Cette théorie du paysage, issue de nombreux travaux précédents, dit comment les représentations d’un monde rêvé (la nature-campagne) se substituent à la présence du monde réel (la ville) pour transformer ce dernier en urbain diffus et en natures sauvages ou agricoles convoitées. De la perte des imaginaires et des jugements humains sur le monde, et de la « cyborgisation » de ses habitants réduits à des individus et à des substances mécanisées (forclusion du corps et du travail médial[2]), A. Berque déduit sa décosmisation, sa désurbanité, la perte du sens collectif de ses formes, pour le plus grand profit des intérêts privés de l’économie capitaliste libérale depuis le XVIIIe siècle.
Devenus des fétiches auto-reproduits élevant le niveau de la vie, mais accroissant les inégalités sociales, les objets et les systèmes urbains contemporains (entreprises, autoroutes, maisons, internet, etc.) trouvent leurs limites dans celles des ressources naturelles et de l’individu fétichisé (sans monde commun avec les autres individus, autre que celui de la consommation). Le paysage devient alors un outil de la mise en spectacle marchand du monde, du marketing territorial, alors qu’il est récusé par la négation du corps médial. Aussi A. Berque réhabilite-t-il la composition, la compaction et la densification urbaines, l’architecture conçue avec et pour la ville et la Terre, en prenant en compte la diminution des empreintes écologiques. Car la quête de nature en tant que paysages désirables tue la nature en tant que ressources épuisables.
[1] Berque Augustin, Histoire de l’habitat idéal, De l’Orient vers l’Occident, Le Félin, 2010.
[2] Corps médial : « lien existentiel que nous avons avec les choses », (p. 317)
14 février 2011
Vous avez dit sensible ? par P. Donadieu
Nous avons vu dans la chronique précédente que la recherche des significations sensibles d’un paysage par le projet de paysage est un trait identitaire, une compétence singulière revendiquée par les paysagistes concepteurs. Ainsi, ils se distingueraient des architectes comme des ingénieurs et des designers d’objets. Peut-on expliciter ce savoir-faire ?
Si le paysage est une relation établie entre celui qui perçoit un espace et la matérialité perçue par les sens, le paysagiste concepteur doit être en mesure d’établir ces relations : de les créer quand elle n’existe pas, de les infléchir dans le cas inverse. Il y parvient en modifiant les formes et les organisations d’espaces perçus et pratiqués et en montrant ce qui lui paraît digne d’intérêt. Il y parvient également en contribuant à modifier le regard de ses semblables sur le monde.
Cette scénographie est en pratique un filtre perceptif qui met l’usager en situation de spectateur (le promeneur par exemple), parfois d’acteur dans un milieu qui est fait pour être vu, arpenté et apprécié pour ses qualités fonctionnelles, esthésiques et esthétiques immédiatement sensibles. Dans ces conditions les espaces abandonnés (la friche, le terrain vague par exemple) ou fonctionnalisés (le parking, la route, l’entrepôt, le champ) perdent leurs attributs anciens au profit de caractères nouveaux qui font sens singulier (le parvis de la cathédrale à la place de son parking, le pocket garden à la place du terrain vague urbain).
Ainsi tamisés par les regards des paysagistes, les espaces perçus sont fabriqués ou reconnus pour « faire paysage » ; pour susciter des affects en s’appuyant sur la perception des caractères matériels par un usager mobile qui ressentira le site dans son propre corps : haut/bas, proche/lointain, fermé/ouvert, lumineux/sombre, bruyant/silencieux, animé/mort, minéral/végétal, etc., en les associant à des affects : froid/chaud, apaisant/inquiétant, composé/chaotique, sacré/profane, provoquant/rassurant, simple/compliqué, bon/mauvais, plaisant/déplaisant, etc.
L’affect n’est pas le concept qui permet de comprendre, d’expliquer et d’interpréter. L’affect est immédiat, non réfléchi et intériorisé ; il peut déboucher sur un savoir empirique, voire expérimental. Par expérience, je sais que tel lieu est froid et triste. Mais ce savoir subjectif ne devient savoir savant que s’il est objectivé, rationalisé, universalisé et partagé : dans telles conditions, ce type de lieu suscite la peur chez telles catégories d’usager.
De fait il existe deux façon de connaître un paysage ou un lieu :
– la connaissance sensible, affective, individualisée, peu partageable et communicable, qui débouche sur le jugement de goût, et ne nécessite pas l’idée de vérité (l’opinion commune et celle des experts suffisent)
– la connaissance rationnelle, conceptuelle, partageable via des concepts de toutes natures (scientifiques, littéraires, philosophiques, éthiques, etc.), qui propose des vérités argumentées, mais fragiles.
Est ce dire que la connaissance sensible est irrationnelle ? Oui, parce qu’il est impossible de raisonner un affect. Je ne me demande pas si je dois raisonnablement avoir peur ou si ce paysage est beau : je l’éprouve, j’ai peur ou c’est beau. Ce qui n’élimine pas les logiques du sensible : dans telles conditions, il est logique, démontrable, déductible, prévisible, normal que je sois effrayé, ou que la beauté soit liée à des caractères objectifs.
A moins que cette connaissance sensible relève seulement de l’opinion publique. Dans ce cas elle bascule dans le champ politique ou elle se débat avec les pouvoirs politiques. Lesquels alors ne peuvent se passer des experts pour prendre des décisions.
Est-ce dire que le paysagiste est irrationnel ? Non, car les raisons du sensible sont en partie objectivables. Conçu pour cet effet, un lieu fermé et obscur peut être effrayant. Il fera frissonner les uns (les enfants) mais pas les autres (les adultes). Les interventions paysagères sont faites pour « affecter » les usagers de l’espace, et de ce fait pour les informer de manière immédiate (sans passer par la signalétique et l’explication savante). Ce qui réduit considérablement la portée du message, mis à la mesure du corps qui l’éprouve.
Cette connaissance paysagiste est une proto connaissance nécessaire, car les filtres cognitifs des sciences sont trop nombreux pour être tous mobilisés. Le filtrage paysagiste privilégie les logiques des ressentis corporels sur la spéculation savante que procurent les lectures explicatives de paysage. Il donne à percevoir, immédiatement, ce qui n’était pas ou plus perçu localement, pour le bénéfice d’une majorité d’usagers de l’espace.
Révélant le substrat paysager, le paysagiste doit en filtrer les perceptions, ou du moins les organiser, sinon les messages risquent d’être brouillés du fait de leur trop grand nombre ou de leur répartition géographique chaotique.
C’est pourquoi, les caractères sensibles (visibles, audibles, olfactifs) qui ne sont pas faits ou retenus pour être perçus, sont souvent éliminés ou marginalisés. Ainsi les campagnes périurbaines deviennent-elles plus résidentielles qu’agricoles parce que les regards paysagistes ne « voient » pas l’espace agricole, il est vrai peu attractif pour une majorité, sous sa forme céréalière par exemple.
Cependant, s’il choisit de révéler le substrat paysager à travers les regards locaux, le paysagiste adopte alors une posture de médiateur des valeurs de ceux qui vivent et de ceux qui produisent les paysages.
Spécialistes des relations sensibles des hommes au monde matériel, les paysagistes concepteurs détiennent une véritable singularité, une authentique utilité sociale et culturelle, que la connaissance scientifique peut éclairer, mais pas remettre en cause.
7 février 2011
Le paysagiste concepteur est-il un spécialiste du « sensible » ? par P. Donadieu
En France, les paysagistes diplômés de cinq écoles publiques et privées (Angers, Blois, Bordeaux, Lille, Paris, Versailles) revendiquent l’art et la technique de la construction des paysages matériels. Mais leurs positions professionnelles sont plurielles.
Peu se disent seulement scientifiques, notamment les ingénieurs paysagistes. Et la majorité ne tranchent pas entre la posture du concepteur et celle de l’ingénieur. Tous cependant se reconnaissent dans l’identité de généraliste, la culture du projet et la maîtrise du « sensible ». Qu’entendent-ils par « sensible » ?
Le métier de paysagiste concepteur (d’architecte paysagiste selon la désignation internationale) a été fondé depuis le XIXe siècle sur une double opposition ; d’abord, en tant que dessinateur de jardins lié aux techniques horticoles et à la peinture de paysage, à la profession d’architecte ; puis, en tant que dessinateur de jardins et de paysages, à celle d’ingénieur (du génie civil, agronome, horticole, géomètre, écologue, forestier, etc.).
Dans les deux cas, ils ont revendiqué des sensibilités artistiques et les capacités d’émouvoir les publics, compétences que l’ingénieur, devenu scientifique et technologue, et qui n’était plus l’ingénieur artiste du siècle des Lumières, ne pouvait plus acquérir dans sa formation.
Si bien qu’aujourd’hui les concepteurs paysagistes français se présentent sur le marché comme des designers : des concepteurs/dessinateurs de paysages, de jardins et d’espaces publics en général (urban designer) ; ceci à des échelles géographiques variant de celles du trottoir à la région administrative, et à des échelles de temps saisonnières à séculaires.
Grâce à ces ambitions exorbitantes, les pouvoirs publics les ont reconnus comme des opérateurs experts, capables d’accompagner la création ou la restauration de fonctionnalités spatiales très diverses, notamment pour les rendre attractives à des fins d’usages publics. Et l’Etat français a confirmé cette expertise de conseillers de la maîtrise d’ouvrage publique et de maître d’œuvre avec les Grands prix du paysage et les missions départementales de paysagistes conseils de l’Etat.
Tiennent-ils leurs promesses en tant qu’experts du « sensible » ?
Les finalités d’un projet « sensible » seraient de susciter, par la seule voie des perceptions immédiates, des sensations (polysensorielles), des impressions, des émotions et des sentiments ; affects qui peuvent fonder le jugement de goût, l’appréciation morale (c’est bien/mal ou bon/mauvais pour moi ou pour nous) et esthétique (c’est beau ou laid pour moi ou pour nous). Le projet paysagiste devenu réalité matérielle devrait donner ou révéler par la seule perception des formes et des ambiances le sens d’un site à ses usagers. Quel que soit ce sens : économique, de loisirs, symbolique, écologique, social, politique, religieux, etc. Et il serait jugé, par les gestionnaires et les usagers, selon cette capacité à donner des formes, connues ou nouvelles, à des fonctionnalités spatiales. En ce sens, le paysagiste concepteur est un designer, non en général d’objets, mais des organisations et des formes d’espaces destinés à des usages publics.
Quand les paysagistes concepteurs sont maître d’œuvres d’aménagements dits paysagers, qui esthétisent et scénographient des sites, ils tiennent en général leurs promesses, car les écoles professionnelles leur ont donné ces compétences héritées de l’art des parcs et des jardins. Ces savoir-faire ne sont pas revendiqués comme scientifiques et font appel à des techniques d’ingénierie comme dans le cas de l’architecture.
En revanche, quand leurs prescriptions de conseillers de la maîtrise d’ouvrage sont filtrées par les élus et leurs techniciens, elles sont souvent réinterprétées, déformées et parfois oubliées. Car elles sont peu expliquées, peu justifiées et mal débattues auprès des acteurs des collectivités et des territoires, qui n’ont pas la même culture esthétique. Le jugement esthétique ne se justifie pas.
En outre, il existe des domaines comme l’agriculture, la forêt et les milieux naturels, où les filtres paysagistes habituels sont rarement adaptés aux logiques économiques et écologiques de la production de l’espace. Il est probable que l’enjeu aujourd’hui n’est pas de passer aux tamis esthétiques les scènes rurales, forestières ou naturelles, comme à l’époque révolue où le pittoresque paysager régnait en maître, mais de les montrer pour ce qu’elles sont, en tant que produits sociétaux.
L’échelle locale des oeuvres paysagistes devrait être également celle de l’attention donnée aux valeurs incantatoires du développement durable. C’est rarement le cas, malgré des avancées exemplaires récentes. C’est pourquoi les compétences des paysagistes devraient s’appuyer non seulement sur la botanique et les arts visuels, mais également sur les sciences écologiques, juridiques, économiques et sociales.
C’est d’ailleurs ce que demande le Conseil de l’Europe aux architectes paysagistes afin de promouvoir la Convention européenne du paysage de Florence de 2000.
31 janvier 2011
Architecture des jardins et architecture du paysage : la fin d’une confusion ? par P. Donadieu
Le métier d’architecte de jardin (garden architect) est aussi vieux que celui d’architecte. Dans la langue française, ce dernier terme est apparu en Europe au XVIe siècle et désigne un constructeur et un dessinateur capable de concevoir un édifice, d’en tracer le plan et d’en diriger l’exécution. Au siècle précédent, le Génois Léon-Battista Alberti (1404-1472) avait écrit un traité d’architecture et d’art urbain De re aedificatoria (1485) lequel, dans le livre IX, avait abordé les façons d’organiser les jardins des maisons de plaisance. Pour Alberti, l’architecte était également le dessinateur des jardins qui pouvaient accompagner l’édifice qu’il avait construit.
Le métier de jardinier (le topiaria des villas romaines et campaniennes) est encore plus vieux que celui d’architecte de jardin. Ce dernier ne pouvait se passer des compétences du jardinier qui réalisait, cultivait et entretenait le jardin avec l’aide d’ouvriers. À partir de la fin du XVIIe siècle, le maître jardinier dessinateur de jardins (comme André Le Notre à Versailles) pût conquérir les savoir-faire de l’architecte de jardin, un homme de l’art qui était d’abord un architecte.
C’est au siècle des Lumières que les compétences de l’architecte et du maître jardinier se séparèrent avec la création en Angleterre du jardin pittoresque, inspiré de la peinture de paysage due au peintre paysagiste. Tous, au siècle suivant, revendiquèrent alors le qualificatif de paysagiste : les jardinistes paysagistes comme Joseph Paxton en Angleterre et Edouard André en France, et les architectes paysagistes (Frédérick Law Olmsted aux Etats-Unis en particulier)[1]. En dépit d’un retour des architectes de jardins entre les deux guerres, c’est le terme architecte paysagiste qui l’emporta avec la création de l’International Fédération of Landscape Architects en 1948.
Depuis cette époque, l’architecte paysagiste (un titre professionnel donné -sauf en France- par les organisations professionnelles de chaque pays, comme le Landscape Institut de Londres) cumule en principe les compétences du jardinier paysagiste, de l’architecte de jardin, du concepteur (designer) paysagiste et du planificateur paysagiste. Celles de l’entrepreneur paysagiste sont aujourd’hui clairement distinctes des architectes paysagistes au sein d’organisations professionnelles séparées.
Cette confusion des compétences, très justifiable du point de vue de la profession d’architecte paysagiste (les paysagistes DPLG et les ingénieurs paysagistes en France) commence à être critiquée en Europe.
L’architecte paysagiste allemand Martin Prominsky, par exemple, remet en cause, dans un projet d’article à paraître dans le Journal of Landscape architecture (2011) la vision unitaire de l’architecture du paysage. Il dénonce ce qu’il appelle « l’épuration esthétique du paysage » par les architectes paysagistes, qui empêche au nom de valeurs esthétiques désuètes de l’époque moderne (le sublime, le pittoresque), de voir le monde àagricole notamment- tel qu’il est. Il critique la substitution du récit et des formes paysagistes à la réalité physique et humaine. Pour lui la conséquence est de dissimuler les dangers environnementaux et sociaux réels que courent les habitants de la planète en les enfermant dans une attitude spectatoriale distante, apaisée et ignorante.
Toutefois, il distingue clairement la posture esthétique et esthésique des architectes de jardins : « . Maybe garden- and park architecture may do so in order to maintain a certain amount of cultural representation, but not landscape architecture, de celle des architectes paysagistes qui doivent renoncer à cette mission désormais anachronique et irresponsable.
Que deviendraient alors les architectes paysagistes, qui ne se consacreraient pas aux parcs, aux jardins et aux autres aménagements paysagistes ? Pour Martin Prominsky, il s’agit de réactiver une éthique de la survie qui rend nécessaire l’action ; de se situer à l’échelle de la planète autant qu’à celle des lieux aménagés ; de transiger avec le stylisme d’une belle nature nostalgique ou avant gardiste demandée par des clients aux goûts trop conditionnés par des modèles canoniques ; et in fine de se détourner de finalités trop exclusivement culturalistes.
Pour tracer cette nouvelle voie, il propose les landscape machines, dispositifs d’intervention paysagistes pluridisciplinaires destinés à trouver des solutions situées à des problèmes locaux autant que globaux, par exemple, un système de traitement des boues de dragage des fleuves aux Pays-Bas. Il convient cependant que cette voie patiente de rééducation des relations perceptives au monde n’est pas facile, car écrit-il à juste titre : « We cannot unlearn so easily the way we have learned to learn ».
On consultera également l’article de Catherine Chomarat-Ruiz consacré à la distinction entre les notions de jardin et de paysage[2].
[1] J.-P. Le Dantec, Jardins et paysages, textes critiques de l’Antiquité à nos jours, Larousse, Paris, 1996.
[2] Catherine Chomarat-Ruiz,%u2028 « Quand les jardins résistent à l’art… »%u2028publié dans Projets de paysage le 20/01/2011
24 janvier 2011
« L’éveil » de l’espace public : la dimension cachée de la révolution tunisienne, par Roland Vidal et Moez Bouraoui
Chacun a vu et revu les images de ce peuple tunisien se libérant d’un système politique qui les étouffait depuis de trop nombreuses années. Pierre Donadieu et Imène Zhioua en ont rendu compte dans une chronique émouvante, rédigée « à chaud » et publiée lundi dernier sur Topia (chronique du 17 janvier 2011). Une page Wikipédia y a été consacrée dès le 17 décembre, elle est depuis tenue à jour heure par heure, comme de nombreux autres sites internet qui relatent les évènements en détail. On parle de cyber-révolution, de « révolution facebook », dans laquelle le téléphone portable a aussi joué un rôle déterminant. Ce qui est certain, c’est que cette révolution, comme toutes celles qui l’ont précédée, se déroule dans l’espace public. Et celui-ci, aujourd’hui, se déploie largement dans les technologies de l’information et de la communication.
Mais c’est bien d’espace public qu’il s’agit, qu’il soit cybernétique ou non. Car on a vu aussi comment les habitants se sont organisés pour prendre le contrôle de leur rue, de leur quartier, de leur cité, pour improviser avec une efficacité étonnante un maintien de l’ordre laissé vacant par une police totalement décrédibilisée. Ce peuple, dont on voulait nous faire croire qu’il n’était « pas mûr pour la démocratie », a montré qu’il savait prendre son destin en main. Et les images les plus émouvantes que nous ayons vues sont peut-être celles où les habitants, après avoir établi les barrages routiers protégeant leurs quartiers, ont nettoyé leurs rues, organisé eux-mêmes le ramassage des poubelles, parfois au péril de leur vie lorsqu’ils étaient encore exposés aux balles des tireurs fous d’une milice finissante.
Les Tunisiens se sont enfin approprié leur territoire.

Barrage routier en construction dans une rue de Tunis, le 15 janvier (photo Saloua Toumi)
Longtemps accaparées par des intérêts privés, la gestion de ce territoire et les politiques d’aménagement qui lui sont associées échappaient, de fait, aux vrais pouvoirs publics. Les territoires urbains et périurbains du cordon littoral sont ainsi devenus le théâtre d’un empire financier multipliant les grands projets commerciaux, industriels, manufacturiers ou immobiliers, tandis que l’arrière-pays et les quartiers périphériques du Grand-Tunis restaient paupérisés et sous-équipés. Mais voilà que la révolution tunisienne, portée par les habitants de Sidi-Bouzid, de Kasserine et de bien d’autres villes de cet arrière-pays oublié, est venue ruiner les ambitions cachées de ces grands projets.
Soutenue par les compatriotes de la capitale, la révolution du peuple tunisien a eu sa véritable expression au sein de l’espace public le plus connu de la Tunisie, l’avenue Habib Bourguiba. À travers son occupation qui a permis l’aboutissement de la révolution, l’espace public de la Tunisie est enfin devenu l’espace public des Tunisiens.
Face à cette situation, les chercheurs en paysage que nous sommes ont bien des questions à se poser aujourd’hui. Car l’espace public est, par excellence, notre terrain d’étude. Et pendant les nombreuses années où nous avons conduit des recherches ensemble, nous savions à quel point il n’y a pas d’espace public sans expression publique. L’espace public, nous rappelle le philosophe Thierry Paquot, c’est d’abord l’espace de la circulation des idées. Et tant que celles-ci étaient bridées, enfermées dans les rares endroits où l’on pouvait se sentir à l’abri des oreilles espionnes du pouvoir, elles ne circulaient pas.
Comment comprendre en quoi un projet de paysage pourrait répondre aux aspirations de la population, lorsqu’il est impossible de s’interroger librement sur les sentiments de celle-ci ? Combien de fois avons-nous dû freiner nos étudiants dans leurs aspirations à aborder, comme on le fait ailleurs, la dimension sociale de leurs travaux de recherche, simplement pour ne pas les engager dans des impasses dangereuses ? Quelle frustration de devoir les mettre constamment en garde contre un risque réel de voir, dans le meilleur des cas, leur travail mis au placard, dans le pire, de subir censure, brutalités policières, voire privation de liberté !
Mais quel enthousiasme de savoir que maintenant ils vont pouvoir observer et interroger librement les populations sur ces lieux de vie qui les intéressent : l’espace public.
Quel enthousiasme aussi, lorsqu’on comprend à quel point le travail qu’ils ont accompli si difficilement ces dernières années, dans les jardins publics, dans les zones touristiques, dans les territoires de l’agriculture urbaine, etc., est loin d’être perdu, bien au contraire. Ils sont détenteurs maintenant d’un matériau de recherche unique, et impossible à reproduire : plus personne ne pourra pratiquer les enquêtes menées du temps de la dictature.
Il leur reste à mettre en valeur ce véritable « patrimoine » de la recherche en le confrontant à la situation actuelle. Il leur reste aussi à observer le mouvement qui se déroule sous leurs yeux et à faire en sorte que leur travail accompagne les aspirations profondes du peuple tunisien, longtemps méconnues par la communauté des chercheurs comme par celle des professionnels du paysage et de l’aménagement du territoire. Bien que la population tunisienne n’ait pas l’habitude d’exprimer publiquement son opinion, la principale raison justifiant cette méconnaissance a toujours été, en effet, foncièrement politique : interroger le Tunisien sur son rapport à l’espace public ou sur ses aspirations à une meilleure qualité de son cadre de vie était, jusqu’à l’orée du 14 janvier, réprimé par la force milicienne d’un parti unique et policier.
Il nous reste donc à nous, enseignants-chercheurs, à aider les étudiants dans cette entreprise. Car la manière dont nous avons traité la question de l’espace public tunisien, ces vingt dernières années, doit être revue en profondeur. Privés du droit d’aborder la dimension politique des sujets que nous traitions, nous avions réservé toute la place à la dimension culturelle, celle qui pouvait se glisser dans les interstices de la censure. Aidé par le travail important des chercheurs en sciences sociales, nous avons tenté d’expliquer les spécificités tunisiennes en nous référant essentiellement aux caractéristiques propres de la culture arabo-musulmane, cette « épaisseur du seuil » dont parlait Françoise Navez-Bouchanine à propos de la limite entre espace public et espace privé. Or, pour essentielles que soient ces spécificités, elles n’expliquent pas tout. L’espace public est d’abord un espace politique.
Politiquement libres, les Tunisiens vont regarder autrement leurs rues, leurs boulevards, leurs jardins publics. On découvrira sans doute que le peu d’intérêt qu’ils portaient à ces espaces était dû en grande partie au fait qu’ils ne les considéraient pas comme les leurs, mais comme ceux de la surveillance policière.
Roland Vidal et Moez Bouraoui, enseignants-chercheurs Versailles/Tunis
17 janvier 2011
La révolution du Jasmin, par Pierre Donadieu et Imene Zhioua
Le 14 janvier 2011, sous le regard du photographe Hamideddine Bouali, le peuple tunisien vient de prendre en main son destin politique. Avec dix-sept images légendées, l’artiste rend compte, mieux, beaucoup mieux que des articles de reportages, de ce qui s’est passé ce jour là dans l’avenue Bourguiba de Tunis[1].
L’avenue Habib Bourguiba, la lointaine promenade de la Marine, l’ancienne avenue Jules Ferry à l’époque de la colonisation française, est restée le coeur public de Tunis et de la Tunisie. Sous l’ombrage de ses célèbres alignements de Ficus se concentrait, avant le curieux rajeunissement de 2001 qui a donné plus de place aux terrasses des cafés, aux lampadaires et aux voitures, l’âme de Tunis. Tous les Tunisois se souviennent des kiosques de vente de journaux, des étals de fleuristes, des vendeurs de bouquets de jasmins, du flux incessant des passants, des regards lointains des chibanis sur les bancs fatigués et des piaillements bruyants des étourneaux. C’est dans ce lieu historique, et riche de mémoires, que confluèrent hier les habitants de Tunis. Les barrages, les bombes lacrymogènes, les matraques et les fusils des policiers les y attendaient.
Des cris de révolte, une indignation populaire ce jour-là, dès l’après-midi : « Partez Ben Ali, Ben Ali dehors, Ben Ali dégage, Ben Ali assassin », ou encore « Un jugement populaire pour le gang des Trabelsi”, des scènes impensables, inimaginables il y a un mois sur cette avenue où, très tard le soir, les terrasses restaient animées par des groupes de citadins paisibles consommant des cafés au lait.
“Ne vivra pas en Tunisie celui qui la trahira, ne vivra pas en Tunisie celui qui n’est pas de ses soldats”, ce couplet de l’hymne national fut scandé à l’infini aux heures les plus chaudes de la journée.
Sur cette avenue, tous les Tunisois connaissent le ministère de l’Intérieur, Bastille et bunker inexpugnable, symbole de la répression et du contrôle policier, devenu l’objet de la vindicte populaire. « Wazara dakhilia, wazara irhabia”: “Ministère de l’intérieur, ministère de la terreur” scandent les manifestants. Devant les rangées sombres de policiers casqués, un homme brandit une pancarte de fortune dont on devine le message de colère. Il « manifeste à bout portant » comme l’indique la légende de la photo. Face au ministère, une jeune fille s’est perchée avec une pancarte sur un lampadaire très « Troisième république française ». Elle dispose d’une vue imprenable sur la foule qui se presse sous les arbres aux frondaisons soigneusement surveillées par les jardiniers de la ville.
À tout moment, les brigades peuvent charger et matraquer violemment, sans retenue, blesser et tuer. Pourtant, les manifestants arrivent sans cesse sur l’avenue, forçant les barrages de police. Ils sont également agglutinés sur les toits et les balcons. La marée humaine crie son désir de dignité, de libération de la dictature qui l’oppresse depuis de trop longues années. Elle crée son espace public d’expression propre en lieu et place de celui du contrôle policier et de la consommation marchande[2].
Un homme coiffé d’un chapeau sombre s’est enveloppé dignement dans un drapeau rouge national. Autre symbole de la nation tunisienne, il est là pacifique, paisible, sans arme.
Surtout des hommes – et également des femmes et des familles – jeunes et moins jeunes, tels sont les manifestants. Beaucoup ont un téléphone portable à l’oreille. Un nouvel espace public apparaît : celui des réseaux sociaux sur Internet qui relaient à travers le monde la révolution du Jasmin, en contournant les censures. Les mains levées se mêlent aux appareils photographiques et aux pancartes. « À mains nues », les seules armes dont ils disposent, les Tunisois combattent pour reconquérir la liberté de parole perdue.
À côté de son char, armé d’une mitraillette, un militaire en treillis dévisage une petite fille avec une casquette rouge. Des barbelés sur le sol les séparent. « L’armée veille sur le peuple ». Sur une autre image, le cercueil d’un jeune martyr est porté par une foule compacte jusqu’au cimetière. Incrédulité curieuse des premiers, douleur collective des seconds.
Une indignation massive, solidaire et publique, est ainsi devenue possible en quelques semaines. Hier le mutisme et la résignation étaient imposés à tous. Hier l’étouffement d’un peuple par un régime autoritaire était légitimé par le fait d’être devenu un rempart à l’intégrisme islamique aux yeux des Etats européens. Grâce à la suspicion et à la méfiance généralisée, la privation de la liberté d’expression publique avait été banalisée.
Bien qu’opprimé, muselé, étouffé, humilié, le peuple tunisois/tunisien a eu « le dernier mot » mais en a payé le prix des victimes innocentes. Le soulèvement populaire a eu raison d’une dictature insupportable et trop longtemps enduré.
Nul ne connaît la suite au moment où nous écrivons cette chronique au lendemain de cette date historique. Celle du 7 novembre (1987) que le président déchu avait largement utilisé pour marquer l’espace public, lui cédera t-elle la place ? Des voix proposent déjà de rebaptiser toutes les places et les avenues du 7 novembre au nom de Mohamed Bouazizi, le jeune homme de Sidi Bouzid qui s’était immolé et a allumé l’étincelle de la révolution.
[1] http://du-photographique.blogspot.com/2011/01/chronique-dune-journee-historique.html
[2] Voir : PAQUOT T., 2009, L’espace public. Paris, La Découverte, coll. Repères.
10 janvier 2011
Un doctorat en paysage ? par P. Donadieu
Revenons sur la chronique du 15 novembre 2010. J’y avais abordé la question des disciplines d’un doctorat dans le domaine dit du paysage. Et poussons la réflexion un peu plus loin.
D’abord éliminons quelques paresses de langage en français. Le doctorat dont il est question ne peut être « en paysage », expression trop confuse et codée pour être comprise par tous. Revendiqué par les paysagistes, concepteurs ou ingénieurs, ce doctorat a pour objet les savoir-faire d’architecture de paysage (landscape architecture), discipline encore appelée paysagisme. Ce terme peu utilisé en français (comme l’anglais landscapism) est équivalent à architecture de jardin et architecture de paysage.
À l’instar de l’urbanisme dont il est voisin, mais distinct, le paysagisme désigne l’art, la science et la technique de l’architecture du paysage et des architectes paysagistes. Ce métier de paysagiste regroupe des concepteurs de paysage, des planificateurs de paysage, des paysagistes urbanistes, des paysagistes jardiniers, des conseillers de la maîtrise d’ouvrage, des maîtres d’œuvre, des médiateurs et des gestionnaires d’espaces extérieurs au bâti. Le paysagiste est au paysagisme, ce que l’urbaniste est à l’urbanisme, l’architecte à l’architecture et l’agriculteur à l’agronomie. Plutôt que d’un doctorat « en paysage », je parlerai d’un doctorat de paysagisme ou mieux de sciences du paysagisme, s’inscrivant dans les sciences de paysage àLandscape sciences – (poétiques, pratiques et théorétiques selon la classification aristotélicienne).
Dans toutes les universités de la planète, le doctorat (ou doctorat en philosophie -PhD- aux Etats-Unis et Grande-Bretagne) est le diplôme académique le plus élevé. Il sanctionne l’aptitude du chercheur à produire des connaissances nouvelles, débouchant ou non sur des innovations théoriques ou pratiques de toutes natures. Quels que soient la discipline concernée et son objet (l’art, la ville, l’espace ou la nature par exemple), le doctorat est inscrit dans le domaine des sciences (rigides ou flexibles). Ce qui veut dire que les connaissances créées doivent être diffusées (publications), débattues (controverses) et partageables (diffusion, transfert) dans les communautés universitaires et de chercheurs.
Trop scientifiques : figées sur des modèles et des paradigmes discutables, prétendant à des vérités exclusives d’autres vérités, incapables de percevoir leurs propres limites, ces connaissances nouvelles sont inquiétantes parce que scientistes. Trop rationalistes, intégrant parfois le monde humain dans celui des objets, elles masquent et ignorent les logiques des affects et des libertés humaines. Les pouvoirs politiques les instrumentalisent souvent au nom de l’expertise scientifique.
Pas assez scientifiques : trop subjectives et idéologiques, trop vite tournées vers des solutions technologiques ou conceptuelles, mal ou non argumentées par des preuves convaincantes, expérimentales ou logiques, elles ne peuvent prétendre à un statut d’épistémè universel. Les medias les diffusent souvent sans discernement.
Ni dogmatique, ni irréfutable, ni prétentieux, le savoir scientifique, de nature discursive, existe pourtant en tant que discours rationnel (et non rationaliste) sur le monde. Tenu le plus souvent par les chercheurs et les universitaires, il réunit, à un moment donné, des vérités logiques et expérimentales, débattues et justifiées publiquement. Si d’autres résultats plus convaincants apparaissent, avec d’autres paradigmes, les connaissances explicatives et interprétatives du monde changent, ce qui ne se fait pas, on s’en doute, en un jour.
Le doctorat en sciences de paysage (ou de paysagisme) inspire la plus grande méfiance aux paysagistes praticiens. En quoi cette injonction politique et universitaire (l’obligation de l’offre doctorale) les concernent-ils ? En quoi une formation de chercheurs peut-elle leur permettre de mieux exercer ces métiers et de les enseigner ?
Le doctorat suppose une pensée rationnelle. Si elle succombait à une dérive rationaliste, elle voudrait s’imposer à l’exclusion de toutes autres pensées (par exemple spiritualiste ou artistique), ce qui serait dommageable à la nature même de l’objet paysage dont chacun connaît la double face nécessaire matérielle et immatérielle, objective et subjective.
Une « bonne » thèse en science de la conception des projets de paysage, par exemple et parmi d’autres types, montre comment les concepteurs modifient leurs projets d’aménagement en fonction de la commande politique et des débats sociétaux dans les pays démocratiques. Elle ne prescrit rien, mais fait comprendre (explique et interprète) que les paysages (les espaces qui sont perçus) sont des constructions sociale et politique qui sont informées par des modèles culturels eux-mêmes soumis à des changements. Elle indique simplement que pour agir il faut d’abord connaître l’objet et le contexte de l’action.
Savoir cela ne doit pas interdire de savoir concevoir un projet de paysage mais en montre les limites et le dépassement possible. Les paysages les plus audacieux n’ont-ils pas été le résultat de collaborations réussies entre des scientifiques (des ingénieurs) et des designers ? par exemple dans le cas de la performance esthétique et technique du pont de Millau en France.
Le temps de l’ingénieur artiste du siècle des Lumières est révolu. La compétence de ceux qui dessinent le projet d’espace est distincte de celles qui le mettent en œuvre, puis en gèrent l’entretien et la dynamique. Toutes ces connaissances nouvelles peuvent être sanctionnées par des doctorats, qui en faciliteront l’enseignement, le transfert et l’adaptation d’un pays à l’autre.
3 janvier 2011
Petite théorie du processus de projet de paysage 1, par P. Donadieu
Les architectes paysagistes disposent d’un outil essentiel : le projet de paysage. De la même manière que les architectes qui font usage du projet d’architecture, que les urbanistes du projet urbain et les ingénieurs du projet d’ingénierie.
Au début des années 2000, les chercheurs français ont commencé à théoriser cette démarche de conception : les uns selon une posture phénoménologique[1], les autres[2] en mobilisant la théorie de l’artialisation du philosophe Alain Roger, ou les concepts du géographe Augustin Berque[3]. Ces théories ou leurs applications permettent surtout de rendre compte de la posture culturaliste des concepteurs créateurs de formes dans des œuvres paysagistes. Elles paraissent moins pertinentes pour comprendre ce que les géographes appellent la production de l’espace matériel, faisant appel à ses fonctions, à ses acteurs, à ses règles et à ses représentations, notamment à ses paysages.
Le concept clé, qui articule le projet de paysage et la production de l’espace, est la notion de processus. Le processus (process en anglais) est un ensemble de phénomènes actifs, orientés, souvent prévisibles, réversibles ou non. Il peut être naturel (l’érosion marine d’une falaise) ou non (le processus d’étalement urbain). La notion de processus désigne également toute suite d’opérations ordonnées aboutissant à un résultat. De ce point de vue, le projet de paysage, pour un architecte paysagiste, est un processus qui a un début (la commande d’un client) et une fin : le plus souvent une réalisation d’aménagement paysager ou la mise en œuvre d’une stratégie paysagère supposant une politique publique de paysage sur un territoire.
Dans la culture occidentale, le projet de paysage (hérité du projet de jardin) est un outil qui a pour but de mettre en place des lieux qualifiés publics et privés. Il suppose des modifications des espaces en fonction d’un programme de fonctions et d’usages (leurs « mises en paysages »), mais aussi parfois à des ruptures douloureuses, sociales et culturelles, avec les lieux anciens. Il traduit le plus souvent une idée (du maître d’ouvrage et de ses conseillers), et un concept (du designer) en matérialités (une place, une avenue, un jardin de quartier, un bord de cours d’eau). Dans ces cas ordinaires du métier de paysagiste concepteur et planificateur, le processus de transformation de l’espace est mis en œuvre par la procédure du projet de paysage dans le cadre de projets urbains et de territoires.
Or ces procédures de projet rencontrent de multiples difficultés pour être mises en œuvre. Certes, elles peuvent être efficaces quand les pouvoirs publics (gouvernementaux, régionaux ou urbains) savent composer avec les acteurs sociaux (gouvernance). Cependant le pouvoir d’injonction des Etats diminue inexorablement dans les démocraties européennes au profit des pouvoirs régionaux et locaux. C’est pourquoi, d’autres stratégies, plus habiles, ne tranchant pas entre les injonctions gouvernementales top down et les pratiques bottom up de participation sociale à la décision publique, doivent être imaginées pour accompagner les modifications de l’espace habité.
On n’a pas conscience, en effet, que la plupart des modifications de l’espace sont accompagnées par des transformations visibles (les paysages) mais surtout invisibles (les forces économiques, sociales et politiques). Ces dernières sont à l’origine des modifications matérielles du monde perceptible. C’est donc en agissant sur ces forces, directement et indirectement, qu’il est possible d’induire de manière souple et durable, des effets sur les paysages matériels. Commander du dedans plutôt que du dehors. Préférer le pragmatisme des stratégies latentes à l’idéalisme des projets politiques spectaculaires.
Le processus paysager est une interminable transition entre des états matériels eux-mêmes transitoires. Agir sur les processus consiste alors à induire des inflexions et non à viser des états finaux utopiques ; à penser le devenir des choses et non leur existence ; les résultats transitoires perceptibles des transformations en action, et non des aboutissements vains ; leurs émergences et leur renouvellement incessant plutôt que leur stabilisation illusoire.
Selon cette théorie, inspirée de la cosmologie orientale[4], le projet de paysage devient plus un accompagnement actif qu’une anticipation volontaire, frontale et idéaliste de la production de l’espace.
Pour illustrer cette idée, prenons l’exemple des politiques agriurbaines qui cherchent à maintenir l’agriculture dans les régions urbaines. Deux forces sociales et économiques sont en présence spatiale, concurrentes : la production des espaces construits et la production de l’espace agricole. Vouloir les maintenir par la planification urbaine ne suffit pas, il faut aussi accompagner les transformations inévitables des agricultures au contact de l’agglomération et de cette dernière au contact des activités agricoles.
Dans ces conditions, quatre situations potentielles apparaissent : l’étalement urbain incontrolé (la ville et l’agriculture sont perdantes) ; l’agriculture résidentielle (la ville gagne des agricultures urbaines -résidentielles et de proximité- où l’entreprise agricole rurale est plutôt perdante) ; l’agriculture périurbaine (l’agriculture ne s’adapte pas ou peu aux marchés de produits et services agriurbains et tourne le dos à la ville qui en perd le bénéfice ; enfin dans la solution dite des campagnes urbaines ou des villes agricoles, les agricultures, les jardinages et les tissus urbains coévoluent à bénéfices réciproques en fonction des situations locales et globales des économies agricoles et urbaines.
C’est en cherchant à induire ces productions de biens et services communs agriurbains que le gestionnaire de paysages, toujours en amont des processus prévisibles, peut agir sereinement avec les acteurs politiques et sociaux pour accompagner des processus de modification-transformation que nul ne pourra prétendre maîtriser.
Agir sur les paysages relève plus du jeu de go que du jeu d’échec !
[1] J.M. Besse, « Cartographier, construire, inventer. Notes pour une épistémologie de la démarche de projet », Les Carnets du paysage, n° 7, 2001, pp. 127-145. G. A Tiberghien, « Forme et projet », Les Carnets du paysage, n° 12, 2005, pp. 89-103
[2] F. Pousin, « Repères pour un débat » et J.P. Boutinet, « A propos du projet de paysage, repères anthropologiques », Les Carnets du paysage, n°7, 2001.
[3] S. Keravel, « Passeurs de paysages »%u2028publié dans Projets de paysage le 31/12/2008 ; URL : http://www.projetsdepaysage.fr/fr/passeurs_de_paysages.
[4] François Jullien, Les transformations silencieuses, Le livre de poche, Grasset, 2009.
